
La question de la conscience des plantes dans l’art contemporain
Avec ces enjeux en tête, je voudrais profiter des pages qui suivent pour envisager, bien que brièvement, ce que la conscience des plantes, une fois admise, peut appeler comme éthique du consentement en regard de l’utilisation que nous en faisons en art, qu’elles soient vivantes, mortes ou figurées. En quoi une telle éthique pourrait-elle consister ? L’art peut-il devenir un champ d’exploration fécond des possibilités de coexistence interspécifique en remettant en cause notre vision anthropocentrique et notre relation aux plantes ?
Dans la tradition scientifique euro-occidentale, le comportement et les capacités des plantes ont longtemps été jugés moins complexes que ceux de leurs homologues du règne animal – surtout ceux de l’être humain, qui trône au faite d’une hiérarchie autoérigée d’intelligence organismique. En conséquence de tels préjugés, l’opposition à des formes de conscience autres s’est généralisée – à tort, si l’on en croit des découvertes récentes. De nouvelles études font état chez la plante d’« un haut niveau de sophistication, que l’on pensait réservé au seul champ du comportement animal1 1 - Richard Karban, « Plant Behaviour and Communication », Ecology Letters, vol. 11 (2008), p. 727. [Trad. libre] ». De fait, nombreux sont les scientifiques qui, désormais, estiment que ce comportement intelligent est la manifestation d’une modalité de conscience ou de cognition qui, bien qu’elle diffère de celle des êtres humains, n’est pas moins légitime. Anthony Trewavas, phytoscientifique de premier plan, définit la conscience comme la perception élémentaire du monde extérieur. C’est à partir de là, soutient-il, que s’établit la notion ou la reconnaissance de soi2 2 - Anthony Trewavas, « Intelligence, Cognition, and Language of Green Plants », Frontiers in Psychology, vol. 7 (2016), p. 1-9.. La plante puise, dans son environnement immédiat, de l’information cruciale qu’elle traite en conjonction avec de l’information sur son propre état interne pour agir dans l’intérêt de son bienêtre3 3 - Idem, « Profile of Anthony Trewavas », Molecular Plant, vol. 8 (mars 2015), p. 345-351..Cela dit, bien que la plante, à l’instar de l’être humain, manifeste une conscience ou une cognition, la conscience végétale « n’est pas localisée, mais plutôt distribuée dans toute la plante4 4 - Idem, « Intelligence, Cognition, and Language of Green Plants », op. cit., p. 3. [Trad. libre] », contrairement à celle, centralisée, qui caractérise le cerveau animal. De telles conclusions bousculent les concepts euro-occidentaux en invalidant le critère d’une structure cérébrale centralisée, allant du sommet vers le bas. En d’autres mots, cette vision perturbe la hiérarchie anthropocentrique sur laquelle la biologie végétale se fondait jusqu’à récemment en avançant que conscience et cognition ne seraient pas le propre de l’animal. Celles-ci s’exprimeraient selon des formes inusitées que nous, êtres humains, n’avons pas encore les moyens de saisir pleinement – ou que, plus vraisemblablement, nous ne sommes pas désireux de comprendre.

In The Same Breath, Rejection and Ice Cream on the Wood Shed, capture vidéo, 2018.
Photo : permission des artistes

Cyanotypes, vue de l’installation In The Same Breath, Gallery 44, Toronto, 2018.
Photo : permission de Gallery 44, Toronto
Cela dit, il importe de signaler que, bien que les voix dominantes de la science occidentale montrent très peu d’intérêt pour les formes d’intelligence non humaines, les façons d’être et d’appréhender le monde des Autochtones, elles, posent de longue date un regard différent sur les comportements non humains et la relation entre l’être humain et la nature. Il serait toutefois inconcevable, compte tenu de ma position dans le camp des colonisateurs, d’offrir un survol des innombrables systèmes de connaissances autochtones qui ont cours partout sur la planète – ou même seulement en Amérique du Nord.
Au lieu de cela, je ferai appel aux travaux de Kyle Whyte, professeur et militant écologiste potéouatami, pour attirer l’attention sur les façons non anthropocentriques d’appréhender le monde. Whyte explique que pour les communautés autochtones, notamment les Anishinaabe, l’identité culturelle dérive d’une compréhension de la nature où « l’agentivité et l’intelligence ne sont pas la prérogative de l’être humain5 5 - Kyle Whyte, « Settler Colonialism, Ecology, and Environmental Injustice », Environment and Society: Advances in Research, vol. 9 (2018), p. 127. [Trad. libre] ». Cette conception sous-tend les responsabilités anishinaabe vis-à-vis de la nature et de ses habitants non humains, qui font l’objet d’un grand respect. Pour certains peuples autochtones, la frontière entre l’humain et le non-humain n’est pas étanche ; elle met en doute le concept de l’être humain comme forme de vie distincte, la seule douée de raison. La reconnaissance et le respect des modes non humains d’existence et de savoir sont indissociables des notions d’interdépendance et de responsabilité par lesquelles le peuple anishinaabe honore la réciprocité inhérente aux relations que l’être humain entretient avec ses semblables, son environnement et les êtres non humains qui sont ses parents. Les Anishinaabe acceptent ainsi que ces relations s’accompagnent du devoir mutuel de nourrir et de soutenir6 6 - Ibid., p. 127-128..
Au diapason des systèmes de connaissances autochtones qui ouvrent la frontière entre l’intelligence, la cognition et l’agentivité humaines et non humaines, il existe chez les artistes visuels et littéraires autochtones une grande tradition de travail avec et à travers les plantes, qui deviennent des alliées dans l’exploration des concepts de lieu, de race, de colonialisme et d’environnement. Je pense à l’artiste Shelley Niro, dont les œuvres dialoguent toujours avec la nature, y compris les plantes.
Bien sûr, quand je dis qu’il y a manifestement, en art, une tendance à recourir aux plantes et aux jardins comme thèmes ou moyens d’expression (ou les deux), il faut préciser qu’en soi, il n’y a là rien de neuf. Plutôt, pour une génération et un pan du milieu artistique, à ce moment-ci de l’histoire, il semble y avoir un penchant prononcé pour la botanique comme objet artistique, sujet et lieu de résistance et d’activisme. Dans de nombreux cas, les plantes et les jardins constituent des espaces où il devient possible d’aborder l’histoire des conflits. Eleana Antonaki, par exemple, s’inspire de l’historique des déménagements et du jardinage de sa famille pour sonder les tensions politiques en Grèce au fil du temps. Elle crée pour ce faire des archives imaginaires d’objets nommés, collectivement, Uncanny Gardening I, parmi lesquelles se trouve, notamment, le dessin d’un livre fictif intitulé Uncanny Gardening: A Complete Guide for Planting Yucca Trees, Persian Silk Trees and Bougainvillea (2018).
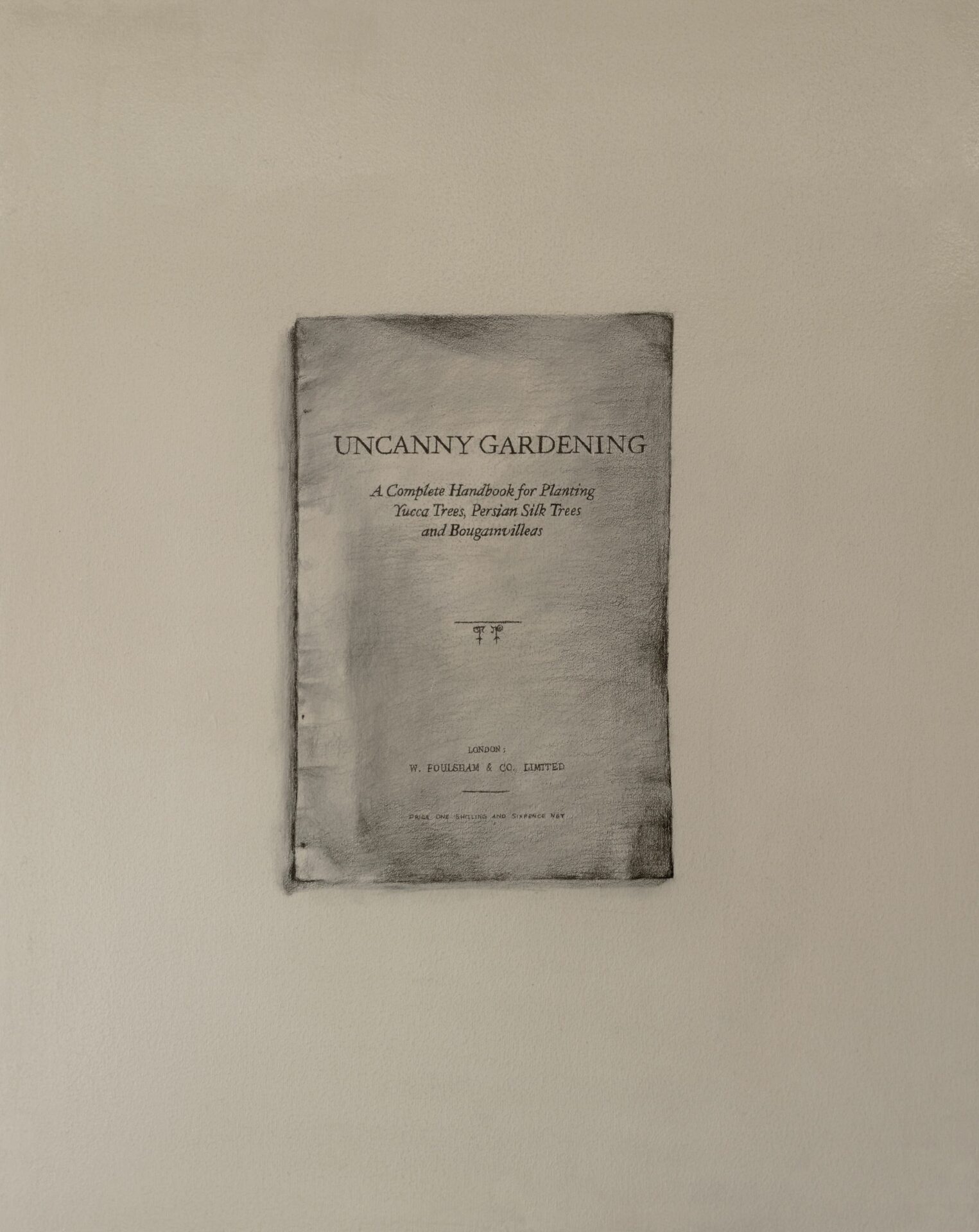
Uncanny Gardening I.I & I. II, 2016.
Photos : permission de l’artiste

Uncanny Gardening I.I & I. II, 2016.
Photos : permission de l’artiste
Nombre d’artistes recherchent une interaction plus directe avec les plantes, prises comme agents de communication doués d’intelligence. Dans l’œuvre collective In the Same Breath, présentée à la Gallery 44, à Toronto, Alicia Nauta et Joële Walinga, par exemple, entreprennent de partager des souvenirs avec une plante, puis de mener une étude olfactive sur l’effet d’un tel échange sur la physiologie végétale. Chaque artiste choisit une plante à laquelle elle confie un souvenir – à haute voix, de façon répétitive et sur plusieurs mois. Ce processus est capté sous forme de vidéos silencieuses et de cyanotypes. Les artistes prélèvent ensuite des boutures, qu’elles distillent pour extraire l’essence aromatique de la plante telle qu’elle est au terme de l’échange de façon à sonder la manière dont les plantes perçoivent l’information et dont cette information se manifeste physiologiquement. En choisissant des vidéos silencieuses, des cyanotypes et des odeurs pour présenter leur travail, Nauta et Walinga excluent certains sens du partage des souvenirs : l’ouïe et le toucher ne sont d’aucune utilité au spectateur, qui ne peut compter que sur la vue et l’odorat. Nauta et Walinga sont les représentantes d’un groupe grandissant de jeunes artistes d’allégeance plutôt féministe dont les œuvres écologiques signalent un changement de paradigme dans la façon dont l’art se laisse éclairer et traverser par la nature. Du point de vue créatif, ces œuvres prennent des formes très variées et s’attaquent à une multitude d’enjeux, à la fois personnels et sociétaux, en sorte que les éléments de la nature – les plantes, notamment – sont traités comme des sujets en soi ou comme la métaphore d’autre chose.


Sonic Succulents: Plant Sounds and Vibrations, vue d’installation? Brooklyn Botanic Garden, New York, 2019.
Photos : permission de l’artiste
Adrienne Adar joue elle aussi avec la question de la communication des plantes. Dans sa dernière exposition, Sonic Succulents: Plant Sounds and Vibrations at Brooklyn Botanic Garden, elle met au point une plateforme d’interaction sonore avec plusieurs plantes de la même espèce auxquelles elle fixe des capteurs fabriqués à la main. Le thème botanique est récurrent dans la pratique d’Adar : elle a auparavant réalisé une œuvre de captation sonore avec des arbres intitulée Listening Trees et, dans le cadre de Wildflower Sound Cannon: Panspermia, documenté la confection et le tir de bombes de semences de fleurs sauvages dans le désert des Mojaves, en Californie, en collaboration avec Bob Dornberger. Dans son exploration des sons et des plantes, semblable à celle que font Nauta et Walinga, Adar considère les formes non humaines de la conscience, de la perception et de la communication et envisage les moyens par lesquels l’être humain peut y participer. Bien que l’idée d’une conscience non humaine, surtout associée aux plantes, puisse paraitre intangible (au mieux) ou incompréhensible (au pire), les artistes qui s’interrogent sur ces facettes peu approfondies de la vie non humaine fournissent, par leur travail, de précieux moyens de contrer l’anthropocentrisme de la pensée dominante. Les œuvres dont j’ai parlé montrent avec éloquence les divers rôles plus actifs que peuvent jouer les plantes dans la création et la redéfinition de notre relation au monde végétal. Cela dit, si l’on admet la possibilité de la conscience des plantes, d’éventuelles considérations éthiques sont-elles à prendre en compte ? Comment la reconnaissance de modalités autres qu’humaines de conscience et, partant, d’agentivité, influe-t-elle sur notre façon d’évaluer, du point de vue éthique, le recours à des espèces non humaines (les plantes, en l’occurrence) ? Comment pouvons-nous repenser le consentement, quand il s’agit de plantes et d’autres formes de vie non humaines ? En reconfigurant notre relation à la nature et aux plantes, de telles considérations éthiques interfèrent-elles avec l’efficacité du végétal comme sujet et objet dans la création artistique ?

Wildflower Sound Cannon: Panspermia, documentation, 2015.
Photo : permission de l’artiste

Wildflower Sound Cannon: Panspermia, documentation, 2015.
Photo : permission de l’artiste
Les manières autochtones d’être et d’appréhender le monde peuvent contribuer à montrer la voie. Dans une entrevue à la radio, la botaniste et professeure potéouatami Robin Wall Kimmerer avance qu’au lieu de contempler la plante sous l’angle de son fonctionnement, ce qui a pour effet de la chosifier, la vision du monde potéouatami la considère comme un sujet, compris et respecté en fonction de ce qu’il a à offrir et de ce dont il est capable. Elle explique également que des relations de réciprocité peuvent être favorisées au moyen de ce qu’elle appelle une « grammaire de l’animicité », dans laquelle les êtres non humains sont soit « animés », soit « inanimés ». Le pronom « ça » – grossier, estime Kimmerer – est quant à lui rejeté.
Lorsqu’on lui demande comment la communauté scientifique perçoit cette approche, Kimmerer répond : « Les scientifiques s’empressent de dire de ne pas personnifier la nature par crainte de dérives anthropomorphisantes. Ce que j’entends, quand je parle du statut de sujet de tous les êtres, plantes comprises, ce n’est pas que je leur attribue des caractéristiques humaines, pas du tout. J’attribue aux plantes des caractéristiques de plantes. Tout comme il serait irrespectueux d’essayer de faire entrer les plantes dans la même catégorie que nous par voie d’anthropomorphisme, il me paraitrait profondément irrespectueux d’affirmer qu’elles sont totalement dénuées de conscience, de sensibilité, d’existence. D’ailleurs, la science elle-même s’abstient de plus en plus souvent de refuser aux autres formes d’existence le statut de sujet7 7 - Robin Wall Kimmerer dans The On Being Project, « Robin Wall Kimmerer: The Intelligence in All Kinds of Life », On Being with Krista Tippett, entretien, 25 février 2016, https://bit.ly/3bK480h. [Trad. libre]. »
Percevoir les plantes comme des sujets dignes d’estime, voilà peut-être un bon point de départ pour réfléchir à ce qu’implique travailler avec et à travers les plantes en art tout en reconnaissant une conscience végétale. Les artistes pourraient-ils, par exemple, employer la grammaire de l’animicité quand ils parlent des plantes et qu’ils travaillent avec elles ? Naturellement, une telle initiative pourrait devenir un geste symbolique creux. Cependant, les travaux de penseurs et de militants autochtones – amplement corroborés par les résultats de la recherche menée par la communauté scientifique euro-occidentale – suggèrent qu’attribuer aux êtres non humains le statut de sujet a aussi le potentiel de changer fondamentalement et fructueusement non seulement notre perception de nous-mêmes au sein de la nature, mais aussi notre manière d’interagir avec elle et d’en prendre soin. Dans cette perspective, les plantes pourraient bien, en effet, avoir un rôle révolutionnaire à jouer, par le truchement de l’art.
Traduit de l’anglais par Isabelle Lamarre
