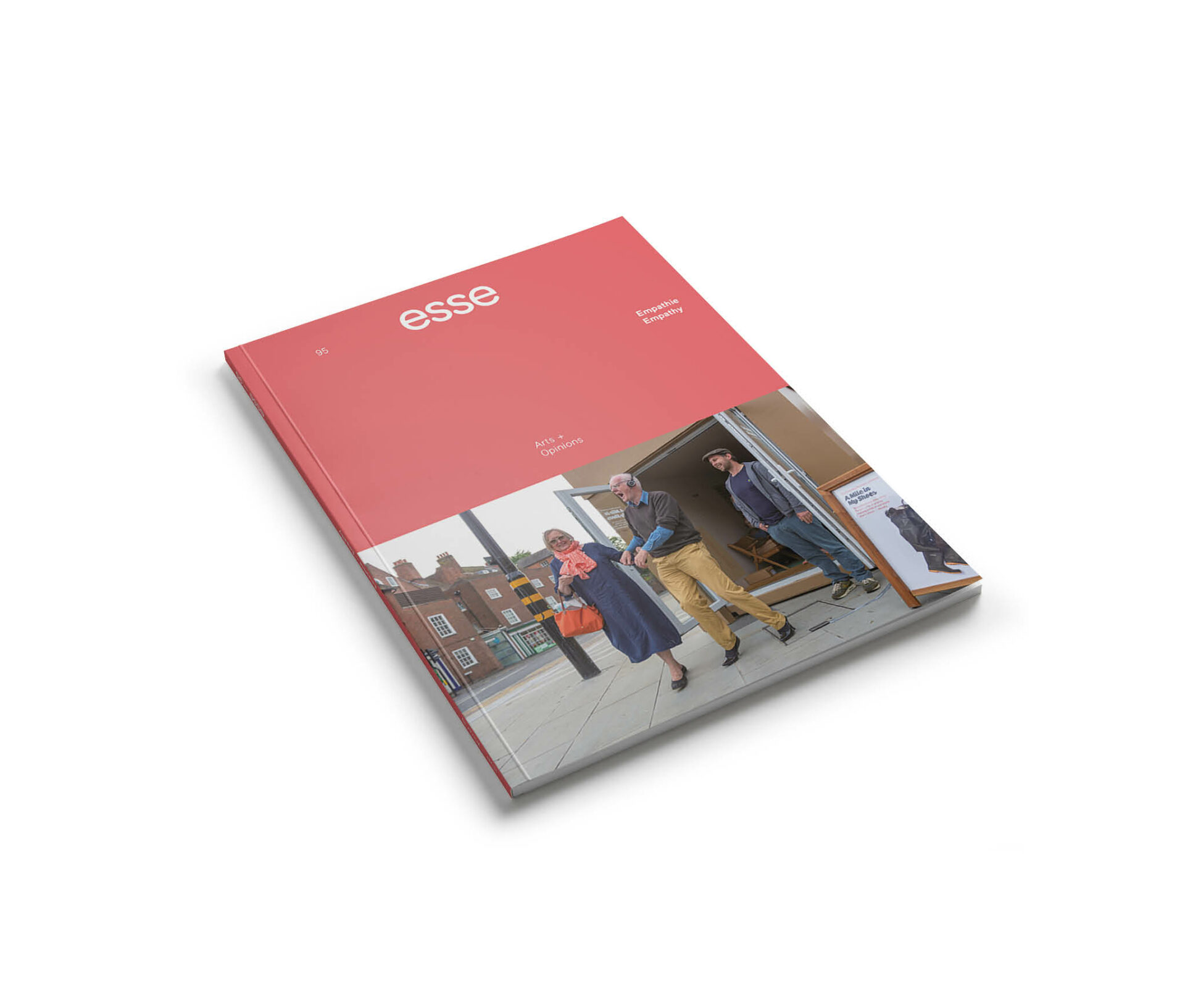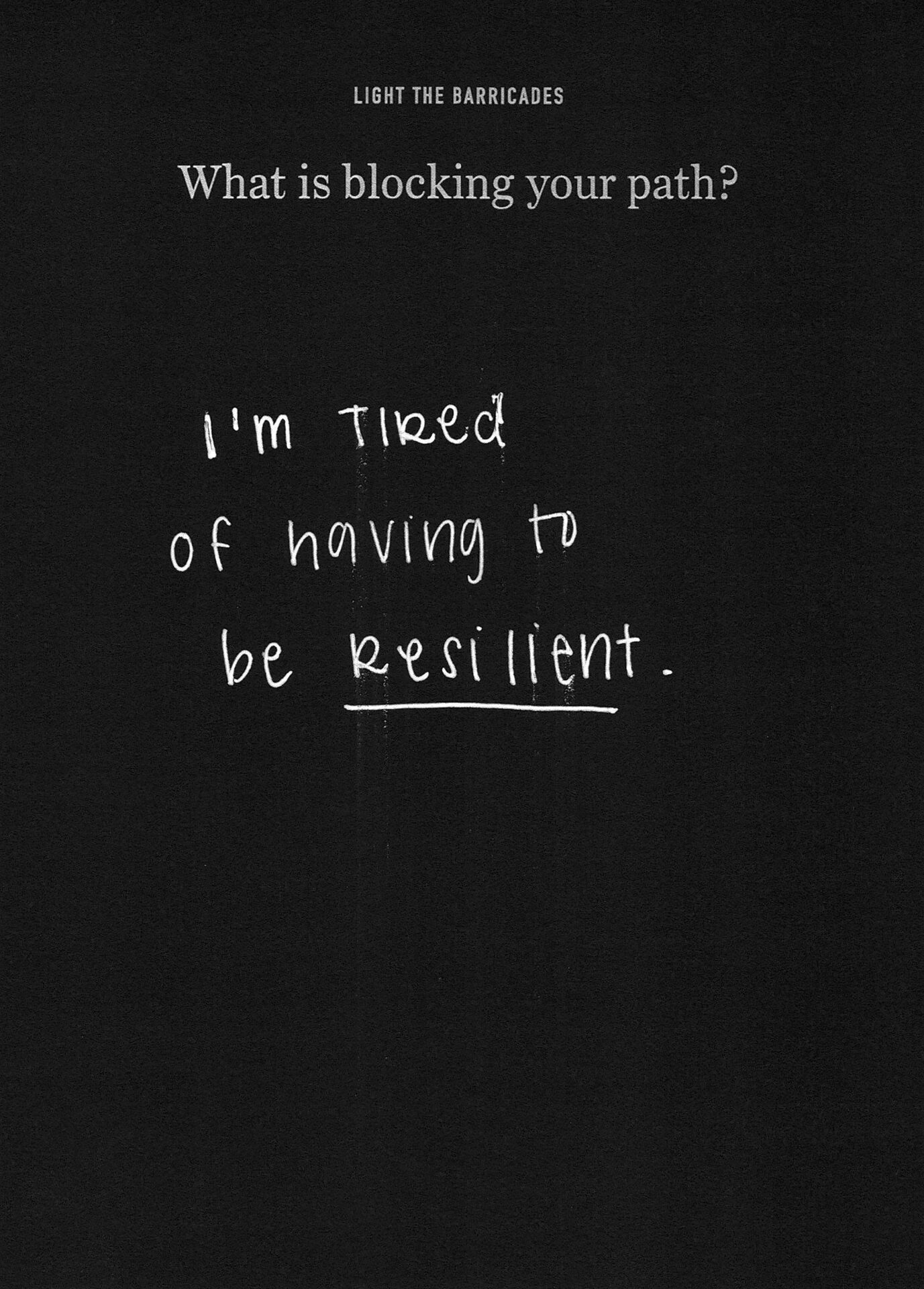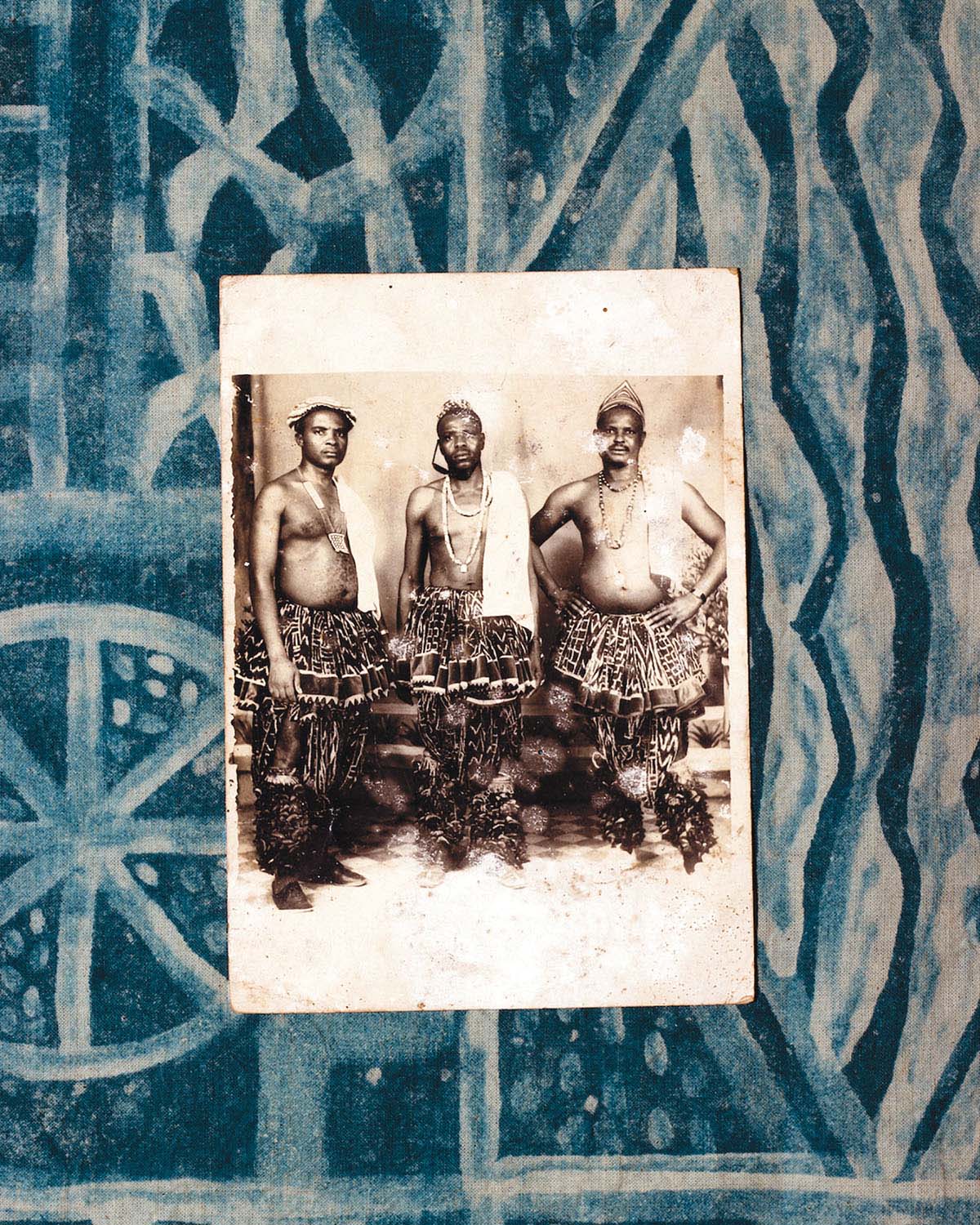Photo : © Harun Farocki
Les yeux grands ouverts : la traduction affective dans l’art contemporain
Farocki tend ensuite la main hors champ et saisit une cigarette allumée. Alors que la caméra effectue un zoom sur son avant-bras, on entend une voix dire : « Une cigarette brule à 400 degrés, mais le napalm, lui, brule à 3 000 degrés. » Puis Farocki écrase la braise sur sa peau. La scène est suivie d’un pseudodocumentaire montrant des scientifiques et des employés dans une simulation de l’entreprise Dow Chemical, qui était responsable de la production du napalm. La caméra filme des bureaux, des secrétaires, des tableaux et des personnes en sarrau de laboratoire. Mais l’histoire est constamment interrompue par un cruel gros plan de plaie carbonisée, comme pour rappeler le souvenir obsédant dont Farocki nous a prévenus. À chaque apparition de l’image, le malaise augmente : d’abord, un doigt intrusif frotte la plaie noircie de la peau exposée au napalm, ou brulée par la cigarette – cela demeure ambigu. Dans le flash suivant, des pincettes argentées sondent la blessure. Et cette escalade aboutit à une scène où les pincettes arrachent de la peau. En recourant à la perception incarnée par l’entremise de la blessure et à la rupture du fil contextuel, Farocki exploite des dispositifs qui ne sont pas sans lien avec la réflexion sur l’empathie et l’identification émotionnelle aux œuvres d’art, menée entre autres par Bertolt Brecht, Roland Barthes et, plus récemment, Jill Bennett1 1 - La « perception incarnée » signifie que notre corps lui-même est un récipient de perception, en dialogue avec les mouvements, les expressions ou encore, comme ici, les blessures d’autrui, en raison d’une réaction physiologique automatique qui déclenche la pensée. Bien que certains philosophes et neuroscientifiques se soient penchés sur cette notion (qui se rapporte à la théorie des neurones miroirs), je me réfère ici à la façon dont s’en sert Jill Bennett dans sa réflexion sur l’art et l’empathie. Voir Jill Bennett, Empathic Vision: Affect, Trauma, and Contemporary Art, Stanford, Stanford University Press, 2005. Pour une analyse de l’œuvre de Farocki en relation avec l’empathie, voir Clio Nicastro, « Harun Farocki: Empatia e conflitto », Epekeina, vol. 7, nº 1-2 (2016), p. 1-9. Il soulève également la question essentielle de savoir comment les artistes arrivent à provoquer l’empathie sans pousser le spectateur à fermer les yeux ou à éluder sa culpabilité, directe ou indirecte, en projetant naturellement sa souffrance sur autrui, sur tout ce qui est extérieur au sujet percevant, à commencer par les peuples victimes de l’oppression coloniale. L’intérêt particulier de Farocki pour les dispositifs qui suscitent l’empathie du spectateur – ici, la narration et la blessure – est également manifeste dans deux œuvres récentes de Candice Breitz et Berlinde De Bruyckere qui mettent en lumière cette politique du lien affectif à autrui.