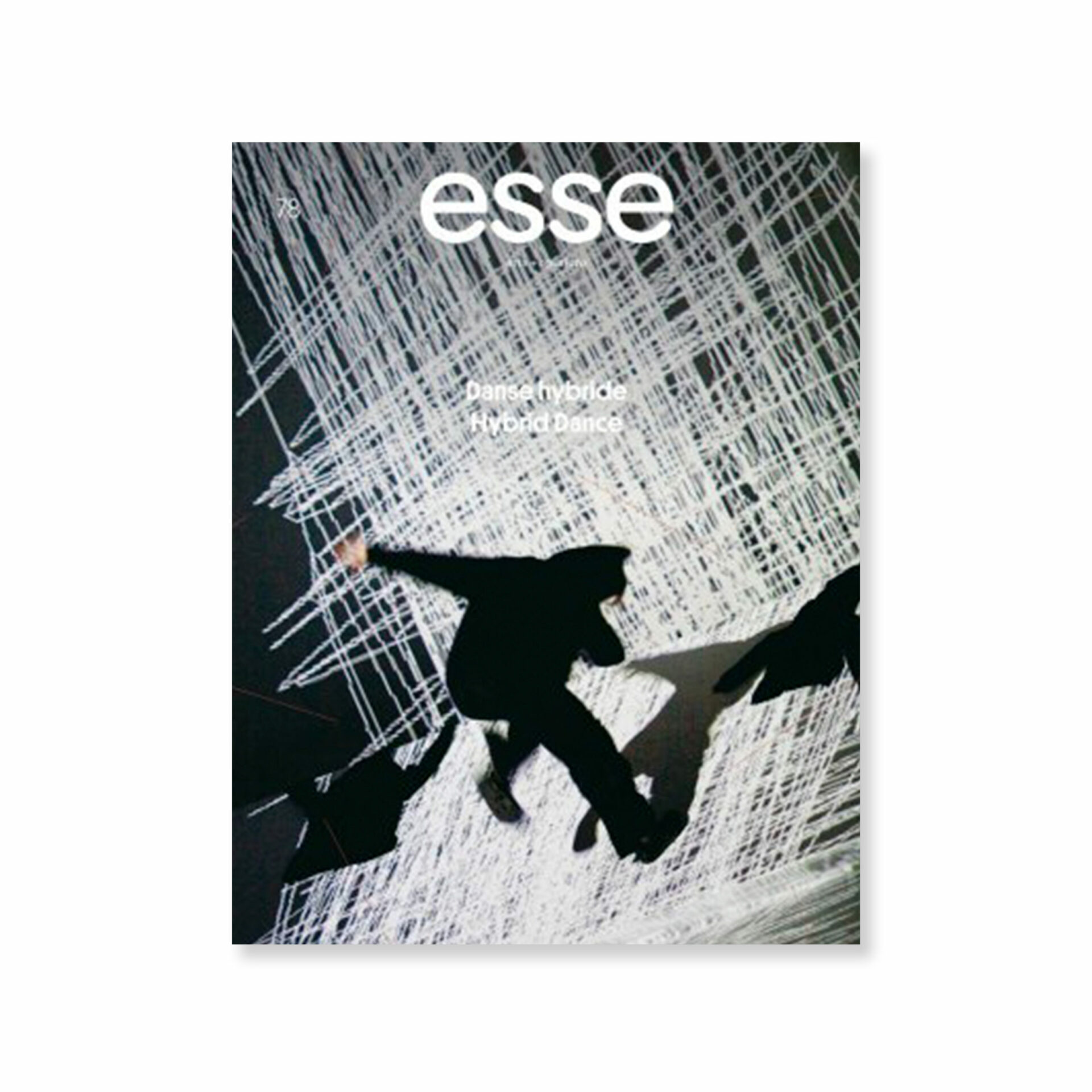Poser une main sur la cuisse. Et ne rien faire d’autre.

Photo : Sandra Lynn Bélanger, permission de l'artiste
Le peintre ne peint pas sur une toile vierge, ni l’écrivain n’écrit sur une page blanche, mais la page ou la toile sont tellement déjà couvertes de clichés préexistants, préétablis, qu’il faut d’abord effacer, nettoyer, laminer, même déchiqueter pour faire passer un courant d’air issu du chaos qui nous apporte la vision1 1 - Gilles Deleuze et Félix Guattari, Qu’est-ce que la philosophie ?, Paris, Éditions de Minuit, 1991, p. 192..
Au croisement du théâtre, de la danse et du cirque, Nicolas Cantin appréhende la boîte noire comme une toile vierge. Très visuelles, ses œuvres mettent en scène des objets et, parmi eux, le corps. Épurées et minimales, ses pièces, plus bâtardes qu’hybrides, tendent à construire le spectacle comme un tableau mouvant. Dramaturge de l’espace et du temps plus que créateur de mouvement, il met en jeu avant tout le « vivant » : « L’intime m’intéresse. J’aime par-dessus tout regarder quelqu’un qui ne sait pas qu’il est regardé. J’aime être témoin de cet instant où ça cesse de jouer. Lorsque je te regarde, c’est comme si j’observais un cerf en pleine forêt. La victoire est quelque chose de magnifique, mais étrangement il y a quelque chose qui me touche davantage dans le spectacle de la défaite. Il y a de la beauté dans l’image d’un bateau échoué. Je suis au début de quelque chose. Aujourd’hui, tout ce qui m’intéresse, c’est de voir des personnes qui sont sur scène le plus simplement du monde et qui acceptent que l’on pose un regard sur eux. Et je trouve que c’est déjà beaucoup2 2 - Nicolas Cantin, texte de présentation de Grand singe (2009).. »

Grand singe, 2009.
Photo : Simon Couturier, permission de l’artiste
Clown noir
Katya Montaignac : Dans Grand singe (2009), un homme et une femme cohabitent sur scène. Malgré eux, ils incarnent la figure du couple… Et pourtant ce duo (comme les suivants) met en scène deux personnes qui se croisent. Sans éclat. Les élans d’affection d’Anne Thériault avortent systématiquement face à son partenaire qui demeure impassible, tel un mur, dénué de la moindre émotion. Cette absence de réaction constitue sans doute le drame de la pièce.
Leurs actions se répètent comme une routine infernale. Le fait de désactiver le jeu de l’acteur permet de lui laisser davantage de place pour « être » sur scène : « être là sur le plateau, comme assis dans son salon » (Jérôme Bel). Cette absence de projection construit un état de présence qui permet l’irruption du vivant sur scène. Quand Stéphane Gladyszewski s’arrête, Anne continue sans lui de manière absurde. La scène bascule alors et le comique de situation vire au tragique.
Enfin, la pièce se clôt sur une ambiguïté malsaine : ce couple quasi édénique (enfantin, naïf et innocent) s’enduit les corps de peinture noire, induisant l’idée de la souillure et laissant alors la scène apparaître comme un terrain de jeu dévasté.
Page blanche
Nicolas Cantin : Une rencontre, voilà ce qu’est pour moi Grand singe. Une rencontre entre Anne et Stéphane. Une rencontre entre les interprètes et le public. Et une rencontre aussi, peut-être, entre les interprètes et le spectacle lui-même. Le spectacle étant bien évidemment le masque derrière lequel je me cache.
Et tout cela passe par le jeu. Ce jeu auquel ils se livrent est simple – primaire, à l’alphabet rudimentaire ; un jeu qui n’est pas dupe, mais qui lentement va glisser vers une dimension tragique. En d’autres mots, dans Grand singe, on voit deux personnes qui vont se (faire) prendre à leur propre jeu et se faire avaler par le spectacle lui-même.
J’aime quand tu parles de l’irruption du vivant sur scène. C’est, je pense, ce que je cherche de façon obsessionnelle dans tout ce que je fais. Quand j’ai commencé à travailler sur Grand singe, je suis parti d’une page blanche. Ma page blanche était un espace vide dans lequel allaient devoir exister deux personnes, en l’occurrence un homme et une femme. Le spectacle partait de ce simple point de départ. Mon but était de faire exister quelque chose sur scène en ne gardant que le strict nécessaire. En réduisant le spectacle à sa plus simple expression, je souhaitais que le vide agisse comme un écrin (ou comme un révélateur) sur Anne et Stéphane. C’était comme de me débarrasser des meubles dans une maison. En ouvrant l’espace, en le libérant de ce qui l’encombre, j’ouvrais du même coup mon regard et ainsi donc, celui du spectateur.
L’irruption du vivant
KM : L’irruption du vivant sur scène consiste, paradoxalement, à vider l’espace plutôt qu’à le remplir : laisser vivre une action sur scène, tout simplement, et laisser le temps respirer. Plutôt que de construire et d’ériger, il s’agit, au contraire, d’ôter, de défaire, d’extraire, de se détacher, de se reculer : pour laisser les choses advenir par elles-mêmes en leur laissant « un temps » (le temps de l’installation est important, d’où l’idée d’un effet). Alors soudain, parfois, quelque chose de l’ordre du « vivant » surgit sur scène, échappe au spectacle et le fonde en même temps.
Pour cela, il s’agit de créer un cadre, un espace, une temporalité, plutôt que de les remplir. Par exemple, une action dans Grand singe consiste à poser une main sur la cuisse. Et ne rien faire d’autre. La durée suggère plus qu’elle ne « représente ». Cela pourrait paraître simple et abstrait, ou, tout simplement, anodin et quotidien. Et pourtant, la situation induit toutes sortes de sens. Le choix de ne pas préciser (ou éclaircir) le geste permet de démultiplier les sens possibles. La situation s’ouvre alors comme une énigme à compléter selon l’imaginaire de chacun. Pour le public, cela nécessite un regard actif, prêt à remplir lui-même les creux, les trous, les vides.
L’innommé
NC : Poser une main sur une cuisse. Et ne rien faire d’autre.
Cette phrase résume bien ce que j’essaie de faire.
Poser une main sur une cuisse. Et ne rien faire d’autre.
Je pense que dans cette phrase il y a tout mon projet. Capter le vivant. J’ai presque honte de le dire tellement le projet auquel je me livre est impossible. Mais c’est ce qui fait qu’il est beau. Et pathétique à la fois. Mon travail est en quelque sorte un retour à la préhistoire. À ce qu’il y a avant l’histoire. J’aime l’idée de revenir à quelque chose de brut, d’archaïque. À quelque chose d’innommé. Voilà le projet.
L’absence béante
KM : Belle manière (2011) : encore un homme et une femme, encore une absence de relation. Chacun fonctionne sans avoir conscience de l’autre. La figure du duo se fissure alors à travers une esthétique de la faille, du déséquilibre et de l’effondrement. La scène devient un terrain de jeu chaotique où les actions résonnent dans le vide. Elles n’ont pas d’écho, pas d’issue. Les actions s’exécutent sans but. Cette absence de logique et de résolution donne à la pièce un côté à la fois drôle et pathétique, profondément tragique.
Ashlea Watkin se démène et chante des chansons à répondre. Sans réponse. La présence de Normand Marcy résonne comme un vide, comme une absence. Une absence béante. La présence d’un être absent n’est-elle pas pire que l’absence elle-même ? Il est là et absent en même temps. Il voit mais ne regarde rien. Tout le contraire du prince charmant : lourd, statique, gauche, paumé, glauque. Il ne fait rien, ne cherche pas à agir ni à répondre. Il est juste là, comme posé sur la scène. Parmi d’autres objets. Il est là comme il pourrait être ailleurs. Le monde tourne autour de lui sans qu’il réagisse. Il absorbe. Il s’agit avant tout d’un état. Être plutôt que faire. Être là, mais ne rien faire.



Belle manière, 2011.
Photos : Sandra Lynn Bélanger, permission de l’artiste

Solitudes
NC : Je ne travaille jamais avec l’idée du duo (pour Grand singe ou pour Belle manière) ou du quatuor (pour Mygale). J’aime plutôt l’idée de travailler avec des personnes. Ça fait toute une différence dans mon esprit de penser l’addition (1+1 ou 1+1+1+1) plutôt que de penser directement le deux ou le quatre.
Je travaille avec des solitudes. Des solitudes que je mets ensemble. Ce que nous sommes, dans la vraie vie, selon moi. Ce qui me fait penser à cette phrase : deux parallèles se rencontrent à l’infini. C’est l’espace entre deux personnes qui va nourrir la rencontre. L’espace entre deux personnes m’intéresse. C’est l’espace premier. Celui qui me fait réfléchir et me questionner. Quand tu mets côte à côte deux photos très différentes et que tu te mets à les regarder, ton imaginaire commence à construire toutes sortes d’associations entre ces deux photos. Et, miraculeusement, à produire d’autres images à partir de ces deux premières. C’est ce que je cherche à faire à partir du vivant.
Concernant la relation, j’aime ne pas la forcer. On voit dans mes pièces des personnes qui semblent ne pas agir ensemble. Elles sont d’une certaine manière étrangères les unes aux autres. Mais il s’agit selon moi d’une rencontre, même si la rencontre n’a pas lieu selon les codes. Il y a quelque chose qui ressemble au lien qui peut exister dans une famille de tigres. Apparemment indifférents les uns aux autres, mais ensemble. Échappant aux codes, à nos propres codes d’humains.
Le trouble de l’intime
KM : Tes créatures semblent en effet se croiser sans se voir plutôt que de tisser des liens entre elles. Cependant, cette absence de relation en crée une, paradoxalement : une relation étrange, boiteuse, voire dysfonctionnelle. Quand tu parles de rencontre, je crois qu’elle se déroule davantage entre le public et le personnage qu’entre les personnages eux-mêmes. C’est en effet le spectateur qui comble les trous avec son imaginaire et qui tisse un lien, un espace, un « être ensemble », entre lui et la représentation.
Il me semble qu’un nouvel élément apparaît dans ton travail à travers la confidence livrée sur scène (qu’elle soit réelle ou fictive). Cela amène autrement la notion d’intimité sur scène. Dans Mygale (2012), le détachement du performeur rend son témoignage d’autant plus poignant. Une espèce d’insoutenable légèreté de l’être…
Enfin, tu gommes toute trace d’héroïsme, ce qui rend tes interprètes à la fois attachants, vulnérables, risibles et tragiques. Et tu étires le temps pour que le public partage quasiment l’expérience de leur quotidien et donc une part d’intimité. Le spectateur semble ainsi cohabiter, le temps de la représentation, avec tes personnages.
Une voix
NC : Il n’y a pas de créatures.
Il n’y a pas de personnages.
Il y a des personnes.
J’y tiens, à cette idée de personnes.
Tu as raison quand tu dis qu’un nouvel élément apparaît dans mon travail. À la fin de Mygale, il y a un enregistrement que tout le monde écoute. Les interprètes sur scène et le public. C’est comme ça que le spectacle finit. Avec quelqu’un qui parle d’amour. J’aime l’idée qu’à la fin de ce spectacle, il ne reste sur scène que cette personne qui parle à travers ce radiocassette. Rien qu’une voix. Je m’avance sur un nouveau terrain. Enregistrer l’intimité. Dans mon travail, cette intimité passait jusque-là par le corps. Elle passe maintenant par le langage. Et c’est vrai que cela prend le chemin de la confidence.
Depuis un moment, je commence à me poser de nouvelles questions. Comment mettre des mots sur ce qui se passe à l’intérieur ? Comment enregistrer des fragments de la vie intime d’une personne en passant par la parole ? Avec Michèle Febvre3 3 - Nicolas Cantin travaille actuellement avec Michèle Febvre dans le cadre d’un laboratoire intergénérationnel lancé et dirigé par Katya Montaignac. Le fruit de cette rencontre a donné lieu à un solo qui sera présenté à la fin de 2013., j’ai choisi de puiser dans son passé. En passant par la petite fille qu’elle était, en enregistrant et en réactivant cette mémoire vive, je me situe à l’endroit d’une parole essentielle qui puise à même la source.
Dans ce travail, je ne cherche pas une parole raisonnée (l’idée n’est pas de faire parler la bibliothèque, ni de faire du théâtre). Je cherche, plutôt, une parole fragile qui ferait entendre sa voix au cœur de ce qu’elle a de plus intime et de plus essentiel à dire.

Mygale, 2012.
Photos : Rodolphe Gonzales & Alexandre Pilon-Guay, permission de l’artiste

Ne plus jouer ?
KM : Dans Mygale, Peter James semble ne pas jouer, ne plus jouer, s’arrêter de jouer. À travers cette espèce de présence à l’état brut, sans projection, le moindre (micro)mouvement prend une dimension incroyable. Par exemple : se tenir debout sur scène de manière naturelle. Quand Peter se tient debout, de dos, surgit alors cette sensation, quasi sublime, d’avoir l’impression de ne pas être là (alors qu’on est pourtant au théâtre…). J’aime voir des gens debout sur scène comme on est debout dans la vie, sans raidir le dos, ni gainer les muscles, sans « neutraliser » sa posture à la manière du danseur contemporain typique qui – le pire – le fait presque naturellement tellement il a été « formaté ». Cependant… Peut-on réellement mettre sur scène des personnes telles qu’elles sont sans qu’elles deviennent, fatalement, des « personnages » ? Est-ce que le simple fait d’être sur une scène ne travestit pas la présence ? Est-ce là la projection de mon propre fantasme de spectatrice ? D’où, peut-être, le comble du théâtre et la limite (ou le jeu) entre le vrai et le faux, entre l’effet de réel et le crédible.
Maladie
NC : J’ai une tendresse particulière pour Mygale. Pour moi, cette pièce agit en rupture avec mes pièces précédentes. Ou dans la continuité, c’est selon. Elle va (je pense) plus loin, plus profondément dans l’intime. D’une façon plus radicale, plus sèche. Je trouve qu’elle me ressemble. D’une certaine manière, je suis heureux que cette pièce divise. Avec Mygale, j’ai franchi la limite. Ma limite. Je me suis positionné à un endroit inédit chez moi jusqu’alors : ne pas chercher à être aimé. Je pense que chacune de mes pièces est un échec. C’est ce qui rend le travail passionnant. Fragile. Délicat. Et fort.
À un moment donné, il faut faire le deuil du public (de ses attentes – de son regard). Pour oser plonger. Cette chose imparfaite que je crée et que l’on appelle un spectacle, je la vois comme une maladie. Et cette maladie ne demande pas la permission de vivre. Elle prend la place qui lui est nécessaire. Elle agit en réaction à son environnement. Chaque maladie est selon moi une réaction à un manque d’amour. Et si l’on peut dire la même chose d’un spectacle, je trouve que c’est une formidable vision poétique qui s’ouvre à nous.