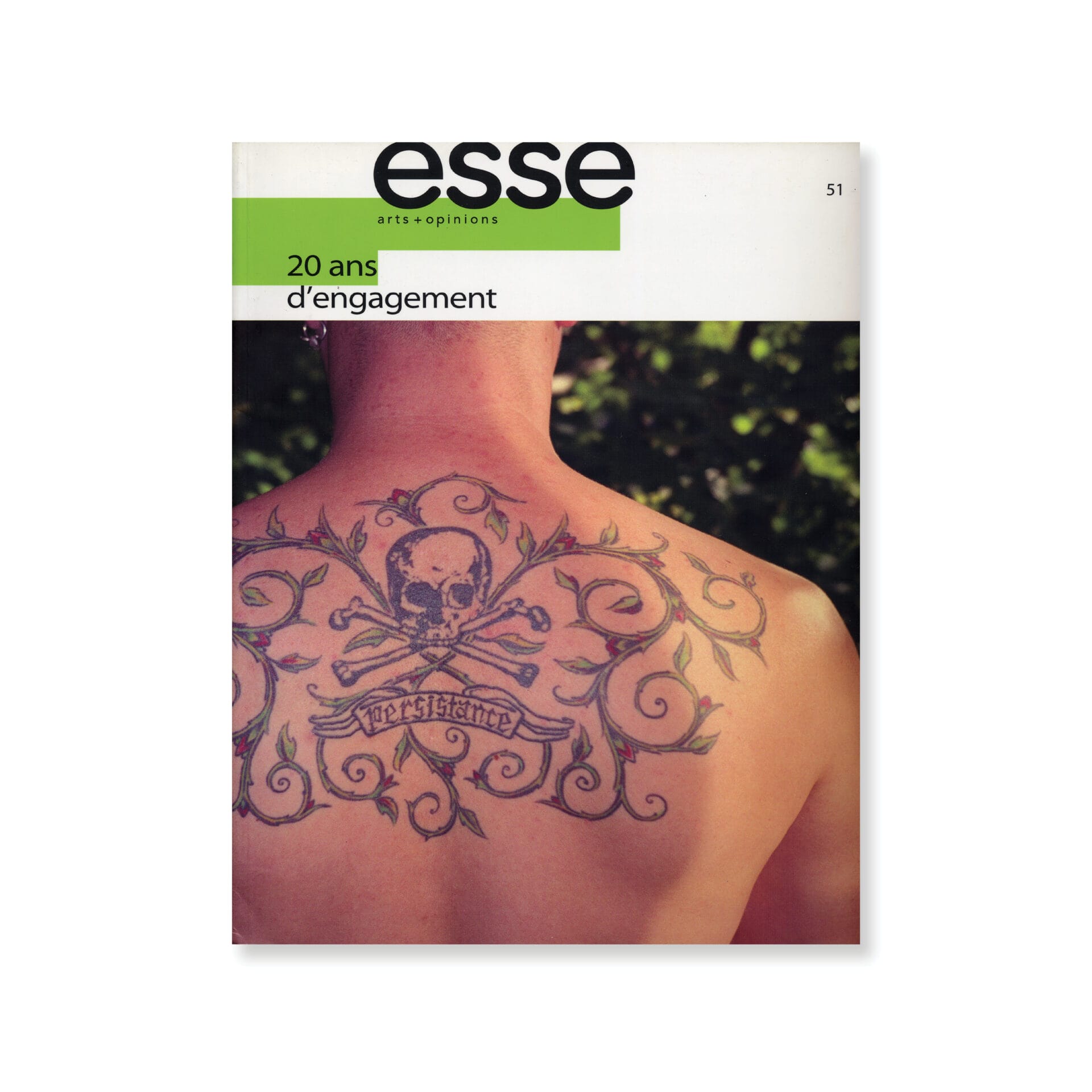Les arts communautaires sont avant tout art des relations. Dans un contexte communautaire, le rapport entre l’inspiration de l’artiste et son application se construit à partir d’une interrelation avec les croyances, les pensées, les opinions, les actions et les compétences des autres personnes en jeu. Le travail de collaboration exige des artistes qu’ils soient prêts à établir une relation d’interdépendance – afin d’être en mesure d’assurer une présence intègre auprès de la communauté et dans le cadre du processus d’art communautaire. C’est là un engagement de taille.
Le texte qui suit est la transcription d’une conversation qui a eu lieu en décembre 2003 par courrier électronique entre les deux auteures. La discussion partait d’un désir d’acquérir une compréhension plus profonde des complexités, des contradictions et des engagements liés à l’art communautaire. Elle se veut un point de départ, un moyen d’entreprendre ce qui constitue de toute évidence une vaste exploration théorique, et soulève des questions auxquelles nous n’avons pas encore apporté toutes les réponses.
C. Alexander-Stevens – Quand je pense aux arts communautaires, les premières questions qui me viennent à l’esprit portent sur le rôle – ou la position – des artistes ainsi que sur leurs responsabilités. En tant qu’historienne de l’art, je suis d’avis que la conception occidentale moderne de l’artiste, selon laquelle celui-ci serait un génie singulier évoluant en quelque sorte en retrait de la société, ne peut s’appliquer ici. Comme tu le sais, les artistes communautaires ne travaillent pas dans l’isolement, et je dirais même que plus la collaboration entre l’artiste et la communauté est grande, plus les projets entrepris sont réussis. Je crois que nous devons élaborer une façon différente de concevoir tant le rôle de l’artiste que celui de l’art lui-même – au moyen d’un vocabulaire propre aux arts communautaires.
D. Neumark – Selon moi, lors de la clarification de ce vocabulaire, nous devrions nous demander ce que nous voulons dire par réussite et examiner les différences entre collaborateur, participant et auditoire.
C. A.-S. – En effet. De plus, je crois que ces éléments concernent des questions relatives à l’esthétique de l’art communautaire et à la notion d’évaluation. Comment évalue-t-on les impacts esthétiques, affectifs et éthiques de ce type d’art ? Qui devrait en faire l’évaluation, et comment cette évaluation pourrait-elle alimenter les démarches ultérieures ?
D. N. – J’ajouterais ici qu’il est nécessaire, lors de cette évaluation, de faire la distinction entre les intentions, les objectifs et les résultats, tout en gardant à l’esprit que ces trois éléments peuvent être différents pour l’artiste, l’organisation communautaire et chacun des participants issus de la communauté. Comment peut-on évaluer ces différences et y faire honneur ?
C. A.-S. – La prochaine question, qui n’est pas sans lien avec tout ça, et sur laquelle tu as certainement des choses à dire, porte sur la formation requise des artistes qui évoluent dans des contextes communautaires. Ce type de travail exige des compétences particulières, qui ne sont pas nécessairement faciles à acquérir et qui, à l’heure actuelle, ne sont pas enseignées dans le cadre de la plupart des programmes d’études en art. Pour être franche, je dois même poser la question suivante : «Peut-on enseigner à quelqu’un à être un “artiste communautaire” ?» Je fais surtout référence ici à la complexité de l’éthique des arts communautaires. Les relations interpersonnelles et intrapsychiques avec lesquelles il faut composer au cours d’un projet en arts communautaires sont parfois complexes, imprévisibles, et peuvent même avoir des effets néfastes si on ne les aborde pas avec le plus grand soin.
D. N. – Je suis d’accord avec toi sur la nécessité de se pencher sur la question de la formation. Toutefois, mis à part l’amélioration et le perfectionnement des compétences, ce qui nous vient à l’esprit, c’est à quel point les artistes, dans le cadre de leur pratique, influent sur les projets d’arts communautaires de façon déséquilibrée, inadéquate et peut-être aussi contre-productive pour la communauté. Pour la plupart, les artistes travaillant en collaboration au sein d’une communauté à la création d’œuvres d’art ne font pas partie de ladite communauté. Ils ont beau procéder à des recherches approfondies et prendre part à des activités communautaires afin d’arriver à connaître les participants au projet, leur engagement et leur investissement sont généralement différents de ceux des membres de la communauté, et les projets n’ont pas les mêmes conséquences sur eux. De plus, j’ai remarqué que, dans bien des cas, les artistes prennent des décisions (seuls ou conjointement avec les organisateurs des groupes communautaires) sur la nature et la forme du projet en fonction de leurs seuls intérêts. Les membres des groupes communautaires ne participent habituellement pas au processus de prise de décision et ne sont consultés que lorsque toutes les décisions importantes ont déjà été prises. Il ne leur reste alors qu’à décider s’ils participent ou non aux projets, lesquels sont souvent conçus pour répondre à des besoins qui ne correspondent pas réellement à leur situation particulière.
C. A.-S. – Ces remarques lourdes de sens soulèvent quelques autres considérations fondamentales. L’art communautaire est-il au service de la communauté ? Un projet en art communautaire peut-il répondre aux besoins d’un organisme communautaire et non pas à ceux des participants, et vice versa ? Peut-être faudrait-il réfléchir à ces questions à la fois de façon théorique et à partir d’une évaluation au cas par cas des différents projets. Comment peut-on concevoir et élaborer des projets de façon à répondre le mieux possible aux besoins de la communauté (tant ceux des organisateurs que ceux des participants) ? Ces préoccupations nous amènent à une question complexe, celle du financement. Je me demande s’il est avantageux de confier l’argent à la communauté, pour qu’elle «engage» par la suite un artiste. Cette façon de procéder installe un rapport de pouvoir, probablement pour faire en sorte que les responsables du projet soient tenus de rendre des comptes.
D. N. – Cette situation est également attribuable au fait que les organismes de financement appliquent certaines normes bien précises en matière de professionnalisme. À mesure qu’augmente le nombre de projets en arts communautaires qu’ils subventionnent, ces organismes tentent de maintenir les définitions et les règlements qui leur servent à déterminer qui sont les artistes qualifiés.
C. A.-S. – Mais cette façon de faire n’est-elle pas trop tyrannique, compte tenu de l’énorme différence entre les arts communautaires fondés sur la collaboration et les autres formes de pratique artistique ? Encore une fois, on retrouve cette tension entre, d’une part, la collaboration et la nécessité de répondre aux besoins de la communauté, et, d’autre part, la liberté esthétique de l’artiste. Toutefois, l’importance que l’on attribue au contrôle esthétique est peut-être conditionnée par la formation de type moderniste qu’ont reçue artistes et historiens de l’art. Hélas, comment peut-on rééduquer les artistes et les historiens de l’art, sans parler du grand public et des organismes de financement – qui ont des idées bien arrêtées sur ce qui est de l’art et ce qui n’en est pas, ainsi que sur qui est un artiste et qui ne l’est pas –, pour qu’ils arrivent à voir les arts communautaires comme quelque chose de complètement différent ?
D. N. – D’une certaine façon, cela touche au cœur de notre questionnement quant au type de formation nécessaire pour que les artistes soient en mesure de travailler efficacement en contexte communautaire. De plus, cela nous incite à nous interroger sur ce que sont ou pourraient être les limites de la responsabilité et de l’obligation de rendre des comptes d’un artiste dans ce contexte. Quels rôles les artistes jouent-ils dans cette société corporatiste postmoderne lorsqu’ils délaissent la production d’œuvres et adoptent un rôle qui, dans d’autres cultures et à d’autres époques, était considéré comme relevant à la fois du chaman, du visionnaire et du sacré ? L’essor récent des arts communautaires reflète-t-il la recherche, de la part des artistes, d’un rôle plus intégré et plus substantiel en tant que producteurs de sens ?
C. A.-S. – Au risque d’être cynique, je dirais que si, pour certains artistes, cela reflète un désir de produire des œuvres (et d’adopter une méthode de travail) qui soient plus intégrées socialement à la communauté et qui en fassent davantage partie, je ne crois pas que nous puissions supposer qu’il s’agisse là d’une motivation universelle. Je suis néanmoins avis qu’il est essentiel, pour les artistes participant à des projets d’art communautaire, d’être très clairs en ce qui a trait à leurs motivations. Qu’est-ce qui, dans ce type de pratique, répond à leurs besoins professionnels ? Quelles sont les dynamiques qui, au sein de la communauté, ont pour eux une résonance particulière ? En omettant de reconnaître et d’examiner ces questions, on crée une situation de paternalisme et on nuit à l’intégrité et à l’honnêteté de la démarche, augmentant d’autant plus le risque de causer du tort aux participants.
D. N. – Cette préoccupation quant au tort qui peut être causé (même par inadvertance) dans le cadre d’un projet en arts communautaires est une question à laquelle je réfléchis depuis un bon bout de temps. Cependant, je pourrais demander en quoi cette situation diffère de celle d’un cinéaste ou d’un écrivain dont le travail suscite une réaction chez l’auditoire. Je pense ici à ma propre expérience avec le film Festen (Thomas Vinterberg, 1998). Quand j’ai vu ce film pour la première fois, il a provoqué chez moi une réaction émotionnelle et physique dont j’ai mis des semaines, voire des mois, à me remettre. Pendant tout ce temps, je me répétais à quel point il était irresponsable, de la part du cinéaste, d’avoir fait un film pouvant causer une telle réaction. Mais à mesure que j’arrivais à exprimer certaines des émotions jusque-là réprimées dont ce film m’avait fait prendre conscience, j’ai peu à peu cessé de rager contre le cinéaste et j’ai même commencé à éprouver une certaine gratitude envers sa vision et la façon dont elle était transmise. Ce film m’a donné l’occasion de guérir de vieilles blessures si profondément enfouies que seul l’art pouvait arriver à les toucher. Le cinéaste aurait-il dû fournir à tous les spectateurs une liste de services de thérapie ainsi qu’une note d’encouragement ? Je mentionne cet exemple parce que, souvent, ce qui apparaît à prime abord comme une situation désavantageuse (ou pire) se révèle en bout de ligne un véritable cadeau, une possibilité de guérison. Et n’est-ce pas pour cela qu’il existe des professionnels auxquels nous pouvons faire appel, et que nous avons recours à divers réseaux de soutien amical, spirituel et familial ?
C. A.-S. – Voilà où les questions que tu as posées relativement à la différence entre auditoire, participant et collaborateur prennent selon moi tout leur sens. Ma mise en garde et ma croyance en la nécessité de procéder avec prudence tient à la différence entre le fait d’être un spectateur possédant un certain degré de choix, et la relation entre un artiste et un participant collaborateur dans le cadre d’un projet d’art communautaire, qui est marquée par un écart de pouvoir généralement beaucoup plus vaste. Ici, l’usage euphémique ou du moins la grande ambiguïté du terme communauté doit être mis en relief : quelle est la nature de la communauté et comment se négocie son rapport au projet et à l’artiste ? Comment le pouvoir, les connaissances et les compétences sont-ils négociés et partagés entre tous et toutes à l’intérieur du projet ?
D. N. – Oui, c’est en particulier pour ces raisons qu’il est vital pour les artistes d’avoir une idée de ce à quoi ils s’exposent émotionnellement et psychologiquement lorsqu’ils entreprennent un travail de collaboration en communauté. Il arrive fréquemment que les membres des groupes communautaires qui sont invités à collaborer à un projet se perçoivent comme les victimes d’une sorte d’injustice. Souvent, une faible estime de soi peut influer sur la façon dont ils entrent en rapport avec eux-mêmes et avec les autres. Les dynamiques de groupes sont souvent délicates. Ces questions ne doivent pas être négligées.
C. A.-S. – En t’écoutant parler, je me demande si ces questions sont même abordées lors du processus d’établissement des politiques de financement. Dans notre situation actuelle, au Québec et au Canada, où de nouveaux montants sont alloués aux artistes pour des projets de collaboration, comment sont définis les termes «art», «artiste» et «communauté» dans le cadre des politiques culturelles ? Qui établit ces définitions ? Et, ce qui est peut-être plus important, si de telles définitions sont établies, quel est leur effet potentiel sur la pratique des arts communautaires ? Je crois que cette pratique n’est pas un phénomène «nouveau», mais que c’est plutôt sa sanction récente qui l’est. Pourquoi maintenant ? Que demande-t-on aux artistes de faire, maintenant qu’ils bénéficient de cet incitatif financier ? Pour moi, il s’agit d’une zone potentiellement dangereuse. Je ne veux pas dire que les arts communautaires ne devraient pas bénéficier de subventions, mais il reste que je m’inquiète de la façon dont ils seront définis dans le cadre des politiques de financement. De plus, je crois qu’en ce qui a trait au rôle que pourrait jouer ce type d’art, il est extrêmement néfaste d’avoir des attentes qui seraient irréalistes et mal adaptées aux capacités actuelles de la pratique artistique de collaboration.
D. N. – De même, lorsque nous nous interrogeons sur les politiques et le financement, nous devons examiner ce qu’on écrit sur les pratiques d’art communautaire et comment ces pratiques sont comprises dans la sphère culturelle plus large. Comme tu l’as fait remarquer fort pertinemment, l’esthétique collective est très différente de l’esthétique normative moderniste et même postmoderne. Il est fascinant d’avoir ce type de conversation avec une historienne de l’art, compte tenu du fait qu’une grande partie des points de vue qui sont constitués et disséminés après-coup le sont par ta profession. Même si un nombre grandissant d’artistes s’intéressent à ce qu’on écrit sur leur travail et à la façon dont on le met en contexte, il faut reconnaître les limites de l’artiste à ce chapitre. Encore une fois, je dois insister sur l’importance vitale des relations. Dans le cas qui nous occupe, comment la relation entre l’historienne et son sujet influera-t-elle sur la façon dont l’histoire sera écrite, et même la déterminera ?
C. A.-S. – Je crois fermement que les historiens (de l’art ou autres) influent sur leur sujet de la même façon que les artistes façonnent leurs œuvres. Comme tu l’as fait remarquer avec raison, l’histoire détermine ce que nous savons sur un sujet donné. Ce qui est parfois perdu ou caché en cours de route, toutefois, est la nature subjective de toutes les histoires. On confère une grande autorité aux textes d’auteurs.
D. N. – Je suis consciente de la tentation que j’éprouve à citer des textes et des sources, comme si ce que j’écrivais n’était pas suffisamment légitime et nécessitait des références aux écrits et aux travaux d’autres personnes. Je ne sais pas comment réagir à cela autrement qu’en le verbalisant et en partageant mes craintes avec toi.
C. A.-S. – Dans le cadre de la présente discussion, qui vise à poser un certain nombre de questions, il vaudrait mieux résister au besoin de renforcer nos propres idées avec celles des autres, comme pour en «prouver» la validité. Ce que nous faisons présentement, tel que je le comprends, consiste à soulever des questions et à ouvrir un espace de réflexion, d’analyse et de dialogue. Dans ce contexte, le fait de sanctionner d’autres autorités reviendrait à commencer à répondre, ou à mettre fin au dialogue. Il faut résister, pour le moment, à l’envie de trouver des solutions.