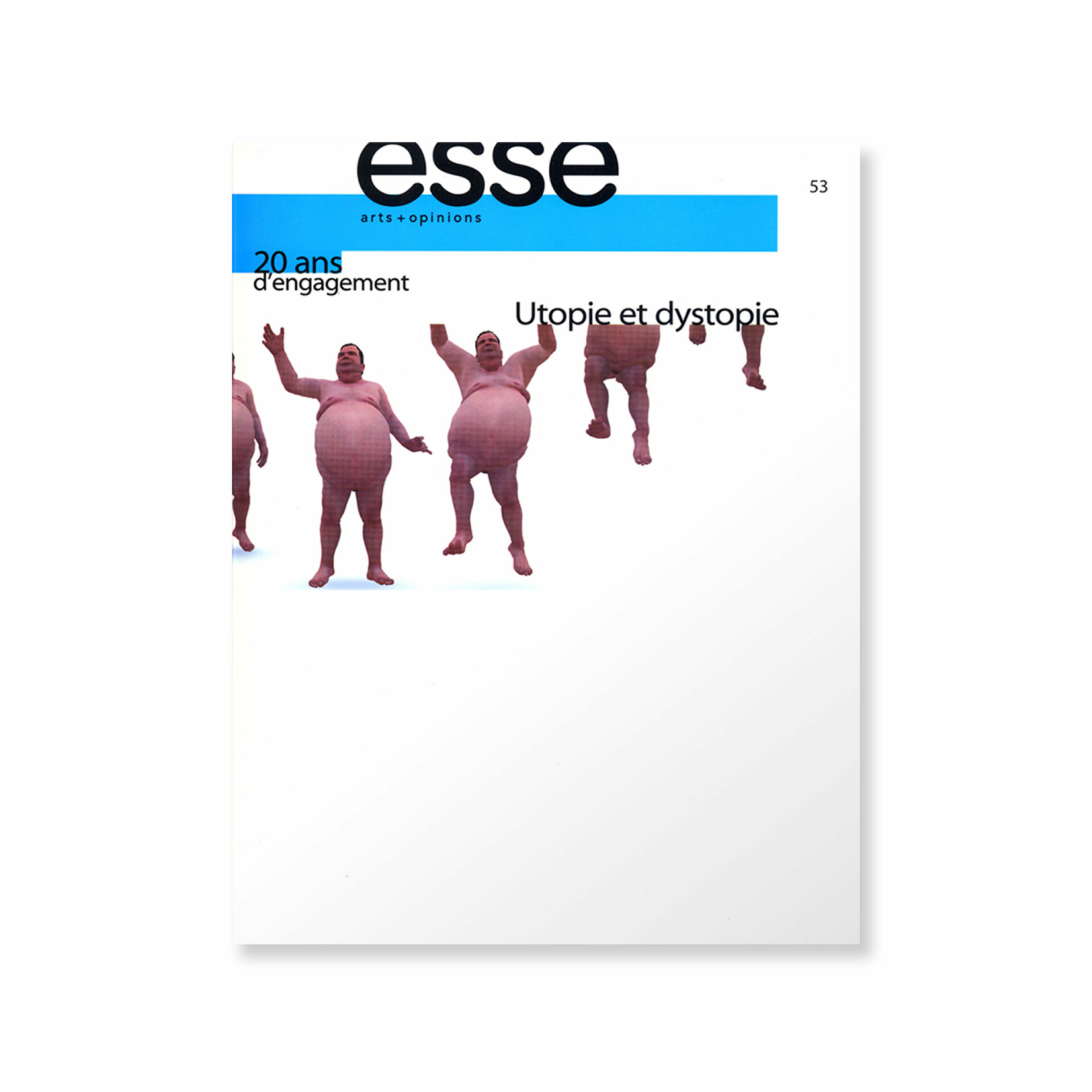[In French]
Le Festival de théâtre de rue de Shawinigan (FTRS)1 1 - Présenté du 30 juillet au 1er août 2004. a, cette année, bel et bien investi la filière des arts visuels tels qu’on les connaît aujourd’hui sous les modalités de l’installation, de l’action et de l’intervention urbaine. Pour quiconque a suivi le festival ces dernières années, l’intégration de disciplines connexes – on ose à peine, dans ce cas, les réduire à une unité tant l’idée de discipline est ici remise en cause – se tramait depuis un temps et n’avait rien pour surprendre.
Le festival, qui cherche d’abord à faire descendre l’art dans la rue, à le voir apparaître sous ses diverses inflexions urbaines, quelles qu’elles soient, a vu juste en intégrant des pratiques issues des arts visuels qui ont fait leur preuve à ce chapitre. D’autant plus que, cette année, le thème retenu, « les États d’habiter », faisait appel au brouillage des frontières entre les territoires domestique et urbain, un sujet maintes fois exploré dans les arts visuels. La question était de savoir si le contexte festivalier convenait à ces stratégies artistiques – dont les compétences dans la rue s’affirment souvent sous la forme d’insertion –, dans un théâtre urbain engagé dans le quotidien ordinaire.
L’Abri sur roue d’Anne-Marie Ouellet, par exemple, a un peu souffert de ces conditions de présentation. L’enveloppe de coton (que l’artiste déployait autour d’elle à l’occasion et à différents endroits sur le site en guise de gîte temporaire) a été pensée initialement pour matérialiser une frontière détonant avec le va-et-vient des passants. Or, sur la 5e avenue à Shawinigan, zonée pour le festival, la foule attendait la « manœuvre », espérant quelque part le divertissement que réserve habituellement les amuseurs de rue. Malgré ce manque, disons, d’aiguillage, on doit reconnaître l’effort des organisateurs d’avoir su intégrer de jeunes pratiques, faisant de l’événement une occasion de diffusion supplémentaire et un lieu propice à la découverte. On espère revoir bientôt le travail de Ouellet qui semble présenter une avenue stimulante de réflexion sur la perméabilité des frontières.
La plupart des autres concepteurs de projets anticipaient des spectateurs avisés, mais ils ont dû composer avec une autre difficulté. En effet, la foule s’est avérée imposante, surtout le premier soir, obligeant certains des artistes participant à revoir leur numéro, ce qui, sans modifier le fondement des stratégies impliquées, a néanmoins provoqué des modifications de surface, par exemple dans le jeu des acteurs ou des figurants et dans la fréquence des prestations. Ainsi, pour ces artistes habitués à une adresse publique ouverte – en opérant dans le «réel» et en dehors des lieux consacrés à l’art –, le problème de la masse induite par le festival était nouveau.
Aussi, plusieurs visiteurs ont patiemment défilé par petits groupes devant les Petites détresses humaines et d’autres maux de Catherine Sylvain qui réactivait judicieusement le genre du tableau vivant. Chacune des scènes composées à même un appartement vétuste jadis occupé par des bureaux faisait ressortir un mal contemporain rattaché au monde du travail. Les vêtements-prothèses exhibés par les figurantes révélaient une économie du corps féminin réglée par les gestes répétitifs et réduits à l’absurdité. Devant céder la place à d’autres, on regrettait de ne pas pouvoir s’attarder plus longuement devant la minutie du travail et de ne pas pouvoir circuler à sa guise dans cet univers aux effets étouffants, quoique l’empressement demandé aux visiteurs soulignait à sa façon le voyeurisme implicite à l’ensemble du dispositif (porte rapidement refermée sur les scènes).
Le cinéma Roxy, où avait lieu la prestation vitriolique des Fermières obsédées, favorisait le rassemblement tout en exacerbant la distanciation scénique pour interroger la notion de spectacle. La messe occulte animée de musique pop du collectif de Québec exhibait des corps grotesques, perruques en bataille, tenues d’écolières débraillées et corps violemment enduits de peinture, provoquant la division dans l’assemblée, les uns jubilants, les autres offensés. La manière exaltée des fermières, dansant de façon débridée, a fait blêmir quelques parents qui ont vu leur jeune fille contribuer au spectacle dans une chorégraphie bien montée, mais volontairement déchaînée. On devine que les participantes, dans le coup avant le début du festival, resteront marquées par l’expérience qui visait à miner les tabous (contorsion des corps, dévoiement des tenues) et à critiquer les codes féminins par la mascarade. Il faut dire que le FTRS continue à faire sa marque en engageant une complicité en profondeur avec la population de Shawinigan appelée à s’impliquer dans la réalisation même des projets plutôt que d’être confinée au rôle de spectateur passif.
Mais c’est en dehors de ces espaces clos, circonscrits par des limites physiques, que des situations inattendues s’affirmaient, cette fois provoquées par la proximité entre les artistes participants, nombreux comme toujours au FTRS à s’accaparer la rue. Et c’est sur ce plan sans aucun doute que s’éprouvait de façon critique ce « renversement des sens » proposé par le programme du festival qui souhaitait mettre fin à l’« état d’être seul ». Au-delà du divertissement à offrir au visiteur pour les extirper de leur confort domestique, c’est la concomitance des projets artistiques et leur possible contamination qui s’avéraient plus difficiles à gérer, car là aussi il était question de percer les insularités.
Après une réaction frileuse exprimée par un des comédiens lors de la table ronde organisée le samedi après-midi, Les Urbanologues associés (France), ont finalement joué de cette proximité avec les autres performeurs; alors que les deux comédiens évoluaient lentement sur la main en arpentant la façade des commerces, leur dialogue a tenu compte des autres numéros en cours plutôt que de les ignorer. La présence plus sobre de Christian Messier (il a occupé une boîte de carton pendant des heures) avait tout lieu de passer inaperçue à travers ce fatras d’activités. Il fallait s’approcher pour constater que l’objet rudimentaire était possiblement habité depuis longtemps et que la fente striée aménagée en guise d’ouverture laissant échapper un peu de chaleur, trouvait dans le titre de l’œuvre, Fournaise, tout son sens.
À côté de ce dispositif sommaire, l’installation de Mario Duschesneau ne manquait pas d’à propos. Sur toute la façade du stationnement étagé en béton s’accrochait une quantité effarante de vêtements, comme autant de dépouilles vidées de leur chair. Par accumulation, une stratégie chère à l’artiste, les vêtements revêtaient la morne structure d’une peau colorée, abri de fortune magistral qui ramenait l’idée de collectivité à l’unité domestique en plus de mimer en négatif la «meute» qui s’affairait tout autour. Il fallait voir aussi, dans la ruelle qui donnait derrière, un bâtiment à logements où par les nombreuses fenêtres débordaient d’autres vêtements, la structure servant cette fois de contenant à la multitude de tissus. L’image ici était plus sombre, suggérant l’entassement humain, le manque d’espace et la suffocation.
Moins visible depuis l’aire du Festival, cette autre partie du projet de Duscheneau pouvait être rencontrée par hasard ou dans la foulée des pas que proposait d’accomplir Bienvenue à d’Olivier Choinière de ARGGL!. Adoptant la formule pédestre déjà expérimentée lors de la dernière édition du FTRS, cette nouvelle mouture de Choinière poussait plus à fond le registre du récit auditif en brisant sa trame linéaire. Pensée sous forme d’une visite guidée dans une ville fictive, la ballade écrite à la deuxième personne du pluriel multipliait les occasions de dérouter le participant. Sous les pas du piéton, la ville perdait son caractère réel, s’effaçait derrière des scènes moins rassurantes que le récit (amorcé dans une agence de voyages et appelé à ne jamais aboutir) construisait avec éloquence. En voulant emprunter au rêve sa texture, faite d’ellipses, d’allers-retours, d’accumulation de détails et de rencontres incongrues, en voulant esquisser le dédale fantasmatique ou cauchemardesque que les portes entrouvertes de l’inconscient laissent deviner, Choinière a composé une histoire qui avait moins pour objet de commenter la ville, que de cartographier l’introspection du personnage, suggérant par là que le récit de soi est le site sans doute le moins connu et peut-être à retrouver. Mais la densité du récit n’était pas toujours aisée à assimiler alors qu’il fallait marcher dans la ville, la saturation des informations faisant parfois perdre le fil. Cela explique peut-être les corrections apportées dès le deuxième soir du festival. En plus des silences et des pauses insérés dans la trame audio, le participant pouvait faire une halte dans un appartement abandonné où un casse-tête s’étalait en morceaux, lieu de répit et de « recomposition ». D’autres projets ont dû subir des ajustements traduisant moins un état d’improvisation qu’un esprit de fraîcheur qui fait du Festival un terrain d’expérimentation audacieux où les risques ne sont pas écartés. C’est dans cette perspective aussi qu’il fallait voir les tracas techniques auxquels ont dû faire face certains artistes. C’était le cas notamment de Florent Cousineau qui proposait, dans une des ruelles, une traversée sous une fine pluie artificielle que les ombrelles mises à disposition protégeaient illusoirement. La lumière électrique le soir donnait à l’élément aqueux des effets mirifiques et cette salle d’eau transposée en plein inspirait la contemplation. Même le propriétaire du bâtiment qui a vu son plafond abîmé par le dispositif et son jet d’eau qui était fixé au-dessus de son toit s’est plié au jeu, comme quoi la complicité était de mise.
Les contributions de Cooke/Sasseville, Martin Renaud et Dominique Zinkpé (Bénin) amenaient aussi à tirer un bilan positif de cette édition où il était impossible de s’ennuyer. L’installation La famille élargie de Cooke/Sasseville commentait de façon sibylline et humoristique la maternité tandis que Renaud et Zinkpé déployaient leur présence au-delà du site. Le premier avec ses souliers de styles variés qu’il avait fixés au sol traduisait la diversité des individus alors que le second promenait son taxi aux couleurs de l’Afrique dans les rues de la ville, proposant au passant d’embarquer à bord pour mieux explorer les vidéos et les images que le véhicule contenait.
On saluera également l’initiative des organisateurs d’avoir pensé deux moments de rencontres entre les artistes issus du théâtre et des arts visuels, favorisant ainsi des échanges encore trop rares entre les différentes disciplines. Ces moments de discussion, animés par Guy Sioui Durand les samedi et dimanche après-midi, s’ajoutaient aux échanges autrement moins formels habituellement tenus à l’incontournable buvette du Cochon souriant. Par conséquent, il y a tout lieu de penser que ces démarches plus sérieuses visant à réfléchir à la fois sur le thème de l’édition et sur la nature de l’événement, quant à sa pertinence dans le paysage culturel québécois et ses retombées sur la consolidation d’un art de la rue qui n’est pas limité à des considérations commerciales, porteront fruits. En somme, le Festival continue de donner d’importants signes de vitalité, et cette dernière édition aura montré la capacité des pratiques des arts visuels à s’insérer dans ce contexte grâce à leur flexibilité et leur fine compréhension de l’espace public.