Danièle Méaux
Photographie contemporaine et anthropocène
Filigranes Éditions (coll. Essai)
Landebaëron, 2022, 288 p.
Landebaëron, 2022, 288 p.
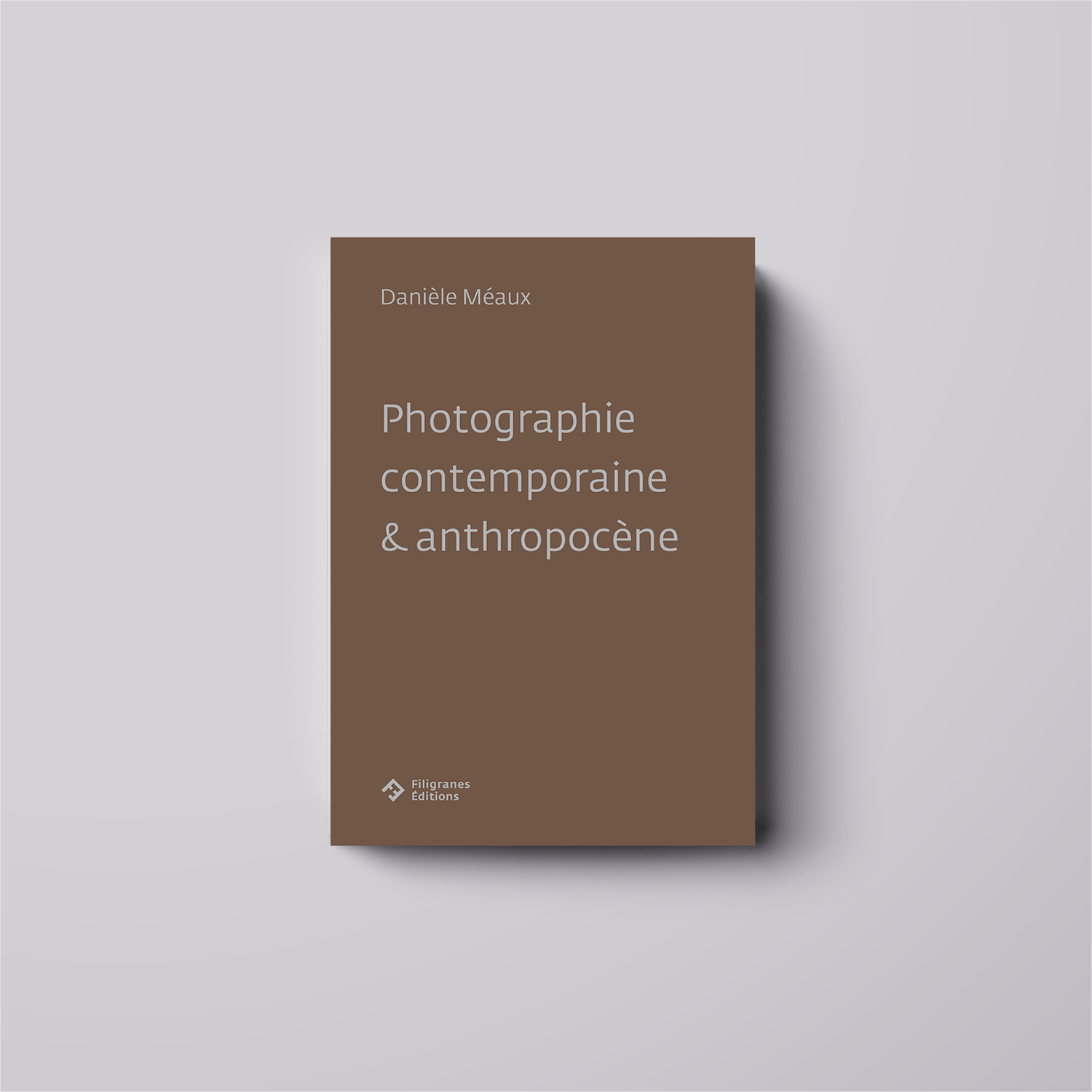
Photo : permission de Filigranes Éditions
Filigranes Éditions (coll. Essai)
Landebaëron, 2022, 288 p.
Landebaëron, 2022, 288 p.
Dans la continuité de ses précédents ouvrages (Enquêtes : Nouvelles formes de photographie documentaire, Filigranes, 2019, ou encore Géo-Photographies : Une approche renouvelée des territoires, Filigranes, 2017), Danièle Méaux, professeure d’esthétique et sciences de l’art à l’Université Jean Monnet de Saint-Étienne, poursuit ses recherches sur le potentiel euristique et « transitif » de la photographie contemporaine.
Son dernier livre, intitulé Photographie contemporaine et anthropocène, se concentre sur l’étude de différentes œuvres de photographes engagés dans une réflexion critique sur l’anthropocène. Popularisé dans les années 2000 par le météorologue et chimiste de l’atmosphère Paul Crutzen, ce terme désigne la nouvelle époque géologique dans laquelle nous sommes entré·es, qui se caractérise par l’impact irréversible et profond des activités humaines et industrielles sur l’écosystème terrestre.
Créez-vous un compte gratuit ou connectez-vous pour lire la rubrique complète !
Mon Compte


