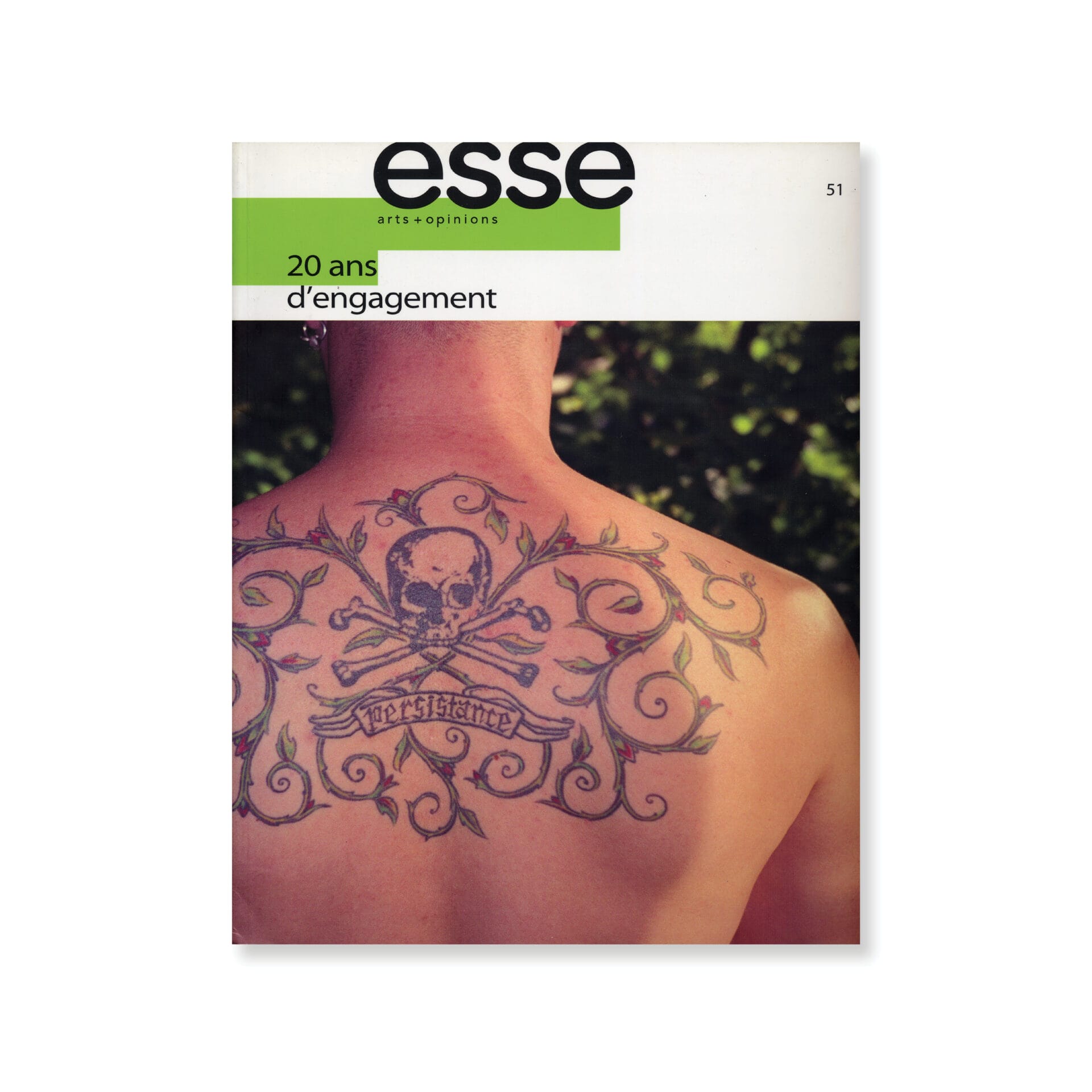Les dommages collatéraux de Patrice Duhamel, Espace Virtuel, Chicoutimi, octobre 2003.
Installation composée de deux vidéos et d’une série de dessins, l’œuvre de Patrice Duhamel porte sur les perturbations, infimes ou considérables, avec lesquelles l’image contemporaine compose son inachèvement assumé. Car ces accidents qui la travaillent – on pense au clinamen de Lucrèce et à la postérité que lui a donnée la «Pataphysique» – la font basculer presque insensiblement dans l’incomplétude, un certain aléatoire et donc une sorte de futur (plus exactement un futur antérieur), qu’il appartient sans doute au spectateur de faire advenir. Ainsi se met en scène une œuvre ouverte, mais qui, fort heureusement, n’a pas grand chose à voir avec la prétendue interactivité dont le discours commercial a contaminé certaines pratiques artistiques un brin démagogiques.
Ici, loin des offres faciles d’intervention anodine faites à quelque spectateur à peine concerné – combien d’installations contemporaines se contentent de cette «ouverture» rudimentaire et, somme toute, méprisante ! –, un dispositif très concerté «tient» en quelque sorte cette véritable ligne de fuite signifiante dans une armature que l’on pourrait qualifier de rhétorique, dans la mesure où elle compose manifestement un discours : les deux vidéos sont placées de telle façon qu’elles croisent la procession en pointillé des dessins, laquelle d’ailleurs s’étend sur deux murs formant angle et se répercute sur une peinture gigantesque tracée directement sur le mur d’en face. On devrait dire plutôt que la succession des dessins semble procéder de cette image hors échelle. Comme si cette figure humaine accroupie, sous-titrée he could not sing a song to save his life, donnait la légende de l’image, de toutes les images, en montrant leur possible origine. Cet homme bleu qui ne parviendrait pas à chanter, sa vie dut-elle en dépendre, s’inscrit, en effet, dans un registre de l’art impossible ou insuffisant. Façon discrète et légèrement ironique de ressortir du four l’éternelle tarte à la crème des rapports de l’art à la vie. Chanter, faire de l’art, n’ont jamais sauvé de vies, même si aucune vie ne peut se passer d’une quelconque pratique qui soit son équivalent. Mais aussi bien, ce n’est pas de ça qu’il s’agit.
Car si l’art de Patrice Duhamel est engagé, ce n’est pas dans ce chemin naïf, à une époque où la naïveté est presque un crime. L’artiste travaille plutôt ce qu’il appelle la «situation», c’est-à-dire un rapport au monde à la fois exemplaire, car fait de probabilités «quotidiennes» universelles, et particulier, au point d’être spécifique, parce qu’un accident quelconque vient toujours rendre l’image improbable. Toute situation est aussi, plus fondamentalement, et comme le mot l’indique, une sorte de concentré, de précipité d’espace-temps. Les capsules narratives que forment les dessins s’articulent donc, sous cet angle, à la narrativité plus développée des bandes vidéos, et le rapport qu’entretiennent ces deux formes de situations visuelles n’est pas sans évoquer quelque story-board ou les dessins d’Eisenstein, par exemple, même s’il n’y a ici aucun rapport perceptible entre l’image fixe et les vues animées. Aucun rapport ? Peut-être au niveau de l’anecdote, mais thématiquement ou rhétoriquement, on peut penser que c’est le même principe de perturbation qui anime l’une et l’autre. Car les dessins eux-mêmes bougent, en quelque sorte, puisqu’ils représentent toujours un déséquilibre, un événement sur le point de se produire ou, au contraire, de se défaire, comme ce personnage casqué, en position de skieur en recherche de vitesse, mais placé sur une chaise; changé de contexte donc, «déplacé» dans toute la force du mot, tandis qu’une femme immobile à ses côtés semble observer, impassible, son dérisoire exploit. Et sur une bonne dizaine de dessins, des confettis multicolores viennent, tels des graffiti ou des tags qui joueraient la superposition, cacher une partie du dessin en prenant le plus souvent la forme d’une explosion figée, comme s’il s’agissait du jet aléatoire produit par quelque fêtard venu troubler une immobilité trop erratique. Quelque chose d’inquiétant se dégage parfois de la surimpression des confettis, comme dans ce dessin d’un mi-corps féminin dont la tête paraît éclater en gerbe rouge.
Cette logique de la superposition combinée au déplacement évoque irrésistiblement le fonctionnement du rêve et de l’imaginaire, tels que Freud a pu les penser. Il s’agit bien, d’ailleurs, de mettre en scène une sorte de psychopathologie de la vie quotidienne dont les effets ne seraient pas attribuables à l’inconscient de quelque sujet individuel mais plutôt à une sorte de malin génie expérimental produisant systématiquement des accidents ou des incongruités, «pour voir», ou plutôt pour déstabiliser le voir. Ces effets pervers, Duhamel préfère les nommer, allusion ironique au discours des militaires qui veulent cacher leurs gâchis sous des termes choisis, des «dommages collatéraux». La co-latéralité est, en effet, une forme de glissement, en principe non prémédité (mais nous savons tous à quel point les militaires peuvent être hypocrites), d’un événement qui vient atteindre un autre espace que celui où il devait survenir.
Mais les dommages collatéraux sont aussi ceux qui surviennent lors du travail de la variation. Car chacun des éléments qui composent les dessins, qu’il s’agisse d’un personnage, seul ou formant couple (l’homme bleu gigantesque, sur le mur, est flanqué d’une femme, dans les bruns, gigantesque elle aussi, bien que pas tout à fait à la même échelle), d’une partie de corps, tête ou mains par exemple (on pense ici à Escher et au célèbre dessin des mains en train de se dessiner elles-mêmes), ou encore d’un objet (un masque bien souvent), chacun des éléments étant susceptible de réapparaître ailleurs, déplacé, transformé même, parfois de diverses façons, y compris par changement d’échelle, mais reconnaissable.
Cette même logique du dérapage contrôlé, de la superposition déviante et de la mise en scène d’événements improbables, on la retrouve dans les deux bandes vidéos, titrées respectivement I don’t know what I want but I know how to get it (ou le paradoxe des moyens sans fin) et Shooting stars (ou l’ambiguïté d’un titre qui renvoie aussi bien à des vedettes du tir qu’aux étoiles filantes que dit le premier sens de l’expression anglaise). Mais là où le trait des dessins, précis comme celui des bandes dessinées évoque, par les situations qu’ils présentent, les grands inquiéteurs des années 1960 que furent Topor et Chaval, la narrativité moins ramassée de la vidéo propose de véritables sketchs, souvent fort drôles, parfois terriblement inquiétants, où, comme le dit fort justement l’artiste à propos non pas seulement de ces bandes mais de l’ensemble de l’exposition, «le principe de réalité se trouvant perdu, les personnages sont en position de rattrapage infini». Comme dans le cas de cette tache rouge («pas du sang, du rouge» disait Godard) qui apparaît brusquement dans la paume ou sur la jambe d’un personnage masculin et représente un des éléments majeurs de la variation qui travaille aussi les vidéos, tache rouge qui s’étend à l’occasion d’un grattage, de plus en plus frénétique, du personnage. Le même personnage sera d’ailleurs montré grattant un mur. C’est que la répétition d’une action quelconque forme l’un des principes d’organisation de ces images là où les dessins jouaient plutôt du collage. Mais de même que la superposition d’éléments suffisait à déstabiliser l’image du dessin, la répétition, ici, devient principe de déséquilibre situationnel, dans la mesure où l’habitude, même courte, qu’elle installe se trouve brisée par ces véritables événements que sont les effets aléatoires d’une même cause. Comme dans cette séquence où un personnage se plante un couteau dans le corps, en voit surgir des étincelles et, renouvelant l’opération, n’obtient le même résultat que de façon intermittente.
Si Patrice Duhamel parle, avec raison, de «modes d’emplois déréglés» à propos de l’«action» des dessins, on pourrait étendre cette formule à l’ensemble de l’exposition puisqu’elle prend un sens tout particulier quand on l’applique aux vidéos où, justement, il est fort souvent question d’outils, d’instruments ou d’objets dont le maniement s’avère difficultueux, périlleux ou, au contraire, parfaitement ludique.
Il s’agit toujours, en tout cas, de mettre en scène une réalité aisément reconnaissable mais dans laquelle on introduit un «jeu», non seulement au sens d’activité ludique mais surtout au sens de battement dans une structure ou un assemblage. Ainsi travaillée d’un système de failles qui lui donne un dynamisme d’étrangeté, l’image bascule dans un univers où tout semble possible. Un univers où l’imagination questionne le visible au nom de l’infinité d’hypothèses que recèle l’esprit humain.
L’art engagé, sous les diverses formes qu’il peut prendre, met en cause le plus souvent des rapports sociaux qu’il souligne ou dévoile mais qui de toute façon font indubitablement partie d’une réalité que chacun reconnaît finalement partager. Mais l’engagement est peut-être plus radical encore quand la pratique esthétique interroge la simple inscription de la figure humaine dans un environnement. Occuper un espace est en effet la première forme de socialité et le partager avec l’autre la première forme d’organisation sociale.
L’engagement de Patrice Duhamel consiste à réorganiser la donne, relancer encore et encore les dés pour bien montrer que voir est aussi un acte politique, au sens noble du mot – s’il en existe encore un. L’économie extrême des moyens qu’il utilise, loin de cette véritable éthique de l’effet mise de l’avant, parfois inconsciemment, par bien des jeunes artistes séduits par les sirènes des nouvelles technologies, fait surgir, dans toute sa nudité, imparable, inquiétante, mais drôle aussi, la vérité du questionnement. Comme une hypothèse sans cesse reconduite.