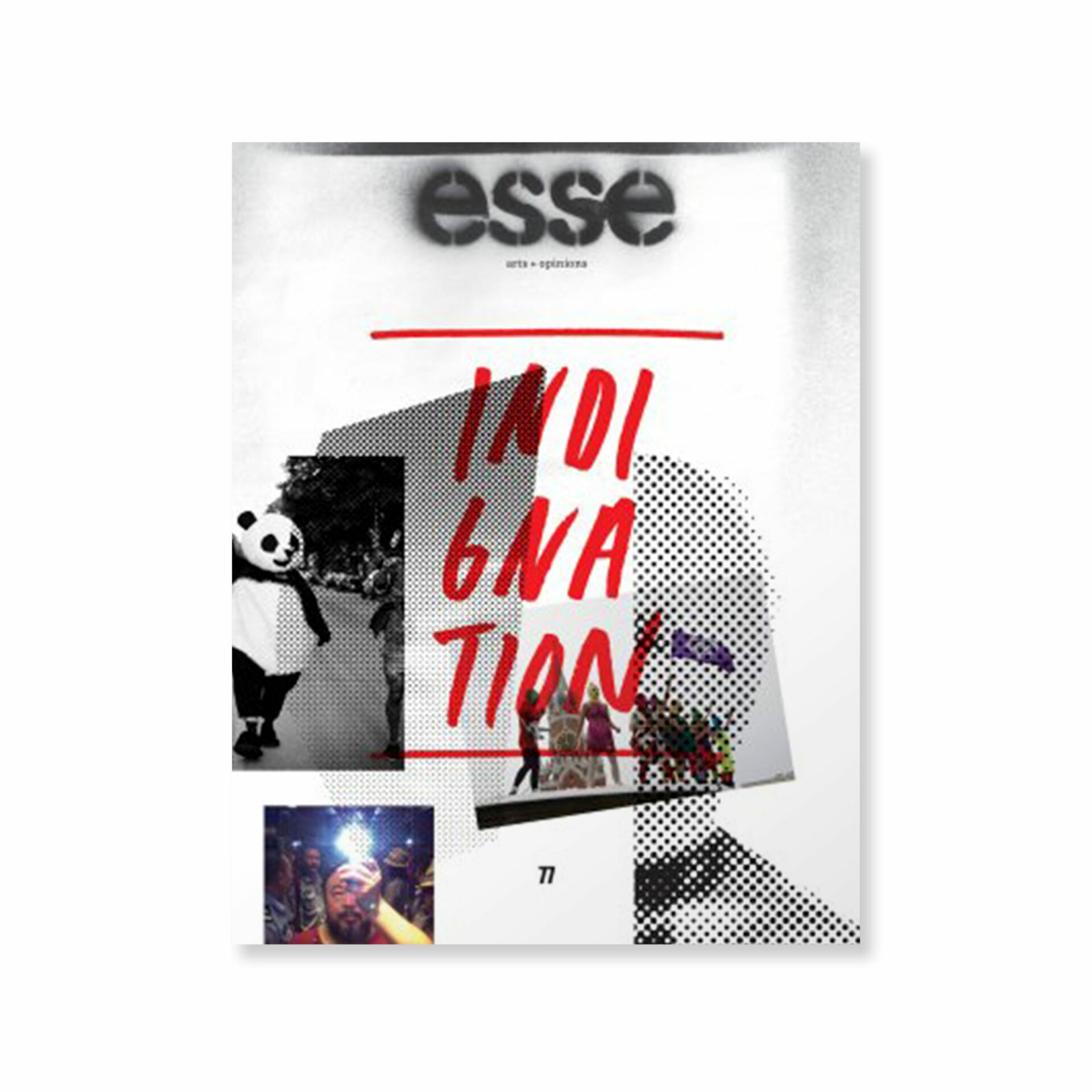photo : Raymonde April
Vendredi 31 août 2012
Durant trois semaines, je passe plusieurs heures chaque jour dans l’aréna où se tient le 30e Symposium international d’art contemporain de Baie-Saint-Paul. L’événement de 2012, « Je fixais des vertiges », est dirigé par Serge Murphy. Douze artistes y participent. C’est principalement avec eux que je suis en contact. Ici, je suis regardeuse, promeneuse, partenaire d’une multitude de conversations. Je n’ai guère de relations avec les autres visiteurs qui tantôt viennent en groupe, le plus souvent en couple, parfois seuls. Mais je suis l’une d’entre eux et peux consulter ma propre expérience pour documenter l’expérience publique à laquelle le symposium donne lieu. Sur cette base, j’aborde la question difficile des relations entre l’art et la politique. J’écris ici en tant que philosophe qui s’est penchée sur la notion de public et qui trouve en fréquentant le symposium une réponse aux questions qu’elle aborde ailleurs. Je note les succès de l’entreprise, mais aussi ses échecs, les doutes des uns, les rejets des autres, au cours de promenades qui me procurent un angle de vision privilégié sur le déroulement des ateliers, des œuvres et de la sociabilité.
La première impression rejoint mon appréhension initiale : le lieu, une aire de hockey sur glace transformée durant l’été en centre de création artistique, est d’autant plus difficile qu’il a été divisé en petites zones dans lesquelles les artistes ont installé leur atelier. Je constate pour beaucoup la difficulté de prendre place dans un dispositif architectural assez contraignant qui semble contraire à l’ambition du symposium : faire se rencontrer artistes et public pendant cinq semaines. Événement en théorie tourné vers les publics occasionnels, la ville, la région, l’extérieur, il est paradoxal que le symposium ait lieu dans un site dépourvu d’ouverture. Les box qui compartimentent l’aréna redoublent la clôture, enferment à nouveaux frais.
Je remarque une autre difficulté qui tient à l’ambition proclamée du symposium : montrer non des œuvres achevées, mais des œuvres en train d’être faites et les artistes qui les produisent – ceci parce qu’il est sous-entendu que rendre public, c’est rendre visible.
D’où vient cette confusion ? Avant de reprendre mon récit, je voudrais apporter quelques éléments de réponse à cette question en puisant dans mes réflexions antérieures. Il est courant de situer l’origine du public compris comme espace de visibilité à l’époque de la démocratie athénienne et d’affirmer que, pour les Grecs, le privé s’opposait au public comme l’intime, le caché, le secret, l’innommable ou l’impur s’opposaient à ce qui se montre en plein jour. S’il convenait que les premiers restent dans le noir, c’est parce qu’ils reflétaient les aspects les plus misérables des êtres humains. La vie privée serait alors ce qui ne peut paraître en public sans honte : dormir, saigner, déféquer, mourir, se laver, forniquer, s’alimenter, accoucher, allaiter. Cette vie est celle de la contrainte et de la nécessité. Dans l’antre sombre de la maison, chacun reconstitue son énergie et s’adonne, jour après jour, à la reproduction de son processus vital. Le « public » est l’inverse : les activités qui y ont cours seraient affranchies des nécessités biologiques. Il n’y a de liberté que publique. C’est hors de la maisonnée et loin des activités nécessaires à sa survie que l’humain réalise son essence. Pour cela, il s’adonne à des actions ayant leur fin en elles-mêmes. Alors que dans l’espace privé, il utilise son énergie pour atteindre un but situé hors de lui, dans l’espace public il devient son propre maître. Ce que l’individu expose, ce qu’il rend visible, tangible, manifeste, ce sont ses qualités communes et partageables : logos et belle allure. La concomitance entre public et visible est l’idée, fort répandue, qui a conduit à l’habitude de parler du public en terme d’espace.
Affirmer que le visible et le public ne coïncident qu’en raison d’une certaine conception politique qui conduit aussi à lier le privé et le caché, c’est mettre en cause que la garantie de la démocratie réside dans un « rendu visible ». La transparence, l’accessibilité, la mise à disposition, voire le dévoilement sont-ils de véritables moyens de démocratisation ? Ne lui font-ils pas obstacle, au contraire ? N’est-ce pas dans les pays autocratiques et totalitaires qu’ils fleurissent le mieux ?

30e Symposium international d’art contemporain de Baie-Saint-Paul, 2012.
photo : Raymonde April
Le 30e Symposium de Baie-Saint-Paul conduit à se poser ces questions. Il commence par convoquer l’idée d’inaugurer un « espace public », mais rend finalement manifestes les difficultés qui lui sont inhérentes ; le projet de rendre visible la création artistique à un large public trouve rapidement ses limites. Les visiteurs ne voient rien et ne peuvent rien voir du processus créatif qu’ils sont venus en théorie contempler. De fait, rien n’est exposé, rien n’est « donné » à voir hormis des matériaux, des outils, des choses posées là dont par lui-même le visiteur ne peut décider du statut. S’agit-il d’une trace, d’une étape, d’un objet fini et à vendre, d’un essai, d’une expérience en cours ? Il n’en sait rien. Les artistes, qui ne le savent pas toujours clairement eux-mêmes, remarquent que, dans un premier temps, nombreux sont ceux qui voudraient pouvoir regarder un objet tangible aux contours bien définis et sont déçus. Mais les visiteurs aussi ajustent leurs attentes. Ce qu’ils découvrent pour la plupart, c’est que la position de spectateur n’est pas la bonne.
À mon sens, là réside l’utilité la plus grande et la plus « démocratique » du symposium. Défini à juste titre par son directeur, Jacques Tremblay, comme un lieu d’échange et de rencontre, il invite à une relation non spectatorielle vis-à-vis des objets de l’art. Un spectateur est par définition celui qui assiste de l’extérieur et passivement à une situation sans y participer. Il l’enregistre et forme un jugement qui, s’il a une incidence sur sa vie intérieure, n’en a pas sur le spectacle lui-même. L’esthétique classique qui justifie la position de spectateur devant l’œuvre affirme que les jugements esthétiques sont à la fois immédiats et subjectifs. Kant prend soin par exemple de démarquer la formation du goût de tout effort de connaître, d’observer, de comparer, de mettre son regard au travail. Les spectateurs vont dans les musées comme ils vont au théâtre. Ils recherchent des émotions qu’ils ne pourraient faire naître d’eux-mêmes. La communauté qu’ils forment alors est fondée non sur leurs rencontres et leurs échanges, mais sur le fait qu’ils voient tous la même chose avec un regard à peu près identique, dans la mesure où ils ne font entrer dans la composition de leur jugement que leurs impressions immédiates.
Cette position de spectateur existe aussi en politique, face à un pouvoir qui s’expose. La position classique, appelée républicaine, correspond à celle qui vient d’être énoncée : le citoyen ne « participe » pas au gouvernement, il assiste en spectateur aux actions des dirigeants et forme des jugements après coup : tantôt il applaudit, plébiscite, acclame, souscrit, tantôt il proteste, rejette, refuse. Comme l’a montré Habermas dans L’Espace public (1962), réussir à faire croire que le citoyen-spectateur est aussi un citoyen-participant est la grande supercherie de l’époque.
En art comme en politique, ce moment de réaction au spectacle s’appelle la critique. Qu’elle ait une utilité est incontestable. Que les citoyens, de même que les amateurs d’art, se réalisent en elle est cependant fortement douteux.
De fait, pour en revenir à Baie-Saint-Paul, les visiteurs qui seraient venus pour assister à un « spectacle d’art contemporain » (l’aréna, rappelle J. Plante, étant d’ailleurs une « enceinte pouvant accueillir des spectacles »), et évaluer après coup ce qu’ils ont vu réalisent très vite que leur attente est déplacée. L’intérêt se substitue à la curiosité, l’enquête au jugement, l’attention à la contemplation, la discussion au silence sacré. Beaucoup reviennent plusieurs fois. Certains en témoignent : à l’immédiateté de leur jugement à l’emporte-pièce s’est substitué un travail du regard.
Les artistes les y aident, bien sûr. Eux non plus n’adhèrent pas aux pratiques de la spectatorialité et résistent par divers moyens à l’équation entre visible et public. Certains tournent délibérément le dos au public, d’autres positionnent leurs tables de manière à former un espace séparé et inaccessible, d’autres s’installent par moments dans un recoin. En utilisant par exemple des empilements de livres, un rideau de plâtre, des retombées de boutons, l’épaississement des parois du box ou une avalanche de dessins, en venant travailler hors les heures prévues d’atelier ouvert au public, de midi à dix-sept heures, ils évitent par divers subterfuges de devenir eux-mêmes les objets d’un spectacle, comme les animaux le sont dans les zoos. En créant une séparation entre l’espace de déambulation des visiteurs et celui dans lequel ils travaillent, stockent leur matériel, relèvent leurs courriels, écoutent de la musique, font sécher la peinture ou le plâtre, filment et enregistrent, organisent leurs tentatives, invitent leurs amis, ils produisent les conditions sans lesquelles aucune production artistique n’est possible.

30e Symposium international d’art contemporain de Baie-Saint-Paul, 2012.
photo : Raymonde April
Cette limite qu’ils instaurent entre deux zones à usage distinctif n’est pas une coquetterie ou l’expression d’un civisme en berne. Je me permets de rappeler ici, sur un plan plus théorique, qu’elle conditionne le développement de soi, sans quoi il n’y aurait ni art, ni science, ni existence réellement personnelle. Protégeant la vie privée tout en instituant une vie publique, elle est la marque de fabrique des « démocraties libérales ». Dans ces démocraties se trouve en principe une association entre « la liberté des Anciens », qui consiste à participer activement au gouvernement des affaires publiques, et « la liberté des Modernes » (les expressions sont de Benjamin Constant), qui consiste par exemple à faire fructifier son bien, à cultiver son esprit, à pratiquer librement sa religion, à exprimer ses opinions, à lire ce qu’on veut et à faire ce qui nous plaît, y compris (c’est un droit fondamental) à quitter les associations qu’on a, dans le passé, librement et volontairement contractées. Cette liberté moderne se nourrit de la liberté antique : sans la protection des lois communes, et en l’absence de la participation des citoyens à la production de ces lois, la liberté moderne s’étiolerait. Faute des projets et de l’imagination que nous donnent les contacts avec les autres, elle perdrait toute sa substance. Ceci étant, même si elle a pris le dessus sur la liberté antique dans une telle mesure qu’il paraît par moment justifié de rappeler les masses à l’esprit public, à la solidarité, au sens des responsabilités collectives ou au patriotisme, elle ne doit en aucun cas être oubliée. Quand elle est correctement alimentée par la sociabilité et l’association, elle compte pour les gens et apporte du sel à leur existence. Or le régime de la visibilité la menace.
On pourrait alors penser que le projet du symposium est en berne. Sans tomber dans l’angélisme, je constate que ce n’est pas le cas. Car la limite séparant les activités privées et les activités « publiques » n’est pas une ligne, c’est une zone à géométrie variable. La problématique du symposium « Je fixais les vertiges » choisie par Serge Murphy y trouve un lieu d’exercice : en réunissant des œuvres dont certaines procèdent par extrême dépouillement et d’autres, par l’excès, Serge Murphy invite à considérer la pluralité des manières de négocier la frontière entre le montré et le réservé, le donné et le gardé, le visible et le non-visible. Parfois, la limite entre privé et public est marquée brutalement. À d’autres moments elle prend de l’ampleur, s’élargit, respire. Je remarque qu’à aucun moment elle ne disparaît, ce qui permet d’éviter un double écueil : d’un côté, rejeter le public, lui opposer porte close, voire le mépriser et, à l’autre extrême, l’attraper là où il se trouve pour le captiver et lui donner ce qu’il attend, afin de lui plaire par exemple, ou de s’en faire aimer.
Cette zone intermédiaire dont la configuration est changeante est une zone de discussion. En politique, c’est là que s’effectuent, au moyen des enquêtes sociales, des délibérations, des débats, de la presse, les tentatives pour s’entendre sans s’agresser et pour qu’une fois un accord atteint, la nature du public et du privé soit modifiée de sorte que le conflit qui a justifié l’entreprise soit déminé. C’est aussi cette zone que le symposium fait exister et valorise. Des échanges et des rencontres s’y développent et l’animent. Louise Viger, une artiste en résidence, explique que « le “public” n’est pas invité à voir une œuvre, mais des artistes qui travaillent. À quoi ? C’est la grande question. Ils travaillent et parlent de leur travail, échangent. Pour moi, cet échange s’est étendu jusqu’à inviter les gens à écrire sur le thème précis de l’effacement, de la fragilité. Ne serait-ce que de l’aspect très touchant de ces rencontres, j’accorderais une grande valeur à ce mois passé enfermés dans un aréna ».
Au fur et à mesure des discussions, en fonction des visiteurs aussi bien que des avancées du travail, les interlocuteurs (artistes et publics, les premiers faisant partie du public également) font l’épreuve de la limite entre privé et public qui prévalait avant leur rencontre ; en la remaniant, ils instaurent un petit monde commun dont les qualités rejaillissent sur leurs zones respectives. Ainsi, cette limite dont la localisation varie ne sépare que pour mieux relier. Grâce à elle, la discussion est possible, des conversations s’engagent, des tours de parole s’organisent. Rencontrer un artiste et rencontrer son œuvre ne relèvent plus du spectacle, du donné à voir et du voir, mais d’une attention active et de la conversation. Donnant-donnant.