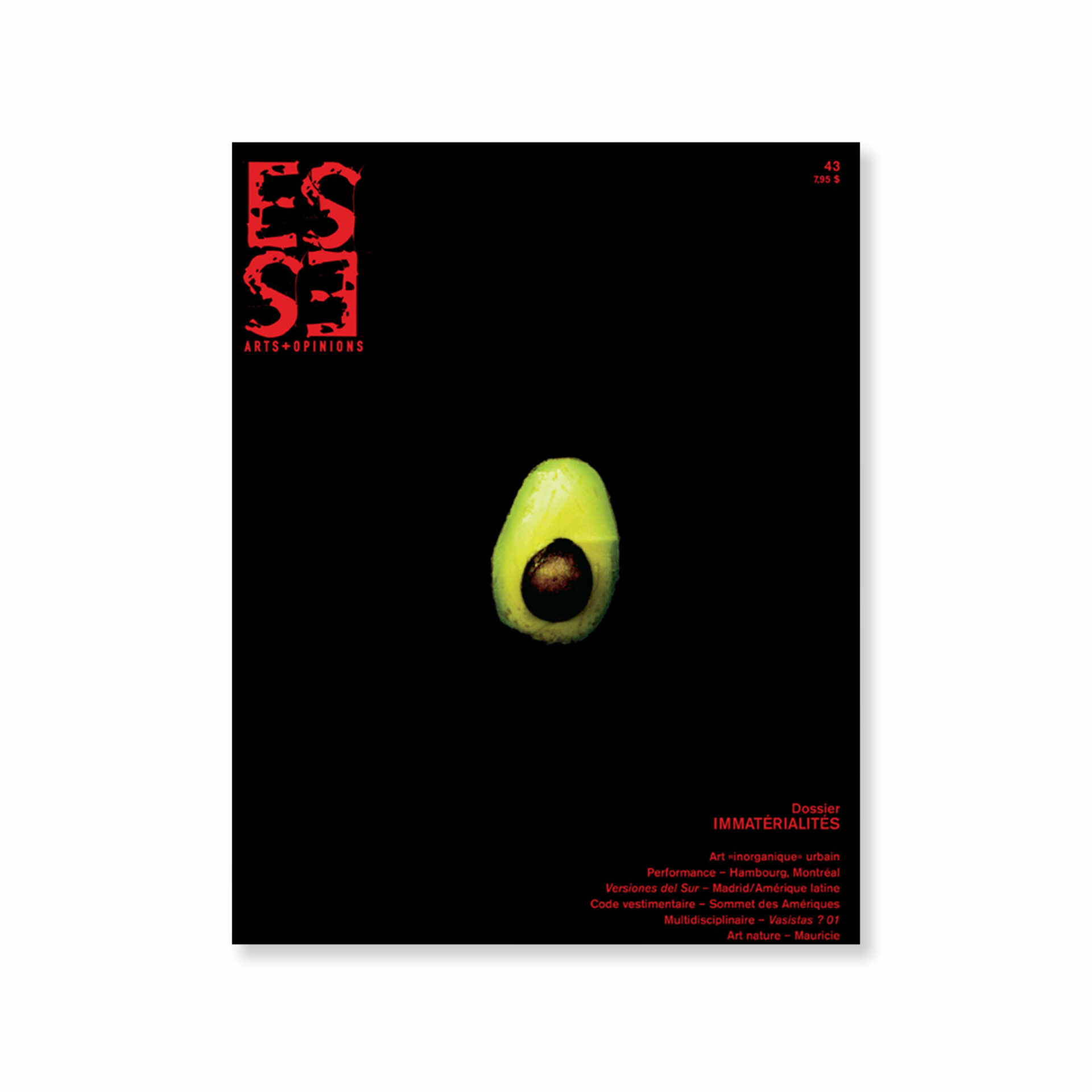[In French]
On parle beaucoup en ce moment dans les ateliers ou les bureaux d’artistes, dans les galeries et au sein des revues d’art, de la disparition de l’objet. Les pratiques artistiques travaillant de plus en plus dans l’ordre de la relation, l’objet, dit-on, est appelé à devenir un simple prétexte, presque un moment dans un processus, et encore, seulement lorsque l’on en a besoin. Je voudrais m’immiscer dans ce débat en tant que philosophe par une question sur le statut de cet objet dont on annonce la disparition. Avant de décider pour ou contre cette disparition, il faudrait préciser ce qu’il s’agit de rejeter. De quelle choséité parle-t-on au juste, aujourd’hui ? Il se peut que la question soit mal posée, qu’elle ne porte pas sur la présence et la production d’objets. Que l’on choisisse ou non d’en produire, il faut reconnaître que leur statut n’est plus le même dès que l’on assume la dimension relationnelle. On serait passé d’un objet autonome ou, plus exactement, dont l’autonomie définit la présence, à un objet relationnel qui n’existe et ne se soutient que dans l’ensemble des relations dont il dépend et qu’il déploie.
Il n’est pas nécessaire ici de se demander si l’objet d’art a déjà été ou même s’il peut être autonome. Il faudrait pour cela réécrire l’histoire de l’art. Il suffit de reconnaître que la possibilité de son autonomie a été déterminante dans la façon dont il a été pensé. Si on peut disposer les objets d’art dans un espace qui n’a d’autres fonctions que de les exposer, si l’objet d’art peut passer, sans changer d’essence, de l’atelier à la galerie, à un salon, à un musée, c’est qu’on lui attribue un pouvoir autonome. C’est encore cette idée d’autonomie que l’on retrouve dans le ready-made, puisque le déplacement de l’objet de toutes situations concrètes permet sa libération formelle. À l’autonomie de l’objet s’oppose donc sa dépendance à un environnement et à un réseau relationnel. Un objet sacré, par exemple, n’est pas tout à fait autonome, puisque son essence change lorsqu’il est isolé du culte qui l’encadre. Mais il peut le devenir s’il s’en « émancipe ». On se rend compte alors que l’autonomie est une simple idée qui se défend mal dès que le politique rencontre l’esthétique. L’art a aussi ses institutions et ses formes de culte. Pour ne prendre qu’un exemple parmi d’autres, c’est encore l’autonomie de l’objet d’art qui permet sa circulation dans le marché et toutes les spéculations sur sa valeur, dans la mesure où celle-ci n’est pas liée à des conditions précises de production. L’idée d’autonomie cache donc un ensemble de relations.
Pourtant, lorsqu’on commence à produire des objets explicitement relationnels, le rapport à l’objet va être appelé à changer, tout particulièrement quant à sa matérialité. Un objet relationnel est un objet dont le sens, la valeur et l’efficacité sont liés à un ensemble de symboliques précises. Hors de cet ensemble, il se perd. Écoutons à ce sujet Lygia Clark comparant sa pratique au ready-made de Duchamp : « Dans mon cas, il n’y a pas de nécessité d’objet : c’est l’acte lui-même qui engendre la poésie ». Ou encore : « L’œuvre ancienne — l’objet fermé sur lui-même — reflétait une expérience déjà passée, vécue antérieurement par l’artiste, tandis que maintenant l’importance réside dans l’acte de faire, au présent1 1 - Cité par Ferreira Gullar, « La trajectoire de Lygia Clark », dans le catalogue Lygia Clark. Fundaciò Antoni Tàpies, Barcelone, du 21 octobre au 21 décembre 1997; MAC, galeries contemporaines des Musées de Marseille, du 16 janvier au 12 avril; Fundaçao de Serralves, Porto, du 30 avril au 28 juin 1998; Société des Expositions du Palais des Beaux-Arts, Bruxelles, du 24 juillet au 27 septembre 1998). On doit à Lygia Clark tout un ensemble d’objets qu’elle dit elle-même relationnels, et qui servent à actualiser des liens de corps à corps, du singulier au singulier, du singulier au collectif, du corps à ses propres frontières. Ce sont des objets qui ne prennent sens que dans l’usage, dans la réponse du spectateur-participant. ». Deux conséquences en résultent. Ce qui reste alors de l’idée d’autonomie, c’est le fait de pouvoir déployer une efficacité relationnelle dans différentes situations. Mais l’idée d’autonomie ne définit plus le destin de l’objet. De plus, la matérialité change de sens. Dans un objet produit pour être autonome — une sculpture — la matière sert en quelque sorte à le faire entrer dans l’être, c’est par elle qu’il vient au monde. Dans un objet relationnel, la matérialité sert plutôt à le maintenir dans son statut passager. Comme une ponctuation dans l’existence, cela marque que l’objet aurait pu ne pas exister, qu’il ne sert presque à rien, qu’il ne sert qu’à actualiser une relation qui pourrait exister sans lui. Dans le premier cas, la matière fait la force de l’objet; dans l’autre, sa faiblesse, son assujettissement aux conditions concrètes d’existence. Il rappelle que la dimension symbolique ne peut exister isolément et qu’elle a besoin de supports matériels, comme le langage a besoin de signifiants, la course à relais d’un témoin, l’art culinaire d’une cuillère.
On se rend compte alors que la disparition de l’objet renvoie à deux choses très différentes. Parle-t-on de la fin d’objets supposément autonomes ? Ou de pratiques relationnelles qui n’exigent aucun objet relationnel ? Si on fait référence à la première question, la réponse va de soi, dès que l’on travaille sur la relation. La deuxième question par contre ne peut être évacuée aussi aisément. Peut-on créer des relations qui ne s’appuient sur aucune matérialité ? Ou, question plus radicale encore : est-il véritablement pertinent de faire la distinction entre une pratique relationnelle qui utilise des objets et une autre qui n’en a pas, dans la mesure où l’enjeu ici est la transformation de notre rapport à la matérialité ? L’objet relationnel de Lygia Clark est déjà l’idée d’un objet idéal, un objet appelé à devenir une action.
Il faut maintenant rajouter au débat un élément essentiel de l’art des années 1990. L’« esthétique relationnelle », se différencie des pratiques relationnelles en général par un point précis mis en évidence par Bourriault : elle place l’art dans les espaces qu’il dit publics, et que j’identifierais plutôt de façon générale comme des espaces de circulation, c’est-à-dire de rencontres aléatoires, d’interactions possibles. La relation, créée alors, délimite non seulement des interactions réelles mais aussi et surtout des interactions possibles. L’autre impliqué n’est pas « autrui », à savoir le concept de l’autre comme entité — comme dans le cas de Lygia Clark —, mais un autre contingent, dans un ensemble de possibles. C’est moi ici qui suis touché par l’œuvre, mais ça aurait pu et pourrait être quelqu’un d’autre. Créer des relations, ce n’est pas nécessairement les actualiser – ce n’est pas nécessaire —, c’est donner forme à des rencontres possibles, en laissant la relation ouverte. Là est la dimension sociale de la pratique.
L’objet relationnel reçoit alors une détermination supplémentaire. Au lieu d’être le médiateur entre deux agents qu’il lie, il le sera entre trois : deux actuels qui sont effectivement liés, et un autre possible vers lequel la relation ira éventuellement. On parlera alors d’une matérialité surdéterminée par la relation; et en même temps indéterminée dans son ouverture vers l’autre, le spectateur, et vers les tiers, à savoir les autres spectateurs. Surdéterminé dans la mesure où tout objet, que ce soit un objet produit, un objet recyclé, ou le corps comme instrument, n’aura de sens que dans les relations générées. Mais indéterminée, puisqu’il faut, pour que l’esthétique relationnelle fonctionne, que la relation reste une possibilité ouverte.
Prenons un exemple de travail sur la matérialité : les Candy Pieces de Felix Gonzales-Torres2 2 - Les Candy Pieces de Felix Gonzales-Torres sont composés de bonbons aux emballages colorés, entassés selon le poids équivalant à un corps donné, et qui sont appelés à disparaître au fur et à mesure que les visiteurs en prennent.. Certes, ici, le choix de travailler avec des objets est tout à fait constitutif. Il reste que l’œuvre est entièrement relationnelle, et permet d’identifier le lien entre matière et relation. Les bonbons colorés qui composent l’œuvre ne prennent sens que dans l’usage qu’en font les spectateurs qui sont appelés à les ramasser. Cet usage est multiple. l es spectateurs peuvent les garder ou les consommer, réagir différemment à leur possession, ils peuvent même ne pas en vouloir. Il reste qu’une relation métonymique se met en place entre la masse de l’œuvre et le corps collectif et hétérogène des spectateurs et des consommateurs. L’objet est donc appelé à se dissoudre et à disparaître dans sa réception. Et pourtant, cet objet existentiellement transitoire déploie sa matérialité à un autre niveau : celui du possible. Il est, en tant que matérialité, le lieu d’une potentialité qui coexiste parallèlement à toute relation actualisée. L’objet passif qui attend délimite un corps à venir, ce lui qu’il a le pouvoir de faire exister. Celui qui est présent – ces bonbons-ci — renvoie à tous les autres qui composent l’œuvre et donc à toutes les autres relations possibles et réelles, à tout un ensemble qu’il ne sera jamais possible de totaliser. Ce qui reste alors de l’autonomie, c’est la connexion que chaque pièce impose au récepteur, à toutes les autres pièces, à tous les individus qui les détiennent. Il y a donc ici une matérialité qui n’est pas réductible au contenu symbolique de la relation, même si elle est tout entière relationnelle. Elle se définit simplement par le fait que les relations possibles que l’objet contient ne peuvent jamais être expérimentées par aucun agent dans leur totalité. Il y aura donc toujours une hétérogénéité et une équivoque entre les relations réelles et les relations possibles. Elle ne relève pas du sens et de l’interprétation, mais bien des relations et c’est pourquoi elle n’est jamais réductible.
L’art avec ou sans objet ? Il faut dire que l’objet relationnel et partiel est toujours le lieu de relations problématiques. Du point de vue de la relation, la matérialité et l’immatérialité coexistent et s’invaginent, puisque la relation a toujours une dimension non actuelle qui peut-être de l’ordre du possible ou même de l’impossible, de la fiction ou de l’utopie. Il faut se demander si la question ne serait pas plutôt : travailler dans l’ordre de la relation univoque, identitaire et actuelle ou problématique, hétérogène et non-présente ? Et si on peut le faire sans objet, pourquoi pas ?