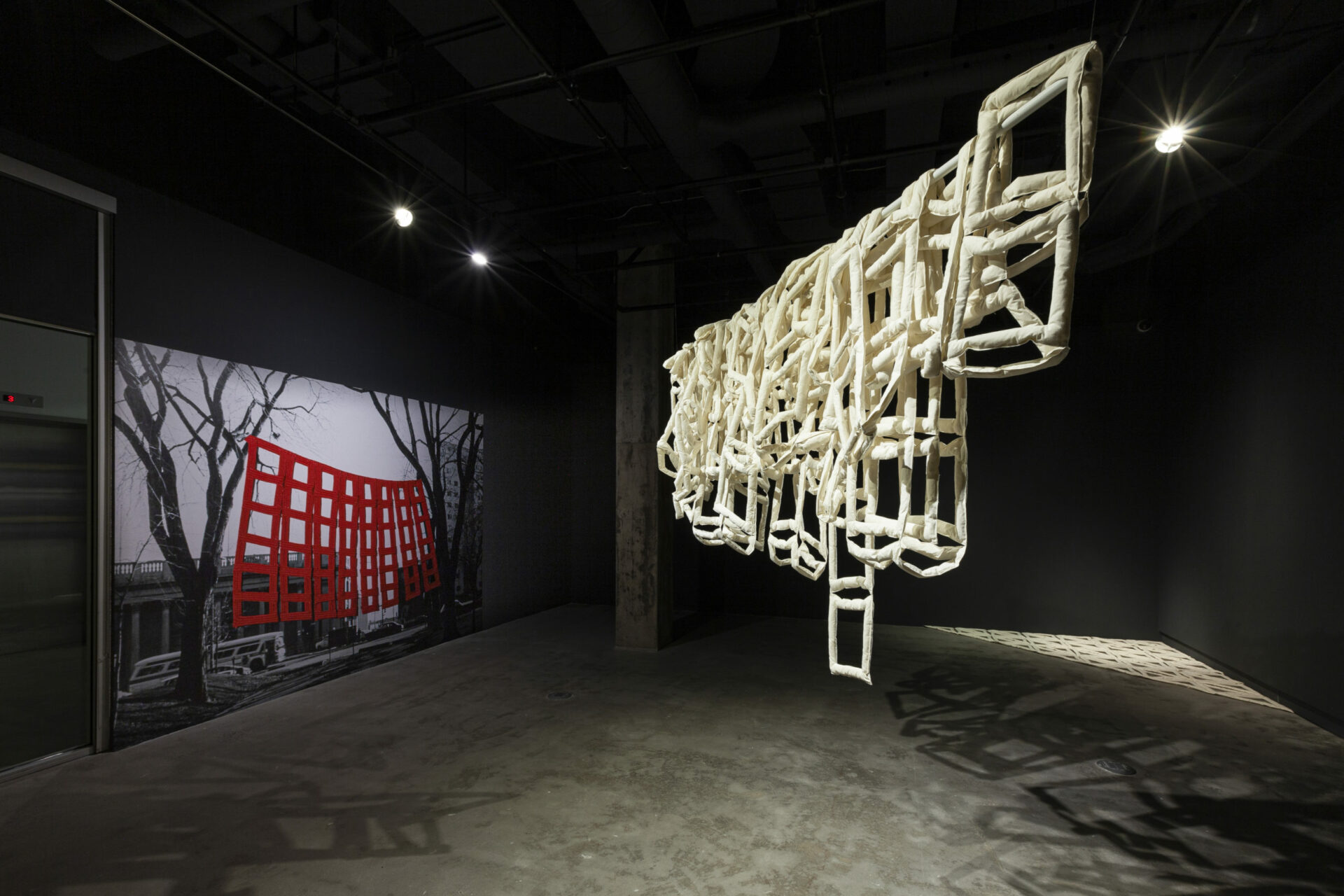Photo : Tanya St-Pierre
Du 30 novembre au 21 décembre 2018
Issu d’une résidence de plusieurs mois dans le cadre des activités de Sporobole, le projet Salivam de WhiteFeather Hunter s’inscrit dans la foulée des pratiques bioartistiques. En collaboration avec le Dr Denis Groleau, microbiologiste titulaire de la Chaire de recherche du Canada en micro-organismes et procédés industriels à l’Université de Sherbrooke, l’artiste a élaboré une crème cosmétique qui aurait des propriétés « anti-âge ». Outre les enjeux critiques sur l’industrie des produits de beauté, le travail soulève en filigrane des enjeux propres aux pratiques qui croisent les arts et les sciences : la hiérarchie des disciplines, l’instrumentalisation des résultats, la place du discours artistique face au scientifique, entre autres. Ainsi, dans l’espace de la galerie, Salivam décortique la recherche faite en laboratoire pour ensuite proposer une réflexion esthétique sur l’ensemble du processus.
En résumé, les chercheurs ont isolé des souches non pathogènes d’une bactérie à partir d’échantillons de sol qui proviennent du site historique du Village des Tanneries à Montréal, et de salive de l’artiste. En utilisant des techniques de culture bactérienne, ils ont extrait une enzyme qui permet la dégradation du collagène, offrant ainsi un réel potentiel dans l’élaboration de produits cosmétiques pour contrer le vieillissement de la peau. L’exposition met en scène une partie de la documentation et des étapes du processus : vases remplis d’éléments pour la fabrication d’une teinture-mère à base d’une plante, échantillons de sol et de salive sous différentes formes, boîtes de Pétri remplies de collagène, macrophotos de cellules, vidéo de l’artiste en laboratoire et deux projections dans lesquelles l’artiste expérimente les bienfaits de la salive et de sa crème sur un cobaye ou sur elle-même. Enfin, au mur, un présentoir du produit de style commercial permet au spectateur de tester la crème sur des masques. La mise en espace reconstruit, d’une certaine façon, le trajet d’une expérience en laboratoire jusqu’à son application sur le marché.
Créez-vous un compte gratuit ou connectez-vous pour lire la rubrique complète !
Mon Compte