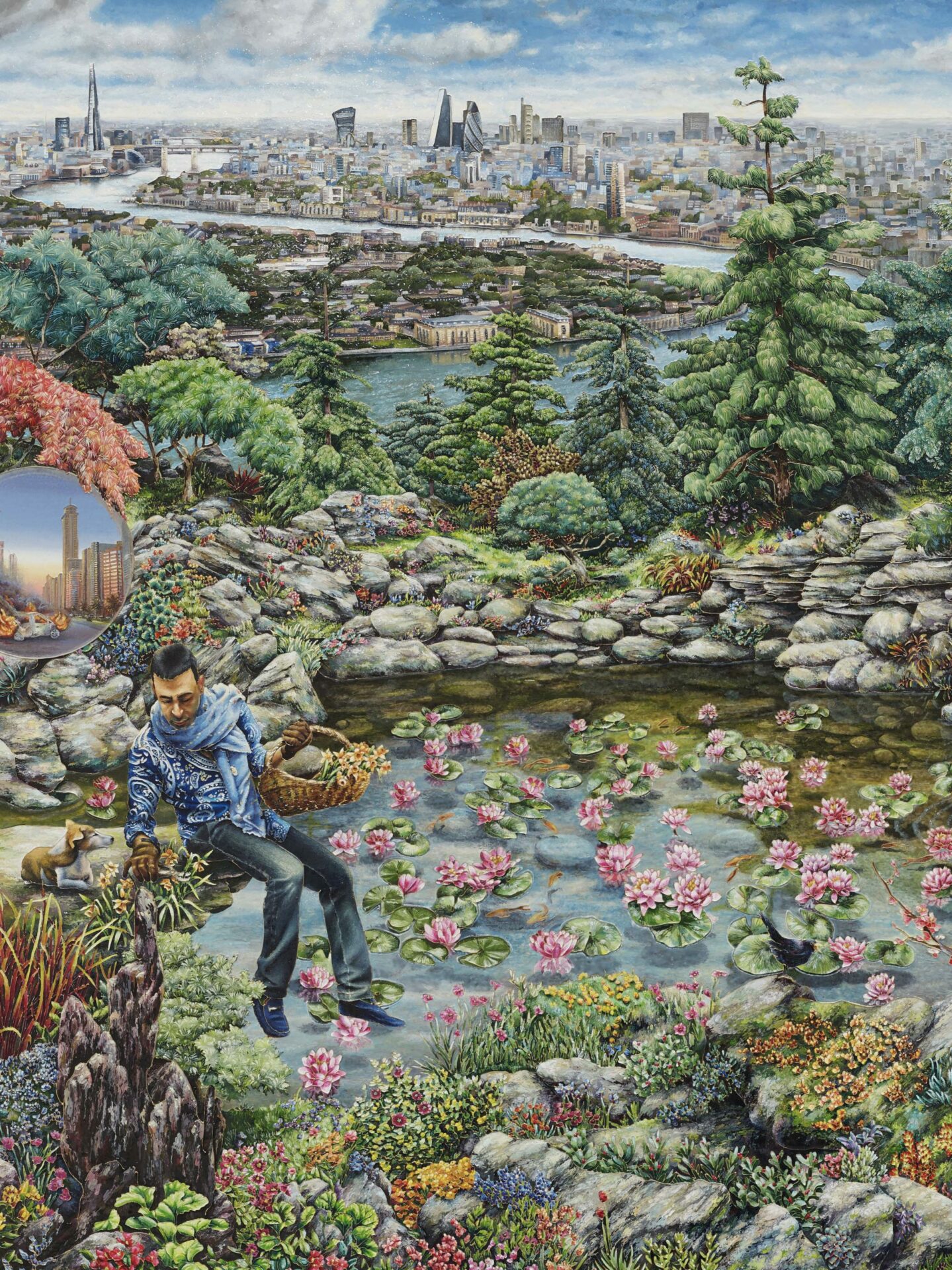Photo : Daniel Roussel, permission de la Galerie d’art Foreman, Sherbrooke
Du 17 janvier au 23 mars 2019
L’exposition Dataesthetics présente le travail de six artistes se rapportant à la visualisation de données numériques. Rassemblées par la commissaire Gentiane Bélanger, les œuvres proposent une incursion dans le domaine de la matérialisation de ce qui semble a priori invisible à l’œil nu. Avec des démarches aussi minutieuses que diversifiées, les artistes ont toutes et tous en commun des approches qui relèvent d’une quasi-performance physique afin de donner corps à des données virtuelles et conceptuelles. Entre l’accumulation d’information puis son traitement par divers logiciels, et la mise en matière de ce processus, prennent place des dispositifs, des corps et des gestes qui traduisent la démesure des opérations complexes accomplies par les machines. Il en découle une esthétique du numérique élaborée autour des enjeux matériels, conceptuels, politiques et formels propres à nos modes « d’organisation spatiale de l’information ».
Pour certains artistes, le corps sert d’interface entre les données et leur visualisation. L’imitation des processus mathématique et informatique à l’échelle humaine permet d’incarner les mécanismes à l’œuvre dans le traitement de l’information pour mieux en mesurer l’ampleur. Ainsi, 30/180/365 Days de Katie Holland Lewis se transforme en logiciel de compilation de données et cartographie les évènements sensoriels de son quotidien. Trois tableaux composés d’un amas d’aiguilles et de ficelles représentent les sensations d’engourdissement ressenties par l’artiste sur des périodes de trois mois, de six mois puis d’un an. De son côté, Jeanine Mosely ajoute à son projet une dimension sociale et collective en impliquant la communauté dans la conception d’une fractale. Ainsi, son œuvre Hidden Stars, une structure itérative réalisée en origami, permet de rapprocher la pensée abstraite de « l’acte de faire ».
Créez-vous un compte gratuit ou connectez-vous pour lire la rubrique complète !
Mon Compte