
Photo : permission de l’artiste | courtesy of the artist
Dans les sociétés occidentales contemporaines laïques et démocratiques, les religions – toutes les religions – fonctionnent selon le principe de la liberté de croyance. Après la victoire des Lumières, la foi est devenue une affaire privée. La liberté de croyance signifie que toute personne est libre de croire ce qu’elle choisit de croire, et aussi qu’elle est libre d’organiser sa vie personnelle et privée conformément à ses croyances. Mais cela signifie également qu’il est interdit d’imposer sa propre foi dans la sphère publique et aux institutions de l’État. Les changements engendrés par les Lumières ont donné lieu non pas à la disparition de la religion, mais à sa privatisation, à sa relégation dans la sphère privée. Dans les conditions propres au monde contemporain séculier, la religion est devenue une question de gout personnel, un peu comme l’art et le design. Cela ne veut pas dire qu’elle ne puisse faire l’objet de débats, mais que sa place y est la même que celle de l’art telle qu’elle a été décrite par Kant dans sa Critique du jugement : la religion peut être discutée publiquement, à condition de n’entrainer aucune conclusion qui serait contraignante pour ses participants ou pour la société dans son ensemble. L’engagement envers une foi religieuse ou une autre relève d’une décision personnelle, privée et souveraine qui ne peut être dictée par aucune autorité publique, y compris les autorités démocratiques légitimement élues. Mais surtout, une telle décision – comme c’est le cas pour l’art – n’a pas besoin d’être défendue à la face du monde. Elle est plutôt censée être socialement acceptée sans qu’aucune explication ne soit exigée. La légitimité des croyances personnelles ne se fonde pas sur leur pouvoir de persuasion, mais sur le droit souverain de chaque individu d’accepter ou de rejeter ces croyances.

Tim, vue d’exposition | exhibition view, medium religion, zkm | Centre D’art Et De Technologie Des Médias, Karlsruhe, 2008. © Wim Delvoye / Sodrac (2014)
Photo : Tobias Efthymiades permission de l’artiste | courtesy of the artist
La science, en revanche, est une affaire publique. Les connaissances obtenues, formulées et présentées scientifiquement sont essentielles à la gouvernance des démocraties libérales occidentales contemporaines issues des Lumières. Comme Michel Foucault l’a souligné à maintes reprises, dans les conditions de la modernité, le savoir scientifique va de pair avec le pouvoir. La technologie moderne se fonde sur des sciences comme la physique et la biologie, et la pratique moderne de la gouvernance s’appuie sur les sciences positives telles que le droit, la science politique, l’économie, la psychologie et la sociologie. Tout cela signifie qu’il ne peut y avoir de liberté scientifique au même sens qu’une liberté de croyance. Dans le cadre d’une discussion scientifique, toutes les opinions peuvent et doivent être justifiées ou réfutées sur la base de certains faits, à l’aide de certaines règles. Chacun est assurément libre – du moins en théorie – de formuler sa position et de la défendre. Mais la validité d’une opinion scientifique ne peut être soutenue sans explication, à contrecourant des données probantes et sans arguments plausibles et convaincants.
Il existe donc aujourd’hui deux types de libertés à l’œuvre dans notre culture. L’une, conditionnelle, est la liberté d’opinion scientifique qui dépend de la capacité à justifier une opinion en ayant recours à certaines règles publiquement établies. La seconde, la liberté de croyance, est une liberté inconditionnelle et souveraine parce qu’il est impossible de prouver que la foi d’une personne est erronée, pas plus qu’il n’est possible de prouver qu’elle est fondée. En d’autres mots, toute religion constitue une représentation sociale et politique d’un non-savoir individuel et privé. L’idéologie des Lumières tend à suggérer qu’un jour la sphère du non-savoir sera remplacée par des connaissances intégrales ou, autrement dit, la science sera en mesure de répondre à toutes les questions imaginables.

This is my body, This is my blood, 2002.
© Alexander Kosolapov / SODRAC (2014)
Photos : permission de l’artiste | courtesy of the artist

La religion, au contraire, ne cherche pas à s’affranchir du non-savoir. Elle le perçoit plutôt comme l’horizon suprême et insurpassable de l’existence humaine. Ainsi, Dieu et Sa volonté se situent hors du champ de la connaissance. Dieu échappe à toute rationalité parce qu’Il est souverain et qu’Il n’est pas tenu d’expliquer ni de justifier Ses actes et Ses décisions (Livre de Job). Ce divin libre arbitre souverain surpasse toutes les certitudes, les preuves et les convictions de la raison. Par conséquent, seul le sujet religieux est véritablement sceptique : il ne croit pas même aux preuves directes et il n’assujettit pas ses croyances au pouvoir d’un meilleur argument. Pour lui, le monde n’est pas la surface d’un objet qui doit être exploré scientifiquement, mais constitue une interface, un extérieur derrière lequel se cache la subjectivité divine. La relation entre un sujet religieux et Dieu est la même que celle entre un spectateur et un artiste. En effet, on aime une œuvre d’art précisément parce qu’on ne la comprend pas. Les rouages de l’acte de foi fonctionnent de la même façon que ceux d’une décision dictée par le gout.
La différence entre la science et la religion peut donc être décrite comme étant la différence entre la production et la consommation de vérité. Cela explique pourquoi l’attitude religieuse est devenue si populaire dans la société contemporaine, qui est, après tout, principalement une société de consommation. Aujourd’hui, notre position s’apparente plus à celle d’Abraham qu’à celle de Platon. Et d’ailleurs, l’époque est révolue où l’individu ne se voyait offrir aucune vérité ou n’avait accès qu’à quelques vérités et traditions publiquement reconnues, comme c’était le cas au temps de Platon et au début des Lumières. Le sujet contemporain est interpelé, voire attaqué de toutes parts par toutes sortes de vérités. Ces dernières ne se contentent pas d’attendre tranquillement quelque part qu’on les trouve, qu’on les découvre, qu’on les affronte. Loin de là. Elles sont agressives, elles sont insistantes, elles s’emploient à faire leur propre promotion et elles sont souvent terrifiantes. Elles nous disent que le climat se réchauffe et que nous allons mourir tous ensemble dans un avenir proche, ou encore qu’un trépas solitaire nous guette, causé par le tabagisme, le cholestérol, le terrorisme islamiste ou quoi encore. Ces vérités et bien d’autres sont produites et disséminées par des agences et des organisations impersonnelles.
Ces vérités qui exigent notre acceptation nous sont surtout transmises par les médias, particulièrement Internet. Le cyberespace est devenu la première source de connaissance sur le monde contemporain et le principal médium de communication avec celui-ci. De plus, Internet n’est dirigé par aucune instance publique. Il s’agit d’un espace public occupé par des intérêts privés et souverains. L’information qui nous vient d’Internet n’est pas le fruit d’une discussion publique rationnelle. Chaque utilisateur possède un droit absolument souverain d’afficher n’importe quelle opinion et n’importe quelle information non vérifiée sur le Web, sans avoir à les justifier. Aujourd’hui, Internet est le principal véhicule par lequel la sphère privée envahit l’espace public. De plus, comme tous les médias de masse contemporains, Internet ne fait aucune distinction entre les vérités religieuses et scientifiques.
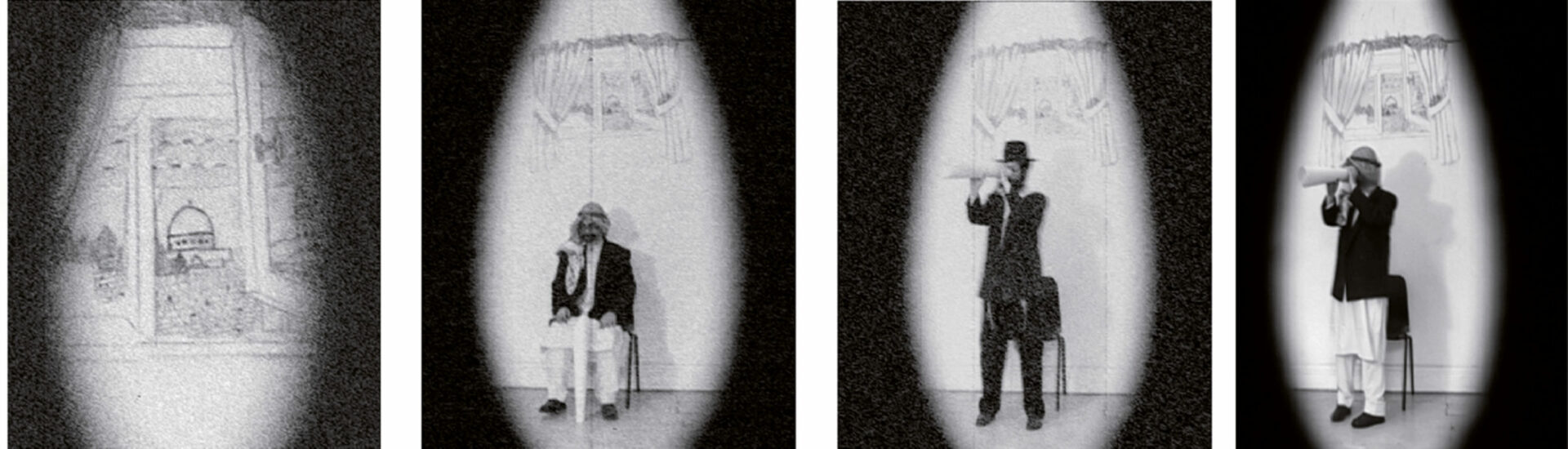
Oh Jerusalem, captures vidéos | video stills, 2005.
Photos : permission de l’artiste | courtesy of the artist
Jadis, les mouvements religieux utilisaient habituellement le texte imprimé, l’image peinte et la sculpture pour véhiculer leur message. Au cours des dernières décennies, la vidéo – diffusée par la télévision, Internet, les clubs vidéos et autres – est devenue leur médium de prédilection pour la propagande. Cela est particulièrement vrai des mouvements religieux plus récents, plus actifs et plus agressifs, qui sont surtout actifs sur Internet en ayant recours à la reproduction numérique et non mécanique. Les mouvements évangéliques, notamment, utilisent ce moyen de communication. Quand on leur demande de l’information, on reçoit tout d’abord une vidéo. Quant à l’islam, il constitue un exemple particulièrement éloquent à cet égard. Les vidéos montrant les confessions des auteurs d’attentats-suicides et de nombreux autres types de productions vidéos reflétant la mentalité de l’islam radical nous sont devenues familières. Il est bien connu que cette religion interdit la production d’images de personnes vivantes, mais elle n’interdit pas leur reproduction, c’est-à-dire l’usage d’images déjà existantes. Elle interdit (indirectement) la création individuelle de ces images, mais permet de facto les pratiques d’appropriation et les readymades. Il est devenu banal de dire que l’islam n’est pas moderne, et pourtant, à cet égard, cette religion est de toute évidence postmoderne.
À ce sujet, je dirais que l’utilisation de la vidéo comme principal médium de communication par les mouvements religieux contemporains est intrinsèque au message qu’ils diffusent. J’ajouterais même qu’elle n’est pas étrangère à la compréhension du sentiment religieux qui sous-tend cette utilisation. Loin de suggérer, à la suite de Marshall McLuhan, qu’ici le médium est le message, je suis d’avis que le message est devenu le médium, et qu’un certain message religieux est devenu le code numérique.

Self-portrait as Marcus Fisher II, 2000.
Photo : permission de l’artiste | courtesy of the artist
Les images numériques ont la particularité d’être générées, multipliées et distribuées de façon quasi anonyme à travers les champs ouverts créés par les moyens de communication modernes. L’origine de ces messages est difficile, voire impossible à déterminer, tout comme celle des messages divins et religieux. Par ailleurs, la numérisation semble garantir la reproduction littérale d’un texte ou d’une image plus fidèlement que toute autre technique connue. Bien sûr, ce n’est pas tant l’image numérique elle-même que le fichier image, les données numériques, qui demeurent identiques au cours des processus de reproduction et de distribution. Or le fichier n’est pas une image, car il est invisible. L’image numérique est un effet de la visualisation du fichier invisible, des données numériques invisibles. Seuls les protagonistes du film Matrix (1999) sont capables de voir les fichiers images, le code numérique comme tel. Le spectateur ordinaire, quant à lui, ne possède pas de pilule magique qui lui permet, comme le personnage principal de Matrix, de pénétrer dans l’espace invisible dissimulé derrière l’image numérique et de se trouver directement en présence des données numériques. Et ce spectateur ne maitrise pas la technique qui lui donnerait le pouvoir de transférer les données directement dans son cerveau et de les percevoir en un mode de pure souffrance impossible à visualiser, comme le décrit le protagoniste d’un autre film, Johnny Mnemonic (1995). (En fait, la souffrance pure est, comme nous le savons, l’expérience qui s’apparente le plus à l’invisible.) Les données numériques doivent être visualisées, devenir une image pouvant être vue. Ici, l’éternelle dichotomie entre esprit et matière est réinterprétée comme étant une dichotomie entre le fichier numérique et sa visualisation, ou entre l’information « immatérielle » et l’image « matérielle », laquelle inclut le texte visible. En termes plus théologiques, disons que le fichier numérique joue le rôle d’un ange, celui d’un messager invisible qui transmet un commandement divin. Mais l’être humain demeure extérieur à ce message, à ce commandement, et il est donc condamné à n’en contempler que les effets visuels. Nous sommes ici en présence de la transposition d’une dichotomie entre le divin et l’humain de la sphère métaphysique à la sphère technique, transposition qui, comme l’affirmerait Martin Heidegger, n’est possible qu’en vertu du fait que cette dichotomie est implicitement technique dès le départ.




Dancing With Men, captures vidéos | video stills, 2003.
Photos : permission de l’artiste | courtesy of the artist


Par extension, une image numérique qui peut être vue ne peut être simplement exposée ou copiée (comme dans le cas d’une image analogique) ; elle ne peut qu’être réalisée ou exécutée. Ici, l’image peut être comparée à une œuvre musicale : comme on le sait, la partition n’est pas « identique » au morceau de musique, elle n’est pas musique puisqu’elle est muette. Pour qu’on entende la musique, la partition doit être exécutée. On pourrait conclure ici que la numérisation transforme les arts visuels en arts du spectacle. Or, exécuter ou jouer quelque chose signifie l’interpréter, ce qui implique une trahison, une déformation. Toute exécution est une interprétation, et toute interprétation est un détournement. La situation devient particulièrement difficile dans le cas de l’original invisible. Quand l’original est visible, il peut être comparé à une copie, et cette copie peut être corrigée afin de réduire l’effet de déformation. Mais si l’original est invisible, il est impossible de faire une telle comparaison, et toute visualisation entretient une relation incertaine avec l’original ; on pourrait même dire que chaque exécution ou interprétation devient elle-même un original.
En outre, de nos jours, les technologies de l’information sont en perpétuel changement – matériel, logiciels, etc. Pour cette seule raison, l’image est transformée chaque fois qu’on la regarde au moyen d’une technologie nouvelle ou différente. Nous pensons maintenant à la technologie en termes de générations : générations d’ordinateurs, générations d’équipement photographique et vidéographique. Mais qui dit générations dit conflits de générations, combats œdipiens. Toute personne qui tente de transférer de vieux fichiers textes ou images vers de nouveaux logiciels fait l’expérience du pouvoir du complexe d’Œdipe sur la technologie actuelle : des données sont détruites, s’évaporent dans le vide. La métaphore biologique dit tout : ce n’est pas seulement la vie qui se distingue en cette matière, mais aussi la technologie ; la technologie, prétendument l’opposé de la nature, est devenue le médium de la reproduction non identique. L’hypothèse centrale de Benjamin formulée dans son célèbre essai intitulé L’œuvre d’art à l’époque de la reproductibilité technique (1936) – selon laquelle une technologie avancée garantit l’identité matérielle entre l’original et la copie – ne s’est pas confirmée avec l’avènement des avancées techniques subséquentes. Dans les faits, les progrès technologiques sont allés dans la direction opposée, vers une diversification des conditions dans lesquelles une copie est produite et distribuée et, conséquemment, une diversification des images visuelles résultantes. Et même si la technologie garantissait l’identité entre les différentes visualisations des mêmes données, ces données resteraient tout de même non identiques en raison des contextes sociaux changeants dans lesquels elles sont apparues.

Dancing With Men, captures vidéos | video stills, 2006.
Photos : permission de l’artiste | courtesy of the artist

L’acte de visualiser des données numériques invisibles est donc analogue à l’apparition de l’invisible à l’intérieur de la topographie du monde visible (en termes bibliques, les signes et les miracles) sur laquelle sont fondés les rituels religieux. Sous ce rapport, l’image numérique fonctionne comme une icône byzantine, comme une représentation visible de données numériques invisibles. Le code numérique semble garantir l’identité des différentes images qui en sont des visualisations. L’identité est établie ici non pas dans la sphère de l’esprit, de l’essence ou du sens, mais dans la sphère matérielle et technique. C’est donc ainsi que la promesse d’une répétition littérale semble acquérir un solide fondement ; le fichier numérique, après tout, est censé être quelque chose de plus matériel et tangible qu’un dieu invisible. Toutefois, le fichier numérique reste effectivement invisible, caché. Ce que cela signifie, c’est que son identité demeure une question de foi. En effet, nous sommes portés à croire que chaque acte de visualisation de certaines données numériques équivaut à une révélation des mêmes données, tout comme nous sommes obligés de croire que chaque exécution d’un certain rituel religieux se rapporte au même dieu invisible. Et cela signifie que toute opinion sur ce qui est identique et ce qui est différent, ou ce qui est original et ce qui est une copie, est un acte de croyance, l’effet d’une décision souveraine qui ne peut être pleinement justifiée empiriquement ou logiquement.
La vidéo numérique remplace les garanties spirituelles d’une immortalité qui nous attend prétendument dans l’au-delà par les garanties techniques d’une répétition potentiellement éternelle dans ce monde, répétition qui devient une forme d’immortalité en raison de sa capacité à interrompre le flux temporel de l’histoire. C’est cette nouvelle perspective d’une immortalité matérialiste et techniquement garantie que les nouveaux mouvements religieux offrent à leurs disciples, une perspective qui transcende les incertitudes métaphysiques de leur passé théologique. En plaçant les actions humaines en boucle, les deux pratiques – rituelle et vidéographique – réalisent la promesse nietzschéenne d’une nouvelle immortalité : l’éternel retour du même. Toutefois, cette garantie technique demeure une question de croyance et relève toujours d’une décision souveraine. Reconnaitre deux images distinctes comme étant des copies d’une même image ou des visualisations d’un même fichier numérique revient à valoriser l’immortalité au détriment de l’originalité. Les reconnaitre comme étant différentes revient à préférer l’originalité dans le temps à la possibilité de l’immortalité. Les deux décisions sont nécessairement souveraines, et sont aussi des actes de foi.
[Traduit de l’anglais par Gabriel Chagnon]
