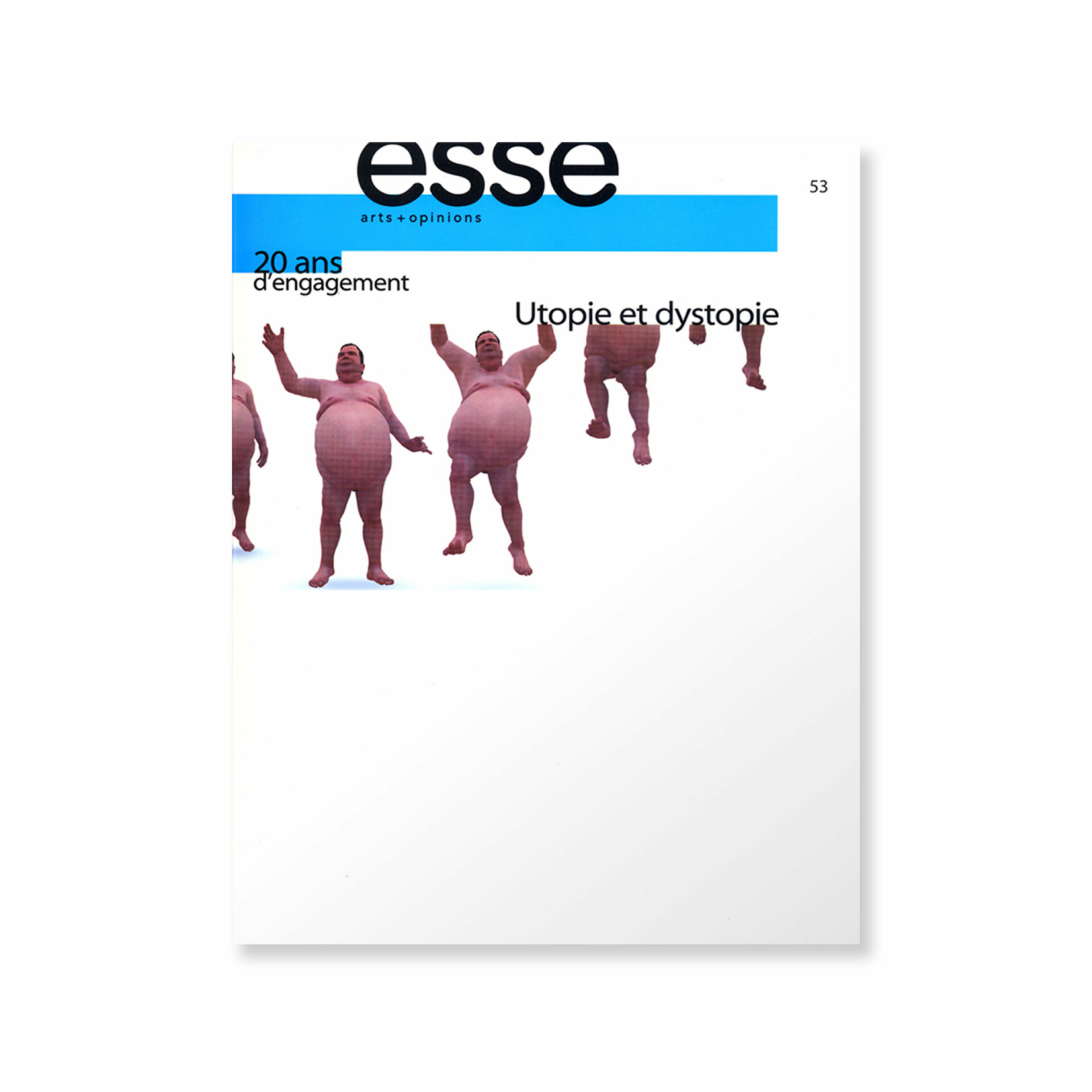«Lorsque tout est fini…»
J’ai cherché à analyser dans D’où venons-nous, où allons-nous? (Trait d’union, Montréal, 2001) l’effondrement, à la fin du siècle vingt, concomitant de la Chute du Mur de Berlin et de la disparition des régimes issus de la Révolution bolchevique, des idées de progrès et de perfectionnement de l’humanité, du projet socialiste et de la «justice sociale», des militantismes de toutes sortes, de la démocratie active et consciente, des tableaux de communauté harmonieuse et des grands remèdes aux maux de la société, l’effacement même – pour reprendre le titre de Pierre-André Taguieff – de l’avenir. Et la chute du consommateur-citoyen jobard, sauvé des Molochs totalitaires, dans le Virtuel et les Simulacres cybernétiques. J’ai fait voir, simultanément, la mutation crépusculaire de la vieille critique militante qui tourne désormais le dos aux «illusions du progrès», les pédagogies bruyantes d’adaptation nécessaire au capitalisme pérenne, la poussée des idéologies de l’identitaire, l’ethnique, l’intégriste, le communautaire fonctionnant au ressentiment (j’aurais pu évoquer un certain retour des religions révélées qui comblent aussi pour les esprits faibles le vide laissé par les utopies de l’universel), la montée orchestrée d’angoisses collectives faute de valeurs et de projets communs, le ramollissement des dynamiques civiques entre un humanitarisme sentimental, inconséquent et hypocrite, une recherche inlassable de boucs émissaires nouveaux et une démocratie affaiblie, livrée aux médias.
Tous ces phénomènes convergent vers l’idée d’une décomposition en cours de tout un dispositif de la modernité, d’une vision du monde séculaire, dans une période où ça déconstruit, recycle et bricole dans les ruines des Grandes espérances sans que l’historien des idées trouve à repérer des paradigmes vraiment nouveaux. Il s’agit pourtant à mon sens de l’amorce d’une mutation majeure dont nous ne voyons que le début et qui, selon la «ruse de l’histoire», dissimule une partie de sa dynamique aux acteurs présents.
«La chouette de Minerve se lève au crépuscule»
«La chouette de Minerve se lève au crépuscule» : on connaît l’aphorisme de Hegel. Il s’applique à notre époque tardive, infima modernitas. Tâchons de profiter de cette conjoncture délétère pour au moins donner à l’intellectuel un mandat évident et dont les résultats pourront servir : celui de chercher à comprendre le passé, de rendre raison du 20e siècle. Le premier devoir – ne serait-ce que par réaction aux moralistes sommaires du Présent absolu – c’est de refaire un travail historique qui peut, avec une modestie ambitieuse, chercher à répondre à la question première, la seule qui ne soit pas totalement métaphysique : «D’où venons-nous?» Je pense qu’il faut comprendre d’abord ce qui s’est passé et comment cela s’est passé – alors que beaucoup ont hâte de tourner la page ne serait-ce que pour pouvoir recommencer les mêmes erreurs. Si les grandes idéologies défuntes furent des moyens collectifs d’aller, guidé par des aveugles et par des borgnes roublards, vers quelque chose que personne ne soupçonnait, il appartient à l’analyste historique d’en faire voir le degré de fausse conscience et les dérapages perpétuels, mais il devra se garder d’en extrapoler à son tour des «lois de l’histoire» et des prédictions sur l’évolution des choses à terme.
Le 20e siècle reste plein de taches aveugles et d’enchaînements mal compris ou déniés. Le travail de réexamen et de clarification est d’autant plus urgent que beaucoup de gens de divers bords ont intérêt à ne pas projeter une lumière trop crue sur un «passé qui ne passe pas»; que l’auto-censure et l’intimidation s’efforcent toujours de vous dissuader de suivre certaines pistes. Quand on vous dit «on ne peut pas encore…», cela doit se traduire par «vous n’avez pas le droit de…» Un simple constat s’impose cependant quant aux livres qui s’amoncellent dans nos bibliothèques, c’est celui de Jean-François Kahn : Tout était faux1 1 - Jean-François Kahn, Tout était faux. En guise d’adieu au siècle du mensonge, Fayard, Paris, 1998.. Tous les livres, par exemple, jamais écrits sur le communisme pendant un demi-siècle : les livres des communistes, certes, mais aussi ceux des trotskystes et autres «oppositionnels», ceux des publicistes de gauche, mais encore ceux des anti-communistes, des libéraux, des conservateurs, des «kremlinologues» de jadis. Il n’en restera rien, ils n’avaient rien prévu et leurs analyses ne diffèrent que par des variations dans l’erreur et le fantasme.
Plus ça va, moins je suis sûr de le comprendre, ce «siècle-charnier» dans toute sa terrible complexité, mais plus je suis exaspéré par les réductions moralisatrices sur les crimes comparés des totalitarismes noir et rouge, chiens de faïence d’une histoire truquée, plus je perçois la manipulation hypocrite des culpabilités rétrospectives instruites par la vertueuse société que nous formons aujourd’hui, et celle des complicités alléguées, moins je trouve prometteuses la bonne et la mauvaise consciences des uns et des autres. La preuve par les crimes commis a été un raccourci polémique de tous les temps; Voltaire en son temps s’en servait contre le christianisme avec succès : «Vous verrez, fait-il dire au Curé Meslier, que la religion chrétienne a fait périr la moitié du genre humain2 2 - Voltaire, «Sentiments de Jean Meslier», Mélanges, p. 501.…» Certes, mais comme analyse, cela reste court et, si je transpose aux doctrines politiques modernes, je me donne aussi le droit de rappeler, pour compléter les listes, le nombre immense d’humains avilis, torturés, égorgés sur les autels des impérialismes coloniaux français, britanniques et autres. Comparer en histoire, tout est là ou du moins beaucoup, mais encore faut-il comparer complètement. Et même pour «l’unicité de la Shoah» : comment rationnellement l’affirmer sans avoir préalablement comparé ce crime avec tous les autres massacres du siècle? Si au contraire il s’agit, par cette formule, de figer un record du Mal absolu, les effets mensongers de cette manœuvre qui atténue le mal relatif sont immédiats. Comme le dit Tzvetan Todorov dans sa Mémoire du mal (et apparemment c’est ce qu’on est réduit à rappeler aujourd’hui) : «l’établissement des faits est en lui-même une fin digne d’estime3 3 - Tzvetan Todorov, Mémoire du mal. Tentation du bien, Laffont, 2000.». Et pourtant elle ne suffit pas à faire comprendre : il faut encore comparer, distinguer, classer, définir et interpréter!
Je ne doute pas d’ailleurs qu’une génération de jeunes chercheurs ne se mette au travail de prise de distance et de réexamen critique, nécessaire pour comprendre sans larme à l’œil comme sans aveuglement.
Propédeutique du désenchantement
Je crois que la question qui se posera au 21e siècle en Occident, question que je formule en termes larges mais prégnants, est la suivante : comment les humains parviendront-ils à vivre dans une société anomique, désillusionnée et irrémédiable sans s’inventer de nouvelles irrationalités collectives4 4 - Pierre Bourdieu, Contre-feux, 17, donnait une tâche aux hommes de bonne volonté critique d’aujourd’hui : «Au moment où les grandes utopies du XIXe siècle ont livré toutes leurs perversions, il est urgent de créer les conditions d’un travail collectif de reconstruction d’un univers d’idéaux réalistes, capables de mobiliser les volontés sans mystifier les consciences». Mais c’est bien ce X sans Y qui a été en tous temps la quadrature du cercle.? À l’insoutenable désenchantement moderne, les utopies sociales de jadis remédiaient par le réenchantement d’une «religion de l’immanence» (Vœgelin) et la promesse d’une espérance ramenée ici-bas. Sentant venir la ruine irrévocable de la révélation judéo-chrétienne, des fables bibliques, des dogmes des Églises, et voyant ruinés avec eux la morale et le «lien social» que ces fables légitimaient, le 21e siècle s’était acharné à combler, en ramenant les révélations sur terre, l’immense vide qu’il avait parachevé. La modernité a été ainsi encombrée de tentatives omniprésentes et souvent grandioses de greffer de l’archaïque (des messianismes, des millénarismes et des eschatologies) sur du nouveau : des sciences et des techniques, de l’expansion économique, des mouvements sociaux incompressibles, du déroulement historique accéléré, de la dialectique sociale non maîtrisée, de l’inconnaissable, de l’anomie morale et des effets pervers. Les Grands récits du progrès, ces religions de l’immanence chargées de désavouer et condamner un monde scandaleux, de donner aux hommes un mandat collectif et un nouveau moyen de salut, de promettre la délivrance prochaine des maux sociaux, étaient en effet en rupture radicale avec les révélations des anciennes Églises. Si toutefois l’essence du fait religieux, religions de la transcendance ou de l’immanence, est de promettre aux hommes de les délivrer du mal, alors les Grands récits devaient se former comme des religions de salut nouvelles – et, puisqu’il fallait être «absolument moderne», l’élément fidéiste devait en être refoulé et dénié dans un récit de l’histoire qui se réclamerait de la «science» et qui aurait pour démiurge l’Humanité.
Si quelque chose s’est finalement évanoui dans les cultures occidentales à la fin du 20e siècle, c’est l’idée de progrès, certes, comme boussole d’une axiologie historique (comme moyen de trouver du sens et de la valeur dans le monde), mais c’est, plus radicalement, la possibilité collective de se représenter un monde qui soit différent du monde tel qu’il va, et évidemment meilleur – et de vouloir donc travailler à le faire advenir. Nous avons assisté à la Seconde Chute, celle des religions «séculières» (comme les grandes idéologies totales ont été qualifiées par Vœgelin, Aron et bien d’autres) et, en dépit des bricolages idéologiques et des morales provisoires de la période actuelle, il n’y a plus de recette de réenchantement qu’il suffirait d’activer.
Envisageant cette conjoncture prochaine, Hannah Arendt avait écrit – j’ai cité cette phrase souvent – que nous, modernes tardifs, allions devoir tout simplement apprendre à vivre in the bitter realization that nothing has been promised to us, no Messianic Age, no classless society, no paradise after death5 5 - Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism. 3rd Edition. New York: Harcourt Brace Jovanovitch, [éd. orig.: 1951], 1968, p. 436. (avec la conscience amère que rien ne nous a été promis, ni âge messianique, ni société sans classe, ni paradis après la mort). Tout est ici : nous devions apprendre… L’idée que poursuit Arendt est celle de la désillusion comme nécessité éthique et comme processus historique entamé avec le scepticisme libertin et philosophique à l’égard des religions révélées et qui devra, quoi qu’on en pense, s’accomplir jusqu’au bout. La difficulté est dans la conjonction et. Nous, modernes des derniers jours, n’avons plus le choix d’admettre qu’il n’est ni paradis, ni régime social juste, ni société sans classe, même si cet aveu doit nous être bien «amer». Dans sa philosophie des totalitarismes du 20e siècle, Hannah Arendt n’est-elle pas loin d’un Vœgelin : dans tout projet humain, prométhéen, de connaître de part en part le monde et de le changer radicalement, Vœgelin ne voyait qu’hybris et vaine révolte contre la condition humaine. Cet apprentissage du désenchantement, s’il est dur à faire, sera, croit-elle, ultimement bénéfique : les religions révélées ont apporté le fanatisme, l’intolérance et les bûchers; les religions séculières ont accouché du totalitarisme. Curieusement, les deux penseurs anti-totalitaires retrouvent le propos du jeune Marx qui, au Manifeste communiste, désigne la désillusion, le désenivrement comme aboutissement psychologique souhaitable de l’humanité : «tout ce qui était stable et établi se volatilise, tout ce qui était sacré se trouve profané et les humains sont enfin forcés de considérer d’un regard sobre leur position dans la vie et leurs relations mutuelles».
Il y a pourtant un parti pris volontariste dans ce mot d’ordre philosophique en faveur de la lucidité dés-illusionnée, il se ramène à un «Tu dois donc tu peux». Or, nous sommes plutôt renvoyés à l’anthropologie médiane de Pascal, «Qui veut faire l’ange fait la bête» : l’homme a eu bien raison de critiquer les vieux mythes et de vouloir sortir des sociétés irrationnelles et fanatiques de jadis et de naguère, mais il ne peut non plus se construire une vision purement rationnelle du monde et y vivre à l’aise – non seulement parce qu’il n’est pas un être de pure raison, mais surtout parce qu’il n’y a pas de modus vivendi raisonnable avec un monde reconnu malfaisant et scandaleux dont il lui faudrait admettre «amèrement» mais rationnellement qu’il n’a simplement pas d’alternative et qu’il faut s’en contenter. Il y a bien un modus vivendi, mentionné dans tous les manuels de philosophie, il s’appelle «hédonisme», – «tout ceci durera bien autant que nous, laissons courir et divertissons-nous» –, mais cette attitude qui n’est pas d’une morale très haute, consiste justement à trouver légitime de ne pasavoir à regarder le monde en face. L’humanitarisme médiatique avec ses attendrissements volatiles et ses amnésies programmées – au petit écran, un enfant agonise loin là-bas dans les affres de la faim pendant que je prépare le repas du soir – relève d’une formation de compromis qui a certainement un avenir parmi nous : l’hédonisme avec alibis de brefs sursauts sentimentaux, le nouveau pharisaïsme de la «souffrance à distance» (Luc Boltanski).
Comment vivre dans une société désenchantée et regarder sa place dans le monde et les autres humains d’un regard «sobre»? Nul n’a démontré que les humains peuvent se passer d’illusions, d’évasion, de contre-propositions et d’espérances, et nul n’a démontré que la volonté de justice qui animait les «religions du second type» n’est pas aussi irrépressible que la sobre volonté de savoir qui se marie bien au désenchantement. Par ailleurs, les grands programmes utopiques ont été aussi des vecteurs de rationalité projetée sur l’avenir, d’humanisme solidaire, et surtout ils ont été des instruments d’émancipation de l’esprit et de résistance critique au cours du monde, de refus d’en accepter passivement l’injustice inhérente. Leur décomposition, si elle s’avère irréversible, ne promet rien à ces divers égards, rien qui vaille.
Jules de Gaultier, subtil philosophe oublié de la triste «Belle époque», appelait «bovarysme» (il pensait bien sûr à l’héroïne de Flaubert) l’incapacité des humains de vivre sans se concevoir autres qu’ils ne sont6 6 - Jules de Gaultier, Le bovarysme, Mercure de France, Paris, 1902.. Pour l’instant, les médias fournissent leur généreuse part d’évasions programmées et d’illusions et il se peut que la parfaite sobriété stoïque ne soit jamais que l’affaire d’une «élite» philosophique. D’illusions inventées par des esprits généreux de jadis, on passerait, pour les foules, à des illusions commercialisées par des publicistes habiles, beaucoup mieux testées et contrôlées. Progrès encore une fois décidément!
Dans ce contexte, il faudrait essayer de deviner, dans un Occident qui sera de plus en plus assiégé par toute la misère du monde et de moins en moins tenté d’ouvrir grandes ses portes, à quelles illusions nouvelles et à quels mécanismes de contrôle social la mort de l’illusion du progrès et celle des utopies modernes vont donner naissance. Une culture comme celle dans laquelle nous sommes entrés, privée de ses illusions et d’espoirs de correction des torts sociaux ne sera pas plus prompte à la lucidité et à l’équité. Elle s’invente déjà et s’inventera d’autres mythes et chimères qui n’auront pas cette circonstance atténuante de prétendre parler au nom de l’humanité émancipée et qui, face à l’obscurité insondable de l’évolution humaine, auront renoncé à la tâche d’y projeter une lumière qui ne saurait dissoudre les ombres ni éclairer les abîmes.