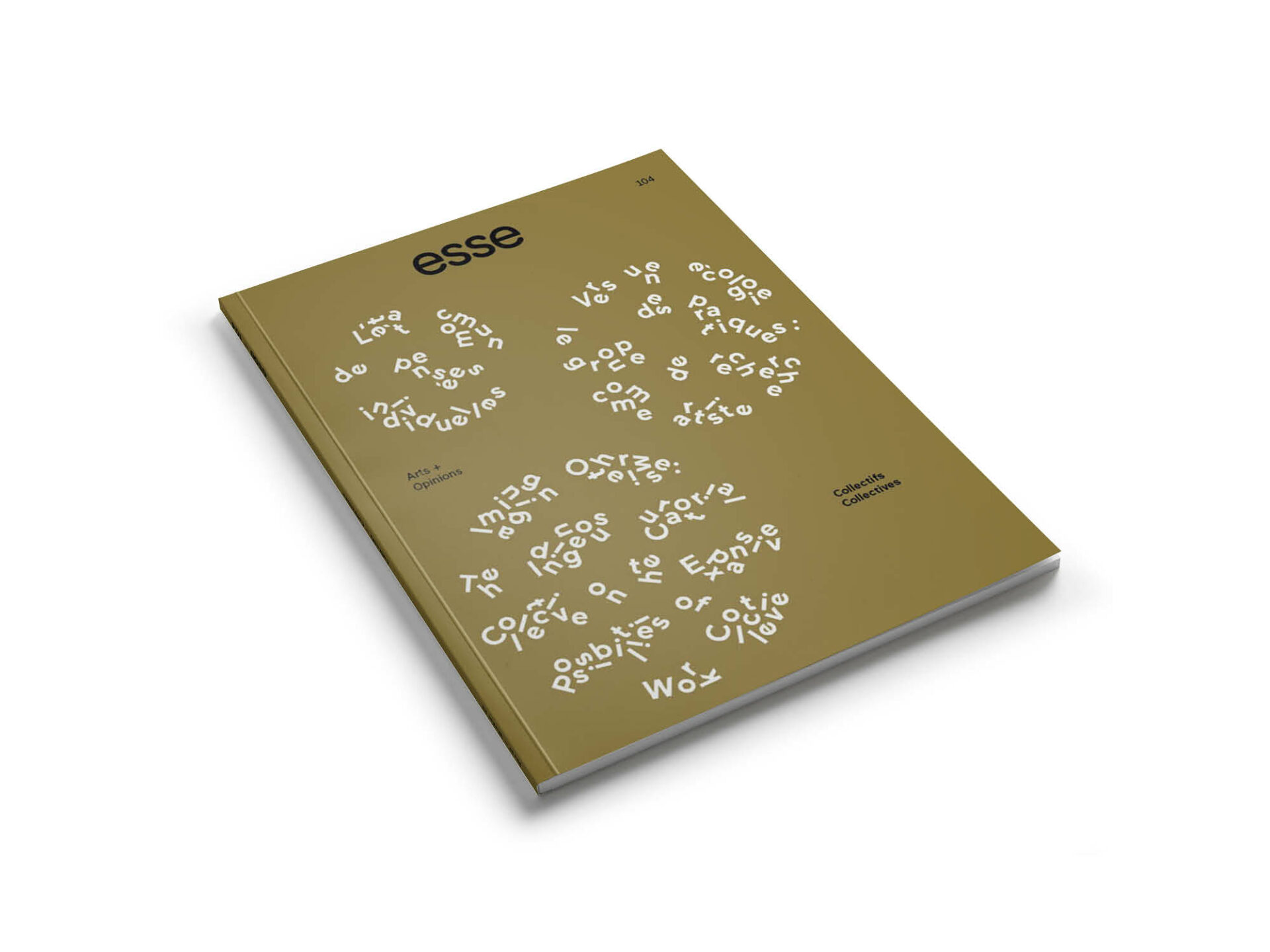Guérison par la parole : le dialogue comme résistance collaborative
La collaboration, comme élément fondateur de notre travail collectif, nous amène à ralentir ainsi qu’à passer plus de temps à réfléchir au processus créatif et à discuter de nos valeurs en tant qu’artistes et universitaires. La décélération intentionnelle et l’adoption d’une approche plus lente, éléments importants de nos pratiques, nous permettent de nous concentrer sur le processus de création plutôt que sur la production d’un objet final. Une rencontre avec l’autre émerge de nos dialogues et nos pratiques respectives ne font qu’une. Le présent texte est une performance de ce dialogue.
Victoria Stanton : La conversation est un aspect fondamental de ma pratique artistique et maintenant universitaire. C’est le moteur qui propulse chaque étape de tout travail créatif ou intellectuel. J’irais même jusqu’à dire que c’est cette impulsion d’être en conversation qui me pousse continuellement à rechercher et cultiver la collaboration dans mes projets.
Stacey Cann : La conversation est aussi essentielle à mes pratiques collaboratives. Je travaille souvent avec des artistes ou des professionnels qui utilisent des techniques différentes de celles que j’emploie dans ma pratique individuelle. Cela nécessite, d’une part, de penser ensemble sur le plan conceptuel et, d’autre part, d’apprendre à se connaitre, mais également à utiliser des matériaux et des outils auxquels on n’est pas habitué. D’une certaine façon, nous collaborons non seulement avec des êtres humains, mais aussi avec des matériaux et des processus. Travailler avec des designeurs et designeuses industriel·le·s, des programmeurs et programmeuses informatiques, des musicien·ne·s et des danseurs et danseuses m’a permis de réfléchir différemment à mes pratiques individuelle et collaborative et d’élargir ma conception de la façon dont les matériaux et les concepts peuvent être explorés. Par exemple, construire une sculpture de quelque 5 mètres sur 7 mètres qui divise la galerie en espaces d’engagement social et d’isolement m’a permis de penser à la façon dont je positionnais mon corps par rapport au public durant mes performances solos et à ma façon de créer des moments de connexion et de déconnexion dans mon travail.
VS : En effet, le désir d’être en communication peut être un moyen d’élaborer des idées. Pour ma part, cela est devenu la méthodologie de ma pratique (et de ma recherche) et soutient l’essentiel de ma production créative. Ce qui est devenu plus clair, avec le temps, c’est que la conversation, en plus de permettre la communication d’idées, est souvent le cœur de la production créative elle-même.
SC : Avoir des idées, c’est souvent la partie facile, surtout en début de conversation. En réalité, plusieurs tensions apparaissent dans l’accomplissement du travail, la logistique de l’obtention de subventions ou de commandes, la réception des matériaux, l’embauche de gens pour nous aider à construire ou déplacer des œuvres de grande taille. Je crois que nous nous laissons parfois un peu emporter par cette idée utopique de la collaboration alors que ce n’est pas du tout la réalité. Il y a des désaccords et des compromis ; cela en fait aussi partie. Je ne perçois pas cela comme des aspects négatifs, mais comme une part importante du processus collaboratif.
VS : Je suis d’accord. Alors, crois-tu qu’il s’agisse aussi d’une façon de générer des idées ? Parce que les tensions et les conflits peuvent mener à de nouvelles possibilités – lorsque nous faisons l’effort de réellement nous écouter les un·e·s les autres. Dans ce cas, le conflit peut être créatif. J’ai découvert que de passer par les étapes compliquées en cherchant des solutions (créatives) fait avancer les idées. Les pratiques performatives nous habituent à ces « choses qui ne fonctionnent pas » et c’est dans l’aspect performatif de dialoguer-avec que la spontanéité s’épanouit. Maintenant que je me retrouve dans un contexte universitaire, je veux valider l’action d’être en dialogue comme une forme de création ; comme un type de production de savoir. Je vois la pensée collective, la discussion et l’être-ensemble (harmonieusement ou avec des tensions) comme une forme de devenir artistique ; un portail vers la création qui prend place à même la conversation. La collaboration est une forme de conversation.

Fresh Candy/Post-apocalyptique, vue d’installation, Le 4330, Montréal, 2011.
Photo : Victoria Stanton, permission des artistes
SC : Oui et ce n’est pas seulement la partie de la conversation qui concerne l’art qui est importante. C’est essentiel d’être sur la même longueur d’onde artistiquement et d’être conscient·e de la situation de l’autre. La conversation peut mener à cela. Je crois qu’il est crucial de comprendre les besoins de nos collaborateurs et collaboratrices et ce qu’ils et elles attendent du projet d’un point de vue intellectuel, émotionnel et financier. La dimension personnelle devient importante. Cela modifie ce qui pourra être fait. C’est facile de s’enthousiasmer pour une idée et de plonger, mais que signifie réellement réaliser le projet ? Qu’en retirons-nous et que sacrifions-nous pour être en mesure de l’entreprendre ? À travers la conversation, nous apprenons à connaitre nos collaborateurs et collaboratrices sur le plan artistique, mais aussi personnel. Cela peut mener à un sentiment de solidarité au sein du groupe et le solidifier. En raison de la nature compétitive des mondes artistique et universitaire, cette solidarité est peut-être l’aspect le plus important de la collaboration pour moi.
Je m’étonne parfois que les gens souhaitent collaborer étant donné la nature très compétitive et individualiste des pratiques artistique et universitaire. Nous sommes tous et toutes en compétition pour des subventions, des postes d’enseignement, des expositions, des invitations à des conférences et la publication d’articles.
Le fait que les pratiques collaboratives survivent malgré le spectre de la notion de l’artiste-universitaire en tant que génie solitaire témoigne de la solidarité qui nait lorsque nous travaillons avec les autres.
La résistance à l’université néolibérale à travers les pratiques collaboratives et lentes qui contrent la pression de la productivité en faveur du processus – une approche qui met l’accent sur l’intention-nalité et l’attention – semble augmenter malgré le manque de structures institutionnelles en place pour la soutenir. Je crois que les mondes artistique et universitaire sont des lieux où nous devrions pouvoir réfléchir ensemble à des idées, mais le fait d’être en concurrence les un·e·s avec les autres complexifie cela. Comment équilibrer les choses ? Pouvons-nous collaborer tout en étant en compétition ? Cela place également la collaboration dans les milieux artistique et universitaire dans une position différente de celle des milieux entrepreneuriaux puisqu’elle n’est pas nécessairement axée sur l’efficacité, bien que je présume qu’elle ne l’exclut pas. Je vois plutôt la collaboration comme un moyen d’entrer en relation avec les autres intentionnellement, de façon à être plus qu’un mais moins quedeux1 1 - Karen Barad, « Diffracting Diffraction: Cutting Together-Apart », Parallax, vol. 20, nº 3 (2014), p. 168-187..

Diagram 2 (Talking Cure Series): Personal/Professional/Aesthetic, 2021.
Photo : permission de l’artiste

Diagram 6 (Talking Cure Series): Cooperation, 2021.
Photo : permission de l’artiste
VS : Je vois la collaboration aussi comme un moyen de préserver l’espace pour les autres. Dans un processus de co-création, nous ne sommes pas toujours d’accord avec les idées des autres et la communication n’est pas toujours fluide même si nous nous apprécions. Comme nous le disions plus tôt, toute relation (et vraiment toute) demande du travail et des efforts, et la collaboration créative ne fait pas exception. Cependant, se rassembler pour rêver, pour construire quelque chose, est un acte de foi. Ce qui est un acte de résistance. Bâtir la confiance afin de collaborer signifie ralentir un processus, être plus attentionné·e, prendre plus de temps, s’opposer à la culture de l’efficacité. Cette forme d’écoute active et la recherche de moyens de se soutenir mutuellement permettent de mettre en œuvre d’autres priorités et de construire une culture de coopération. J’entends par là une sorte de travail commun en vue d’une expérience mutuellement bénéfique, nourrissante et réciproque.
Cette conversation nous a amenées à lire et à discuter longuement de notre souhait d’encadrer nos expériences universitaires respectives (et collectives) dans l’objectif d’un ou plusieurs mouvements lents qui non seulement s’opposent au rythme accéléré et au genre de modèle « d’extraction d’information » qui « réduit tout à uneressource2 2 - Michelle Boulous Walker, Slow Philosophy: Reading Against the Institution, New York, Bloomsbury, 2016, p. xiv. [Trad. libre] » (ainsi qu’à la nécessité de « publier à tout prix »), mais qui répondent aussi au besoin de contrer cette culture par nos efforts intentionnels de travail coopératif. Vouloir nous interroger sur la façon dont nous prenons part à un contexte concurrentiel peut nous encourager à bâtir un réseau coopératif, plutôt que de nous enfermer dans un cadre compétitif. En pensant au nombre d’épuisements professionnels chez les étudiant·e·s de cycle supérieur et les enseignant·e·s, comment pouvons-nous nous opposer à cet environnement insoutenable auquel tout le monde contribue ? Mais ces questions, notre attitude et notre approche… ce n’est pas seulement pour inciter à la révolte, résister ou faire de la politique (bien que je soutienne toutes ces choses) : il s’agit d’un effort sincère pour tenter de créer les conditions qui nous aident à contribuer – et à prendre part – à une situation plus viable. Une situation à long terme qui est vivifiante et positive, pas seulement une recette pour l’épuisement. En ce sens, je vois la collaboration comme un espace de dialogue qui émerge où nous pouvons parler de ces sujets qui sont importants pour nous ; ce que l’équité, l’éthique et l’attention signifient dans notre processus. Cela ne veut pas dire que ça ne se produit pas dans une pratique individuelle, mais je crois que cela se manifeste différemment dans la collaboration ; être appelé·e à être responsable pour soi-même, mais aussi pour ceux et celles avec qui nous travaillons. La collaboration et les conversations qui s’ensuivent reflètent le désir de coopérer. Donc, pour reprendre le fil de ce qui a été dit plus tôt, nos conversations ne sont pas l’unique forme de production créative ; notre coopération, de surcroit, peut aussi être considérée comme une forme de création (et d’élaboration d’une communauté).

Ablution, Silver Skate Festival, Edmonton, 2016.
Photo : Yuri Wuensch, permission des artistes
SC : Pour moi, la coopération revient aussi à l’idée de valeurs. Il est plutôt difficile de valoriser le travail commun dans une société qui met constamment de l’avant l’idée de la compétition pour la survie. Nous devons toujours en faire plus, être les meilleur·e·s et progresser sous peine qu’on nous laisse derrière, alors que la coopération nous permet d’être accepté·e·s tel·le·s que nous sommes. Elle nous autorise à ne pas être tout, mais plutôt une partie d’un ensemble plus vaste. C’est là que, selon moi, la coopération et le mouvement lent se rejoignent.
VS : Exactement. Alors, lorsque nous commençons à parler d’approches de travail – pas seulement sur le plan du contenu, mais également de la forme (pour ainsi dire) –, nous touchons aux valeurs, qu’elles soient nommées de façon spécifique ou non. Cela finit par déterminer une culture qui est créée dans une collaboration donnée, dans une manière choisie d’être ensemble. Et s’il n’est pas évident qu’une collaboration va ou doive se concentrer sur son système de valeurs, ce que j’ai constaté au fil des années, c’est que les valeurs du collectif finissent par émerger afin de systématiser une méthode de travail – de créer une éthique de groupe. Disons que nous voulons résoudre des situations dans lesquelles nous nous sommes retrouvé·e·s – le genre d’histoires qui se déroulent dans un contexte professionnel ou universitaire. Un exemple concret : Stacey et moi avons décidé d’écrire un texte ensemble. Nous sommes confrontées au dilemme de l’autrice principale et secondaire. Nous reconnaissons toutes deux le problème parce que cela représente (symboliquement et matériellement) le cadre compétitif que nous souhaitons remettre en question. Nous tentons de trouver une solution qui reflète nos valeurs. Ainsi, nous engageons une conversation à propos de nos valeurs plutôt que de simple-ment trouver une solution. Nous parlons de la raison pour laquelle nous devons trouver une solution en premier lieu. Nous devons réfléchir à nos valeurs et ensuite les identifier parce que nous sommes confrontées à ces situations.
SC : Je crois qu’il est facile d’oublier comment nous exprimons nos valeurs au quotidien, lorsque nous travaillons seules et que nous sommes dans la routine. La collaboration nous oblige à réfléchir à ce que nous faisons et à la raison pour laquelle nous le faisons. Cela nous aide à renouer avec nos valeurs et nous permet de les exprimer à nous-mêmes ainsi qu’à nos collaborateurs et collaboratrices.
Traduit de l’anglais par Catherine Barnabé