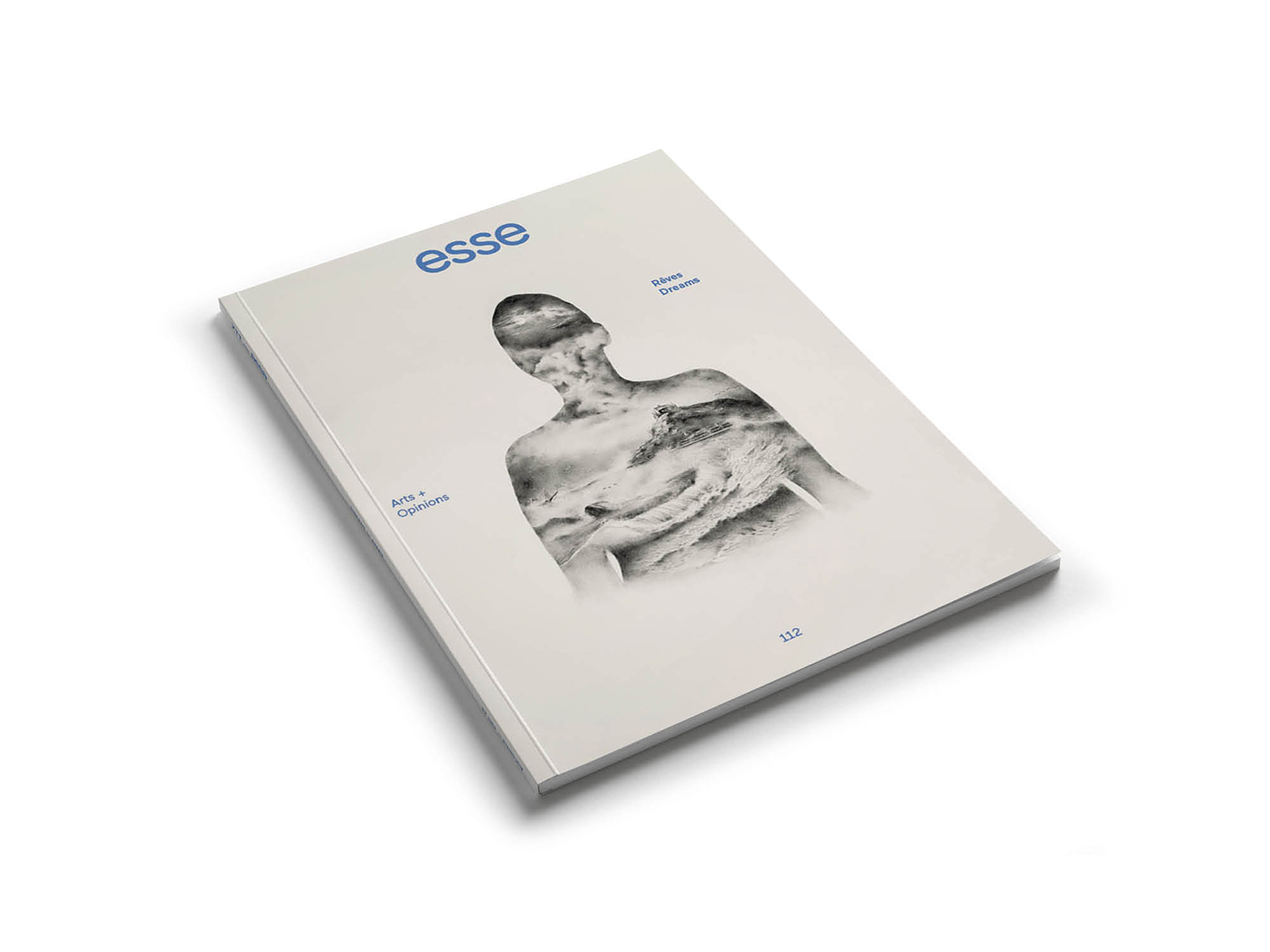Oser rêver
Si rêver n’est pas unique à l’être humain, notre espèce a toujours prêté une attention particulière, voire obsessive, à l’expérience onirique. Des anciennes croyances de l’art divinatoire ou de l’oniromancie, qui donnaient aux rêves un sens prémonitoire (le rêve tourné vers le futur), à l’approche psychanalytique de Sigmund Freud et de Carl Jung (le rêve tourné vers le passé), les rêves ont été utilisés comme de puissants outils de connaissance de soi ou de contrôle du monde. Dans l’appel à contribution pour ce numéro, le comité de rédaction posait la question suivante : « L’interprétation nuit-elle à la capacité des rêves à influencer notre vie ? » Tirée d’un épisode du balado Weird Studies où l’auteur J.F. Martel et le musicologue Phil Ford discutent du livre The dream and the underworld du psychologue James Hillman, l’interrogation intrigue.
Dans son ouvrage, Hillman écrit : « La comparaison entre rêve et mystère suggère que le rêve conserve son efficace tant qu’il demeure vivant. […] Cela signifie pour moi que, les rêves pouvant être tués par leurs interprètes, l’emploi direct du rêve comme message adressé à l’égo est probablement moins efficace à modifier réellement la conscience et influencer la vie que le rêve qu’on garde vivant sous la forme d’une image énigmatique1 1 -
James Hillman, The Dream and the Underworld, New York, Harper Perennial, 1979, p. 122. [Trad. libre]. » On peut se demander en effet si la volonté d’analyser les rêves, en les rationalisant, ne les priverait pas de leurs multiples potentialités. Cette idée est plusieurs fois abordée dans nos pages, avec la suggestion que l’interprétation peut être un acte d’extraction violent, ou le rappel que la perspective rationnelle eurocentrique ne tient pas compte des spécificités sociales et culturelles du rêve (le caractère holistique de l’épistémologie autochtone, par exemple). Préserver son mystère serait alors une voie plus intéressante à considérer.
Entre les mains des artistes, le rêve devient une matière particulièrement riche à explorer, tant son lien avec l’art est profond : prégnance du mystérieux et de l’ambivalence, désir de résister à l’interprétation, faculté d’imaginer la réalité autrement. Le dossier tient compte de tout ce qui définit le rêve, de l’activité psychique qui se déroule pendant le sommeil à la manifestation des désirs ou des aspirations à l’état de veille, jusqu’à la capacité des rêveuses et des rêveurs à figurer d’autres mondes. Dans ce royaume des songes se côtoient des fictions fantasmagoriques et des récits absurdes, des dialogues entre le conscient et l’inconscient, des géographies habitées par l’opacité résistante des rêves, et de nombreuses métaphores d’espoir et de résilience. Cela nous incite sans aucun doute à penser le rêve, à l’instar des romans d’Ursula K. Le Guin, comme un point de départ à l’action collective ou à la rébellion. Un rêve décolonial.
Le rêve prémonitoire n’a pas de fondement scientifique, mais la volonté d’en faire un outil pour se projeter dans le futur et le transformer, en ouvrant vers de nouvelles temporalités, n’est pas dénuée de sens. C’est donc en nous tournant vers l’avenir que nous proposons de commenter le présent et le passé, en faisant appel à la nature réparatrice du rêve, à sa force vitale et à son agentivité, et en reconnaissant son potentiel révolutionnaire.
S’intéresser aux rêves nous mène par ailleurs vers celles et ceux qui en sont plus ou moins privés, tantôt parce que l’insomnie les empêche de vivre l’expérience onirique, tantôt parce que des traumatismes ou les violences de la réalité politique – conflits, dépossession, déplacements – rendent leurs rêves « inrêvables ». Dans ce contexte, l’art est encore une fois l’espace privilégié pour les saisir et les réinventer. Dans leurs textes et dans leurs œuvres, les autrices, auteures et artistes nous invitent à ouvrir le portail du songe pour le laisser déferler dans la vie éveillée, à échapper au réductionnisme de la pensée normative, à reconstruire nos rêves collectifs et à faire place au réenchantement du monde.
Mais ce monde dans lequel nous vivons s’assombrit peu à peu et semble parfois se confondre avec nos pires cauchemars. Alors que du côté environnemental les catastrophes climatiques se multiplient, du côté politique, en plus des conflits sans issue, nous sommes assailli·es de haine par des partisan·es de l’extrême droite ou des populistes au discours teinté de complotisme. Jamais la reconstruction de nos rêves n’aura été aussi essentielle à préserver l’espoir d’un futur lumineux. Heureusement, nous constatons de belles résistances individuelles et collectives sur le plan géopolitique, qui sont autant de tentatives pour redonner au monde sa part de lumière. Plus que jamais, il faut oser rêver.