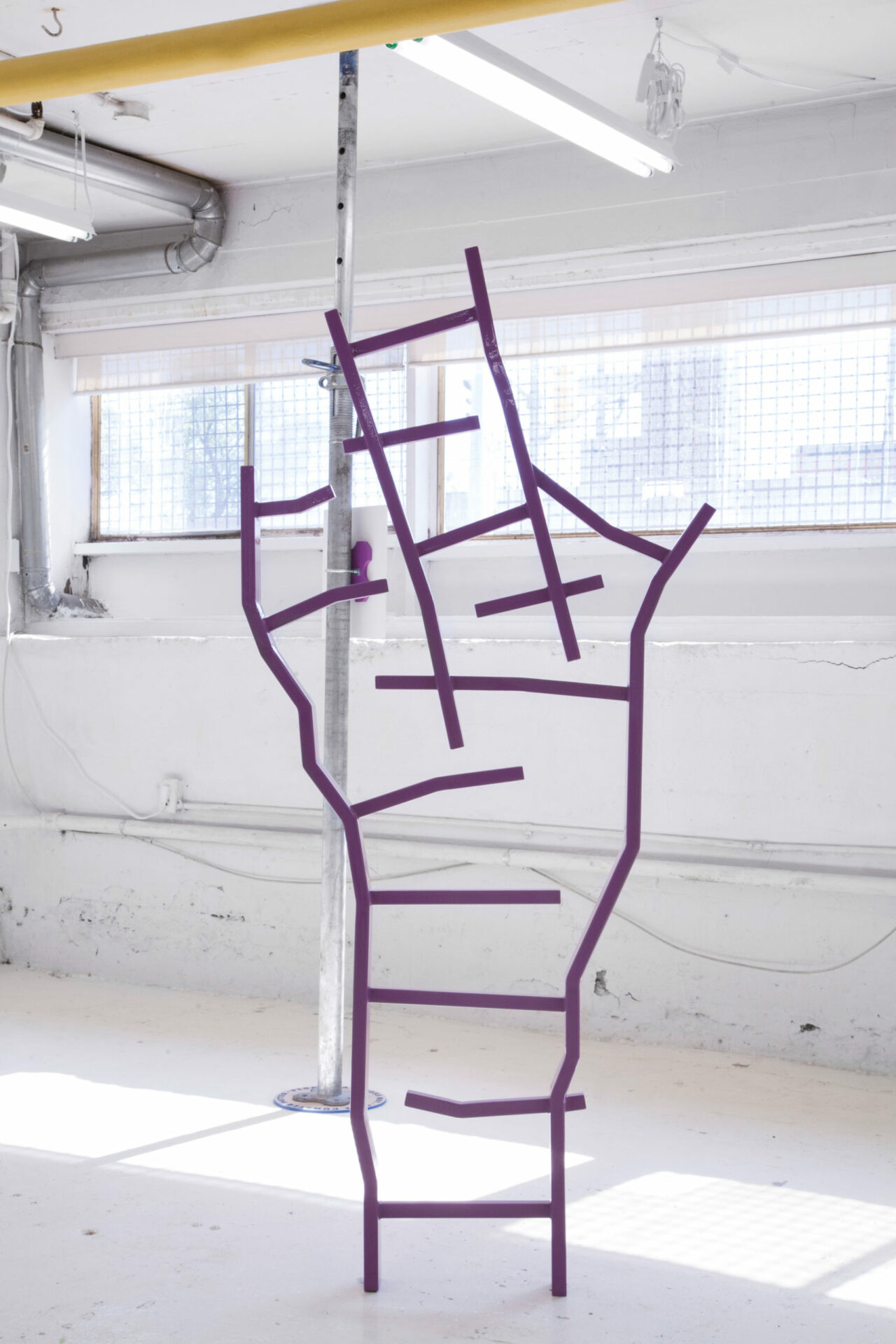2015, 308 p.
C’est d’un malaise face à une conception qui veut que l’image contemporaine soit «toute-puissante et manipulatrice à l’endroit d’un spectateur dit idiot», qu’est né l’ouvrage de Nicolas Mavrikakis La peur de l’image. D’hier à aujourd’hui. En effet, plus que jamais, l’image inquiète, préoccupe. Pourtant, l’idée qu’elle détiendrait un pouvoir intrinsèque lui permettant de manipuler les masses n’est pas nouvelle. D’où vient cette peur de l’image ? Existe-t-il des images qui mettent à mal leur récupération «par le pouvoir de l’État, par le système capitaliste, par le système publicitaire, par le monde des communications» ? Avec un regard critique aiguisé, non sans un soupçon d’humour, l’auteur adopte ici l’angle d’une histoire sociale de l’image pour faire le point sur une méprise qui connait un long parcours.
Mavrikakis trace les contours d’une problématique qui trouve sa source dans le rapport de force entre l’image et le texte. Parmi les enjeux soulevés, retenons que les représentations entretiennent un lien avec le pouvoir. De quelle nature est ce pouvoir, au juste ?, questionne l’auteur. En agissant à titre de «doubles mensongers du réel», texte et image provoqueraient la disparition de l’espace concret au profit d’un espace virtuel proposant des effets de réel renforcés par les nouvelles technologies. L’image, parce qu’elle serait plus proche du réel, relèverait de la tromperie et, en cela, serait plus puissante que le texte. Cette question de l’absence provoquée par les représentations, est au cœur de l’ouvrage. Baudrillard, Virilio, ces «apocalyptiques», se sont fait les chantres d’un discours alarmiste sur la perte de présence occasionnée par les représentations : «[l]e texte et surtout l’image pousseraient le citoyen à être absent […] du tissu social», selon Virilio. Plus encore, l’image amènerait l’individu vers la «déréalisation» agissant ainsi comme une drogue, une sombre vision contre laquelle s’élève l’auteur. Pour celui-ci, le problème réside essentiellement dans l’impuissance des représentations à créer un véritable dialogue entre les citoyens.
Créez-vous un compte gratuit ou connectez-vous pour lire la rubrique complète !
Mon Compte