Kama La Mackerel
Who sings the queer island body?
Galerie McClure, Centre des arts visuels, Montréal
Du 3 au 25 mars 2023
Du 3 au 25 mars 2023
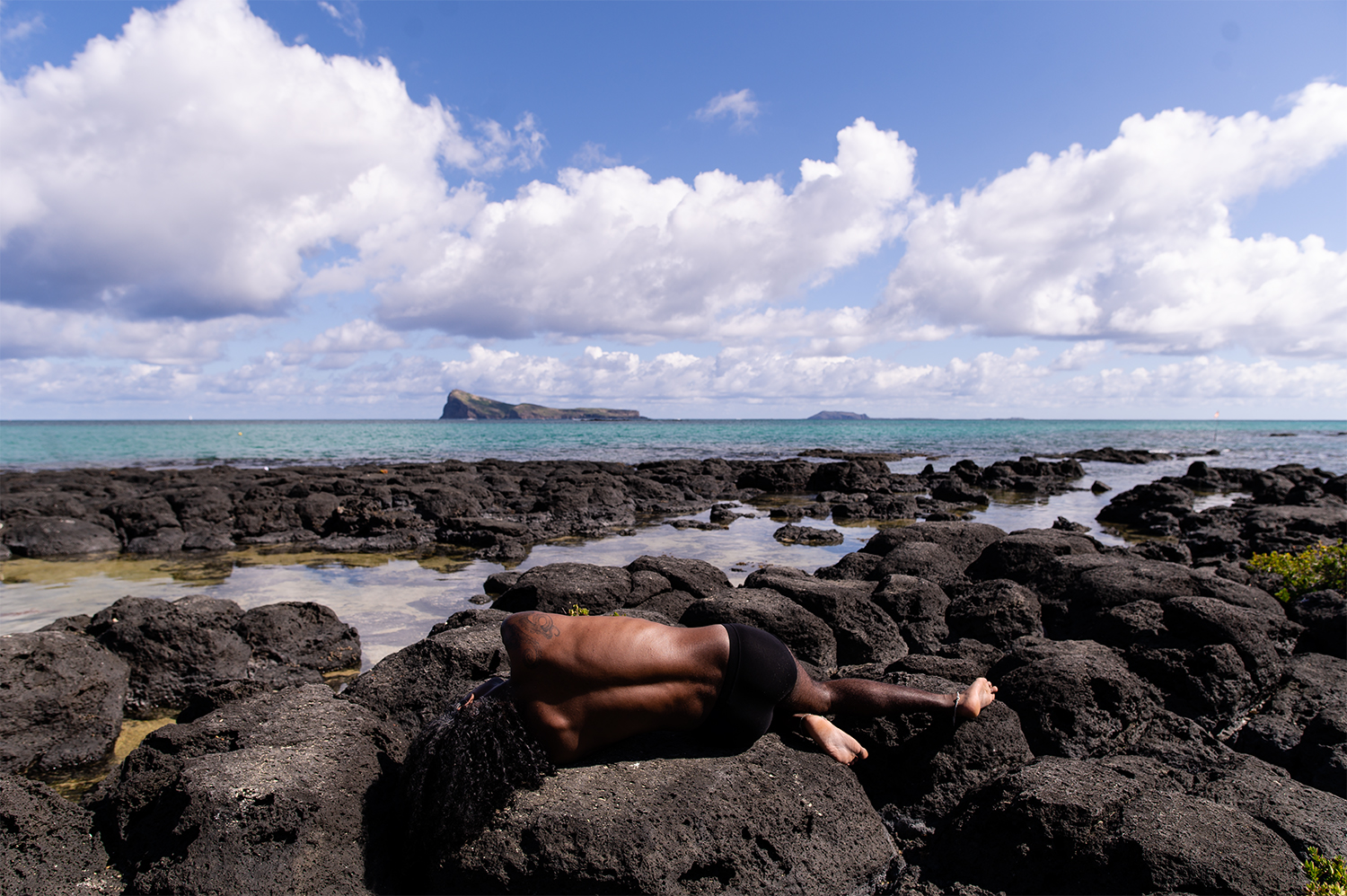
Photo : Ashvin Ramdin
Galerie McClure, Centre des arts visuels, Montréal
Du 3 au 25 mars 2023
Du 3 au 25 mars 2023
La première exposition individuelle de l’artiste queer trans Kama La Mackerel, originaire de l’ile Maurice, s’inscrit dans une démarche qui remet en question les récits coloniaux dominants, ceux-ci cultivant une représentation des espaces insulaires en tant que terra nullius, une terre sauvage pourvue d’une nature immaculée et dénuée des traces de ses habitant·es.
Combinant à la fois la photographie, le rituel-performance, la vidéo, la composition sonore multilingue, l’art textile et la poésie, l’installation multimédia Who sings the queer island body? se déploie dans l’espace à la manière d’ilots dont les contrerécits forgent une cartographie décoloniale entre le corps (queer, trans) et le corps mauricien.
Créez-vous un compte gratuit ou connectez-vous pour lire la rubrique complète !
Mon Compte


