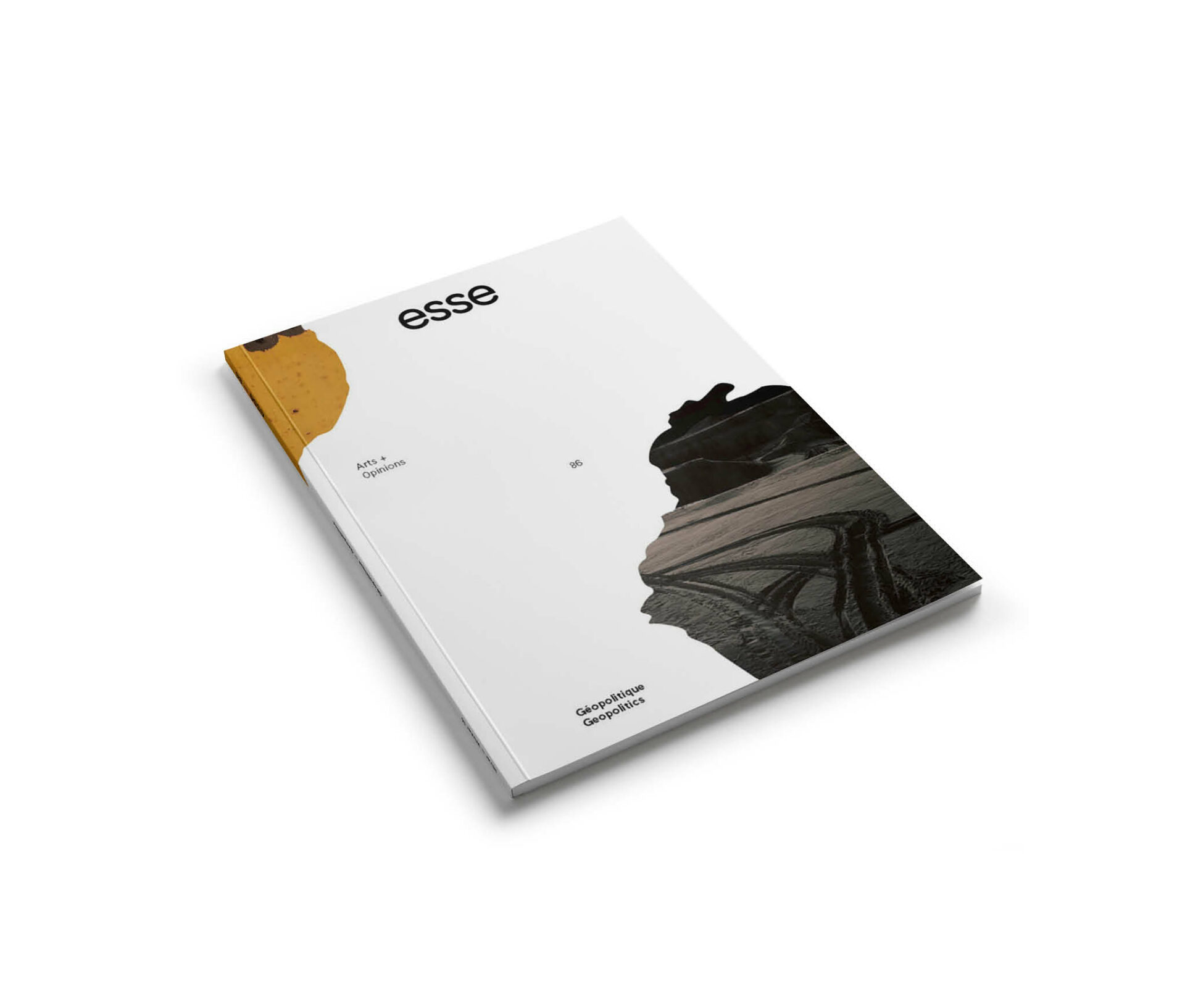Photo : permission de l'artiste
Architecture de réseau vs géométrie de la séparation
À l’ère de l’omniprésence extraspatiale et extratemporelle du Web, nous assistons encore à un conflit entre deux modèles mondiaux : l’un fondé sur la notion de mur, conçu comme un instrument de fragmentation, de ghettoïsation et de division ; l’autre sur la notion de réseau, grâce au développement d’un nouvel espace virtuel où connectivité et continuité spatiotemporelle sont maitres. La situation est paradoxale : d’un côté, la carte du monde est marquée par de profondes fissures – limites physiques, frontières, murs… De l’autre, le monde apparait comme un réseau de lieux connectés, où la ville a perdu son rôle d’accumulateur. En effet, les exigences de compétitivité et d’efficacité, associées à une logique d’entreprenariat, incitent les municipalités à se comporter comme des sociétés privées pour attirer les investisseurs, tandis que le besoin d’espace pousse les entreprises à choisir la périphérie des zones urbaines. Les villes s’éparpillent donc en différents agrégats – chacun doté d’une activité spécifique – et l’espace public se concentre dans des arénas ou des stades, des centres de bienêtre, et des complexes gigantesques dédiés aux congrès, expositions et foires, selon un modèle d’isolation physique et de connexion virtuelle. Il existe en outre un autre genre d’espace consacré aux relations sociales – l’espace post-public2 2 - Daniel Van der Velden, Katja Gretzinger
et coll., « Hybridity of the Post-Public Space », Open, n° 11 (2006), p. 112–123., où la puissance d’Internet est centralisée : plateformes technologiques privées, technopôles, sièges sociaux des géants du Web, universités, centres de recherche où vivent et travaillent les inventeurs.