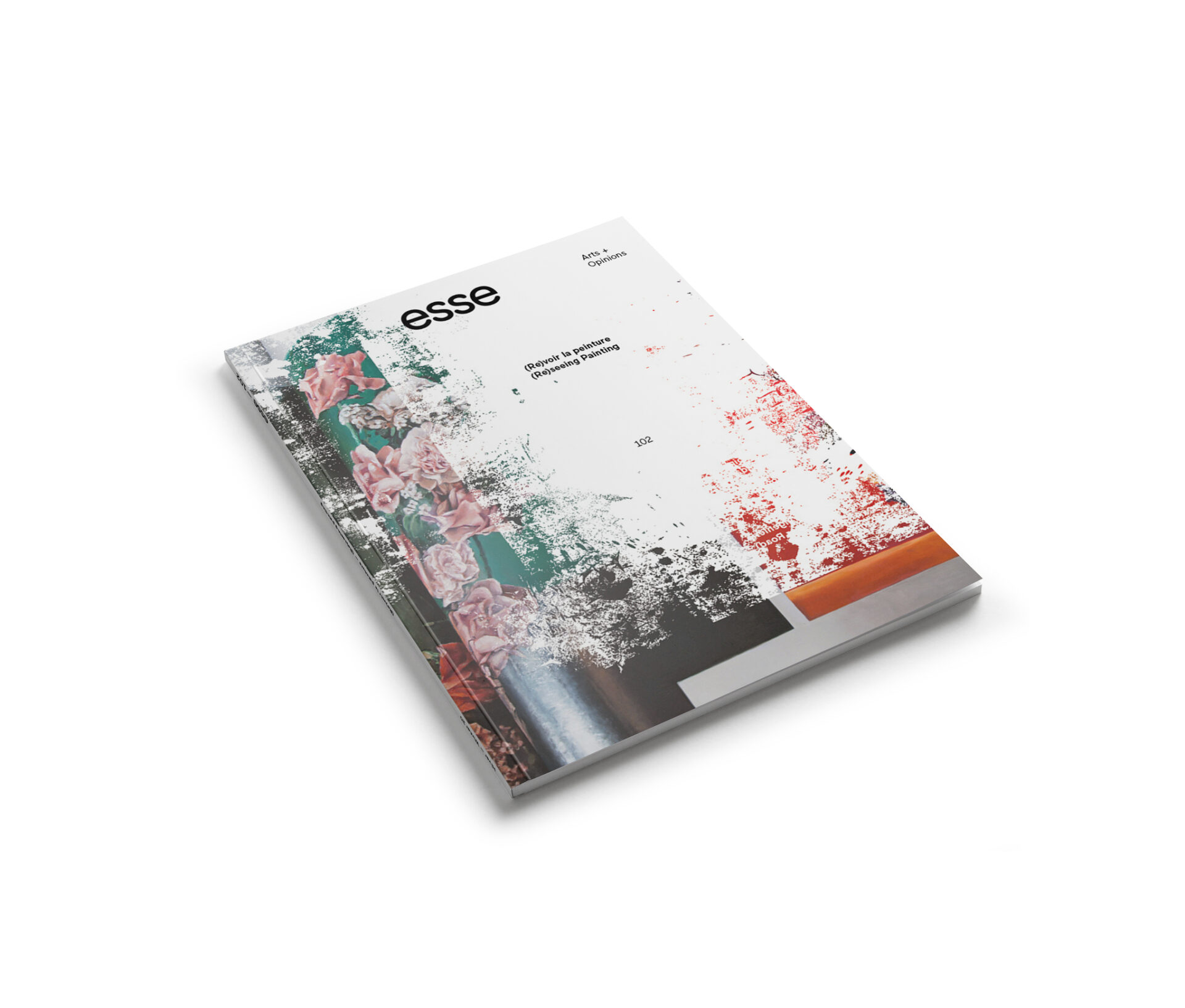Un peu too much :
les stratagèmes de la peinture figurative gaie
Depuis plusieurs années maintenant, la peinture contemporaine fait l’objet d’un examen attentif : on se méfie d’un certain recours aux subterfuges que les critiques appellent, quand il est assidu, le style « zombie ». Dans la foulée de Walter Robinson et de sa critique du « formalisme zombie », le critique d’art Alex Greenberger constate l’essor de la « figuration zombie », genre pictural dont certaines des œuvres les plus connues remplacent les sujets humains par des manches à balai (Emily Mae Smith), par exemple, ou par Miss Piggy en train d’embrasser Kermit la grenouille, dans la pose d’une sculpture de Rodin (Mathieu Malouf). Comme l’affirme Dean Kissick, on dirait que ces peintures ont été produites « par des algorithmes », en ce sens qu’elles sont « conçues pour être parfaitement comprises en moins de cinq secondes »2 2 - Dean Kissick, «The Rise of Bad Figurative Painting », The Spectator, 30 janvier 2021, accessible en ligne. [Trad. libre]. Ce genre de peinture est spécialement patenté, dirait-on, pour circuler dans les médias sociaux et n’exige des gens qui le consomment qu’une réflexion minimale. D’après ses détracteurs, quand la peinture figurative contemporaine reproduit les motifs et la façon de périodes artistiques antérieures, elle titube vers l’avenir comme une morte-vivante et ne signifie pas grand-chose de plus que sa propre ingéniosité. Les critiques d’art partagent en effet un certain scepticisme à l’égard des illusions bas de gamme mises en œuvre par des peintres dont les œuvres se vendent à fort prix ; ils parlent des « blagues » (jokes) du formalisme zombie (Robinson), des « boutades » (one-liners) de la figuration zombie (Greenberger) ou des « rebondissements » (twists) de la mauvaise peinture figurative (Kissick). Les stratagèmes de la peinture figurative contemporaine amusent et agacent, et leur valeur présumée éveille le soupçon.