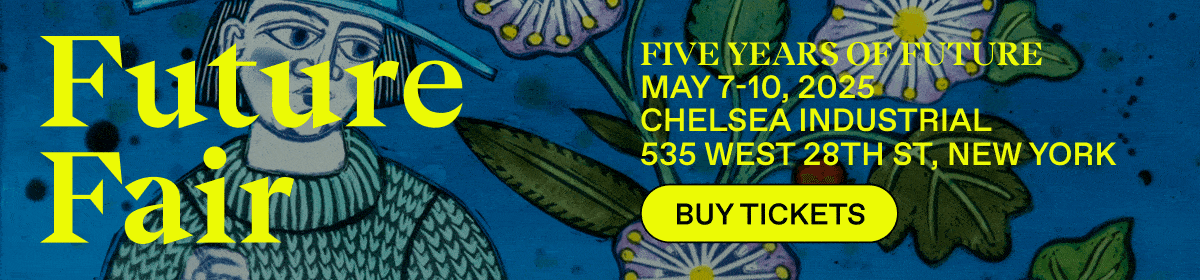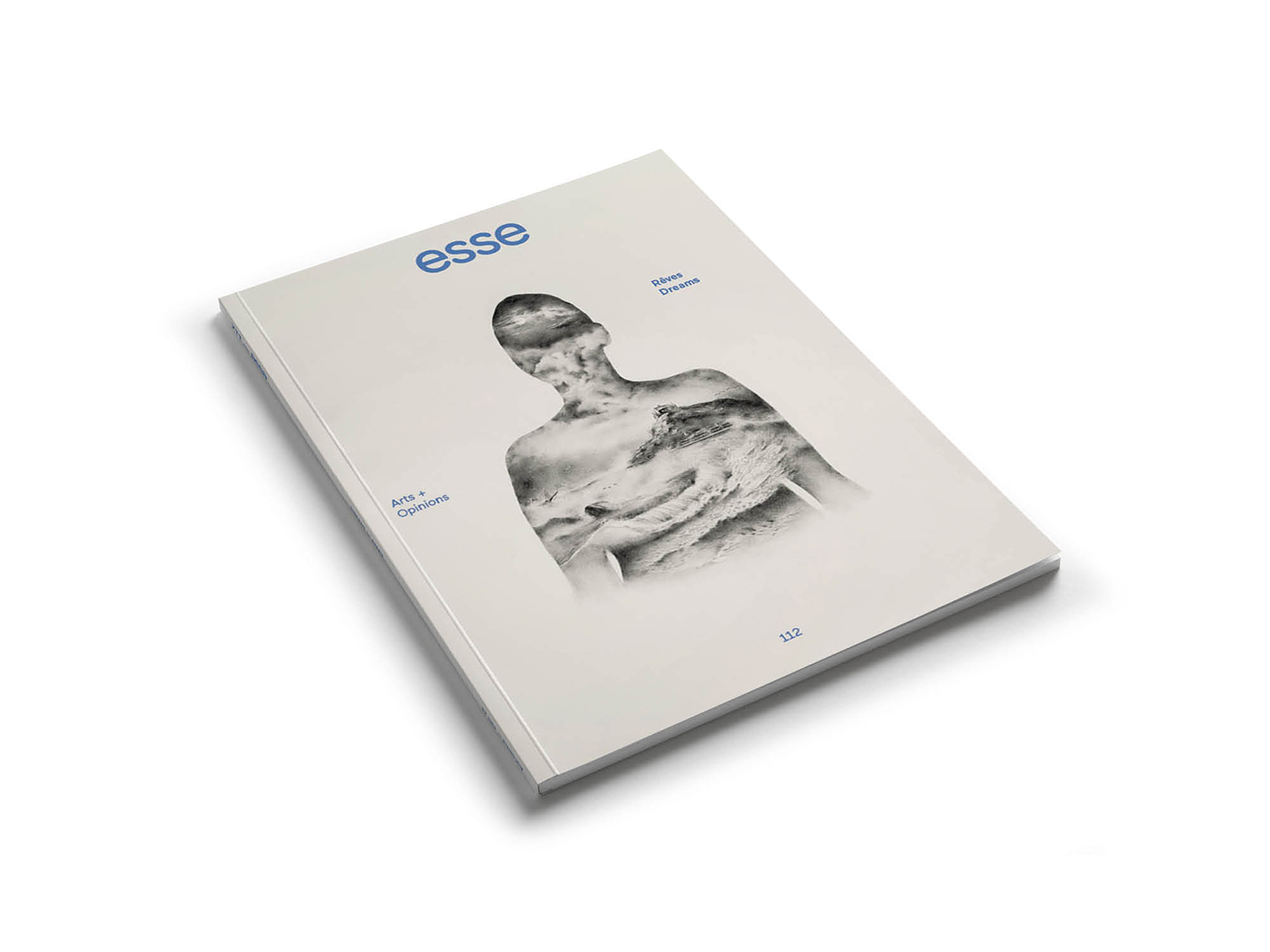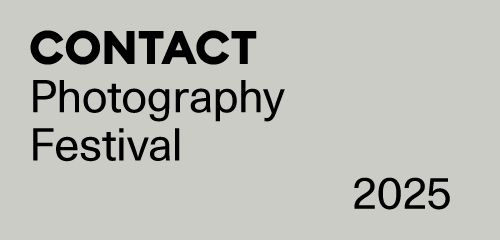Photo : Antoine Raymond
du 22 mai au 6 juin 2024
[In French]
Fascinant d’observer se développer une nouvelle ère festivalière. Piloté pour une troisième année consécutive par les codirectrices Jessie Mill et Martine Dennewald, le Festival TransAmériques (FTA) est applaudi, mais également décrié par de mauvaises langues dénonçant son désengagement envers les artistes les plus formalistes. À l’image de ce qui agite les scènes du monde entier, la pensée décoloniale et les idées de la gauche intersectionnelle sont devenues les principaux carburants intellectuels de l’évènement et, d’un point de vue strictement formel, les incarnations scéniques en découlant sont souvent dénuées de la volonté de « réinvention ». Parfois même, elles se tournent vers les formes traditionnelles les plus ancestrales ou vers des pratiques scéniques très sobres, qui n’ont pas souvent fait partie du terrain de jeu du FTA.
Comme public, il a fallu, ces dernières années, redessiner notre horizon d’attentes. Changer l’axe de nos regards. Raturer quelques vieilles cases de nos grilles de référence. C’était avant que l’édition 2024 fasse encore bouger ces lignes et règle le dosage. Bien que toujours parcourue d’un souffle décolonial (et on le salue), et bien qu’affairée à visibiliser les artistes des Premiers Peuples dans des formes en partie « traditionnelles » (on le souhaite aussi), la programmation 2024 fut davantage plurielle, du moins dans le parcours que nous avons suivi. Notamment, plusieurs spectacles ont labouré les territoires du rituel et de la cérémonie avec des gestes neufs. Peut-être était-ce le fait d’un croisement fertile de traditions au caractère liturgique et de nouvelles sensibilités envers les communautés marginalisées. Quelque chose de brillant est apparu là, à l’endroit où se rencontrent des pratiques cérémonielles canoniques et des populations que ces rituels de masse, pensés pour une collectivité homogène, excluent trop souvent. C’est en tout cas l’une des manières d’analyser Floreus, de Sébastien Provencher. Dans cette pièce tout en langueurs, un homoérotisme frémissant prend possession des espaces sacrés de la chapelle de la Cité-des-Hospitalières. Les corps masculins s’y déshabillent et se gorgent de désir dans une ambiance néanmoins « catholique » établie au début du spectacle par une séquence de chant cérémoniel. Par l’évocation de la sexualité entre hommes et via des emprunts à l’art-performance et à des pratiques d’art installatif, le lieu de culte traditionnel s’enrobe de nouvelles significations. La représentation exacerbe et poétise ce que nous pourrions nommer comme étant un « besoin de cérémonie » au sein de la communauté queer.
Create your free profile or log in now to read the full text!
My Account